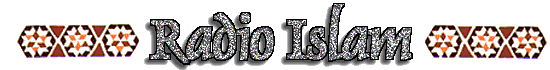
Mon Combat
ADOLF HITLER
4
Munich
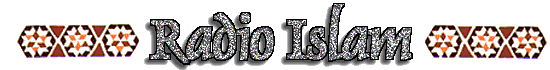
Mon Combat
ADOLF HITLER
4
Munich
Au printemps de 1912, je partis définitivement pour Munich.La ville proprement dite m'était aussi familière que si j'avais séjourné dans ses murs pendant des années. C'est que mes études m'avaient maintes fois conduit à cette métropole de l'art allemand. Non seulement on n'a pas vu l'Allemagne quand on ne connaît pas Munich, mais surtout on ne connaît rien de l'art allemand quand on n'a pas vu Munich.
Quoi qu'il en soit, cette époque de l'avant-guerre fut la plus heureuse de ma vie. Mon salaire était encore tout à fait dérisoire, mais je ne vivais certes pas pour peindre : je peignais pour m'assurer ainsi des possibilités d'existence, ou plutôt pour me permettre de continuer d'apprendre. J'avais la conviction absolue qu'un jour cependant, je finirais par arriver au but que je rri étais fixé. Et ceci suffisait à me faire supporter aisément et sans souci les autres petits tracas de l'existence.
A cela s'ajoutait encore le profond amour qui me saisit pour cette ville, presque dès la première heure de mon séjour, sentiment que je n'éprouve au même degré pour aucun autre lieu. Voilà une ville allemande ! (Quelle différence avec Vienne ! Cela me faisait mal rien que de penser à cette Babylone de races..) Ajoutez à cela le dialecte, beaucoup plus proche du mien, et qui, surtout dans mon entourage de Bas-Bavarois, me rappelait souvent ma jeunesse. Mille choses m'étaient ou me devinrent profondément chères et précieuses. Mais ce qui m'attirait le plus c'était ce merveilleux mariage de force spontanée et de sentiment artistique délicat, cette perspective unique qui va
130 de la Hofbräuhaus à l'Odéon, de l'Oktoberfest à la Pinacothèque, etc. Que je sois aujourd'hui attaché à cette ville
plus qu'à aucun autre lieu au monde tient sans doute au fait qu'elle est et demeure indissolublement liée à mon développement. Mais le fait que j'ai eu la chance d'y trouver une véritable satisfaction intérieure, doit être attribué seulement au charme que la merveilleuse ville royale des Wittelsbach exerce sur tout homme doté non seulement d'une froide raison, mais aussi d'une âme sensible.
A Munich, indépendamment de l'exercice de ma profession, j'étais surtout attiré par l'étude suivie des événements politiques, et plus particulièrement des événements politiques extérieurs. ,j'arrivai à la politique extérieure par le détour de la politique allemande d'alliances, que je tenais déjà pour absolument fausse lorsque j'étais encore en Autriche. Mais à Vienne je ne voyais pas clairement à quel point le Reich s'illusionnait. J'étais alors porté à admettre - ou peut-être voulais-je voir là une excuse - que l'on savait peut-être déjà à Berlin combien l'allié serait en réalité faible, mais que, pour des raisons plus ou moins mystérieuses, on dissimulait cette conviction sous le souci de continuer la politique d'alliance instaurée jadis par Bismarck, et dont la rupture soudaine n'apparaissait pas comme souhaitable, soit pour ne donner en aucune façon l'éveil à l'étranger aux aguets, soit pour ne pas inquiéter le pays lui-même.
Mes contacts avec le peuple me montrèrent bientôt à ma grande frayeur que cette opinion était fausse. Etonné, je dus constater que partout, même dans les milieux cultivés, l'on n'avait pas la moindre lueur sur ce qu'était la monarchie des Habsbourg. Dans le peuple même, on avait l'illusion que l'allié pouvait être regardé comme une puissance sérieuse qui, à l'heure du péril, mettrait aussitôt sur pied une grande force militaire ; on tenait toujours la monarchie pour un Etat « allemand », et l'on croyait pouvoir tabler là-dessus. On pensait que la force, ici encore, pouvait se mesurer au nombre, à peu près comme en Allemagne, et l'on oubliait complètement, d'abord que l'Autriche avait cessé depuis longtemps d'être un Etat allemand, ensuite que d'heure en heure la situation intérieure de cet empire menaçait davantage ruine.
131 je connaissais mieux cette situation que la « diplomatie u dite officielle qui, comme presque toujours, marchait en aveugle à son destin. Les sentiments du peuple ne pouvaient refléter, en effet, ce que l'on donnait en pâture, en haut lieu, à l' « opinion publique ». Et en haut lieu, on avait pour l' « allié » le même culte que pour le Veau d'or. On pensait peut-être remplacer par de l'amabilité ce qui manquait de sincérité. Et l'on prenait toujours les mots pour de l'argent comptant.
Déjà la colère me prenait, à Vienne, quand je considérais la différence qui apparaissait parfois entre les discours officiels des hommes d'Etat et les articles des journaux viennois. Encore Vienne était-elle une ville allemande au moins en apparence. Mais quel changement lorsque, loin de Vienne ou mieux, loin de l'Autriche allemande, on arrivait dans les provinces slaves de l'Empire ! Il suffisait de jeter un coup d'œil sur les journaux de Prague pour savoir comment on jugeait là-bas toute cette comédie de la Triplice. Il n'y avait pour ce « chef-d'œuvre de diplomatie n que dérision et sanglante ironie. En pleine paix, alors même que les deux empereurs échangeaient le baiser d'amitié, on ne dissimulait nullement que l'alliance serait dénoncée le jour où l'on chercherait à la faire descendre du domaine imaginaire de l'idéal des Niebelungen dans la réalité pratique.
Comment donc a-t-on pu s'étonner, quelques années plus tard, lorsque, venue l'heure où les alliances devaient être réalisées, l'Italie se retira brutalement de la Triplice, plantant là ses deux alliés, et passa même à l'ennemi. Que l'on ait pu croire auparavant une seule minute à ce miracle que l'Italie combattrait aux côtés de l'Autriche,. paraissait purement incompréhensible à quiconque n'était pas frappé d'aveuglement diplomatique. Telle était pourtant l'exacte situation en Autriche.
Les Habsbourg et les Allemands soutenaient seuls dans ce pays l'idée de l'alliance. Les Habsbourg par calcul .. et par nécessité, les Autrichiens allemands en toute bonne foi... et en toute stupidité politique. En toute bonne foi, parce qu'ils pensaient, par la Triplice, rendre un grand service à l'empire allemand, le forti6er et lui porter secours ; par stupidité politique aussi, non seulement parce que leur espoir était irréalisable, mais aussi parce qu'ils contribuaient
132 ainsi à enchaîner le Reich à ce cadavre d'Etat, qui allait les entraîner avec lui à l'abîme. Surtout, du fait même de cette alliance, les Autrichiens allemands étaient plus fatalement encore voués à la dégermanisation. En effet, outre que les Habsbourg croyaient pouvoir être assurés par l'alliance avec le Reich contre une invasion de ce côté - et malheureusement ils pouvaient l'être à bon droit - il leur était de ce fait plus facile et moins dangereux de poursuivre leur politique intérieure de refoulement du germanisme. Ce n'est pas seulement parce qu'avec l' « objectivité » bien connue, on n'avait pas à craindre de protestation de la part du gouvernement du Reich, mais aussi parce qu'en faisant en toute occasion montre de l'alliance, on pouvait imposer silence aux voix indiscrètes qui s'élevaient parmi les Autrichiens allemands eux-mêmes contre un mode par trop infâme de slavisation.
Que restait-il donc à faire à l'Allemand en Autriche, alors que l'Allemagne du Reich elle-même reconnaissait le gouvernement des Habsbourg et lui exprimait sa confiance ? Devait-il résister pour être ensuite marqué d'infamie aux yeux de tous les Allemands comme traître à son propre peuple ? Lui qui précisément avait, depuis des dizaines d'années, consenti pour lui les sacrifices les plus fabuleux !
Mais que vaudrait cette alliance le jour où le germanisme aurait été extirpé de la monarchie des Habsbourg ? Est-ce que la valeur de la Triplice pour l'Allemagne ne dépendait pas directement du maintien de la prépondérance allemande en Autriche ? Ou bien, croyait-on réellement pouvoir vivre allié à un empire slave des Habsbourg ?
La position prise par la diplomatie officielle allemande, ainsi que par toute l'opinion publique, dans le problème des nationalités à l'intérieur de l'Autriche, n'était donc pas seulement stupide mais purement insensée : on bâtissait sur une alliance l'avenir et la sécurité d'un peuple de 70 millions d'âmes, et on assistait d'année en année à la destruction certaine, systématique et délibérée de la part du partenaire, de la seule base possible pour cette alliance. Il resterait donc un jour un « traité » avec la diplomatie viennoise, mais rien comme aide effective d'allié de l'empire.
Pour l'Italie, tel était d'ailleurs le cas depuis le début.
Si, en Allemagne, on avait seulement étudié un peu plus
134 clairement l'histoire et la psychologie des peuples, on n'aurait pu croire à aucun moment que le Quirinal et le Palais impérial de Vienne pussent jamais aller côte à côte au combat. L'Italie entière eut été un volcan, avant qu'un gouvernement ait pu seulement essayer de pousser un seul soldat italien autrement qu'en adversaire sur le champ de bataille de l'Etat des Habsbourg si fanatiquement haï. Plus d'une fois j'ai vu éclater à Vienne le mépris passionné et la haine intense avec laquelle l'Italien était soi-disant « attaché » à l'Etat autrichien. Les fautes de la maison des Habsbourg contre la liberté et l'indépendance italiennes au cours des siècles étaient trop grandes pour pouvoir être oubliées, l'eût-on voulu. Et cette volonté faisait tout à fait défaut, aussi bien dans le peuple que dans le gouvernement italien. De ce fait, il n'y avait pour l'Italie que deux modi vivendi avec l'Autriche : l'alliance ou la guerre.
Tout en choisissant le premier, on pouvait tranquillement se préparer au second.
Depuis surtout que les rapports de l'Autriche et de la Russie tendaient de plus en plus vers une explication par les armes, la politique allemande d'alliances était aussi dépourvue de sens que dangereuse.
Cas classique d'absence de toute diplomatie juste et de quelque ampleur.
Pourquoi surtout concluait-on une alliance ? C'était seulement dans le but d'assurer ainsi l'avenir du Reich mieux qu'il ne l'aurait seul et livré à lui-même. Cet avenir du Reich se ramenait à maintenir les possibilités d'existence du peuple allemand.
La question ne pouvait donc s'énoncer qu'ainsi : quelle forme doit prendre, dans un avenir palpable, la vie de la nation allemande, et comment peut-on ensuite assurer à ce développement les fondements nécessaires et la sécurité requise, dans le cadre des relations générales des puissances européennes ?
En considérant clairement les prévisions d'activité extérieure de la politique allemande, on ne pouvait manquer de se convaincre de ceci :
La population de l'Allemagne augmente chaque année de près de 900.000 âmes. La difficulté de nourrir cette armée de nouveaux citoyens doit s'accroître d'année en année et finir un jour par une catastrophe, si on n'arrive pas
134 â trouver les voies et moyens de prévenir en temps utile ce danger de famine.
Il y avait quatre moyens d'éviter une éventualité aussi effroyable.
1° On pouvait, suivant l'exemple français, restreindre artificiellement l'accroissement des naissances et prévenir ainsi le surpeuplement.
Certes la nature elle-même prend soin, aux époques de disette ou de mauvaises conditions climatiques, ou dans les régions à sol pauvre, de limiter l'accroissement de la population pour certains pays ou certaines races. D'ailleurs avec une méthode aussi sage que décisive, elle ne fait pas obstacle à la faculté procréatrice proprement dite, mais à la subsistance de l'individu procréé, soumettant celui-ci à des épreuves et des privations si dures que tout ce qui est moins fort, moins sain, est forcé de rentrer dans le néant. Ceux à qui elle permet toutefois de surmonter les rigueurs de l'existence sont à toute épreuve, rudes et bien aptes à engendrer à leur tour, afin que la même sélection fondamentale puisse recommencer. La nature en procédant ainsi brutalement à l'égard de l'individu, et en le rappelant à elle instantanément s'il n'est pas de taille à affronter la tourmente de la vie, maintient fortes la race et l'espèce et atteint aux plus hautes réalisations.
Ainsi la diminution du nombre rend plus fort l'individu, donc, en fin de compte, l'espèce.
Il en est autrement lorsque l'homme se met en devoir de limiter sa progéniture. Il n'est pas taillé du même bois que la nature, il est « humain » ; il s'y entend mieux qu'elle, cette impitoyable reine de toute sagesse ! Il ne met pas d'obstacles au développement de l'individu procréé, mais bien à la reproduction elle-même. A lui qui ne voit jamais que sa personne, et jamais la race, cela semble plus humain et plus juste que la méthode inverse. Malheureusement, les suites aussi sont inverses :
Tandis que la nature, tout en laissant les hommes libres de procréer, soumet leur descendance à une très dure épreuve - et parmi les individus en surnombre choisit les meilleurs comme dignes de vivre, les garde seuls et les charge de conserver l'espèce - l'homme limite la procréation, mais s'obstine, par contre, à conserver à tout prix tout être, une fois né. Ce correctif à la volonté divine
135 lui semble aussi sage qu'humain, et il se réjouit, ayant sur ce nouveau point vaincu la nature, d'en avoir bien prouvé l'insuffisance. Que le nombre soit vraiment limité, mais qu'en même temps la valeur de l'individu soit amoindrie, le cher petit singe du Père éternel ne s'en apercevra qu'à contre-cœur.
Car aussitôt que la faculté procréatrice proprement dite se trouve limitée et que le chifFre des naissances se trouve diminué - à la place de la lutte naturelle pour la vie, qui ne laisse subsister que les plus forts et les plus sains - se trouve instaurée, cela va de soi, cette manie de « sauver » à tout prix les plus malingres, les plus maladifs ; noyau d'une descendance qui sera de plus en plus pitoyable, tant que la volonté de la nature sera ainsi bafouée.
L'aboutissement, c'est qu'un jour l'existence sur cette terre sera ravie à un tel peuple ; car l'homme ne peut braver qu'un certain temps la loi éternelle selon laquelle l'espèce se perpétue, et la revanche vient tôt ou tard. Une race plus forte chassera les races faibles, car la ruée finale vers la vie brisera les entraves ridicules d'une prétendue humanité individualiste pour faire place à l'humanité selon la nature, qui anéantit les faibles pour donner leur place aux forts.
Quiconque veut donc assurer l'existence du peuple allemand, en limitant volontairement l'accroissement de sa population, lui enlève par là-même tout avenir.
2° Une deuxième voie serait celle que nous entendons aujourd'hui encore proposer et vanter maintes fois : la « colonisation intérieure ». C'est là un projet qui est le plus prôné par les gens qui le comprennent le moins, et qui est susceptible de causer les pires dégâts imaginables.
Sans doute peut-on augmenter le rapport d'un sol jusqu'à une limite déterminée. Mais jusqu'à une limite déterminée seulement, et pas indéfiniment. Pendant un certain temps, on pourra donc sans danger de famine compenser l'accroissement de population du peuple allemand par l'accroissement du rapport de notre sol. Il faut tenir compte cependant du fait que les besoins croissent en
général plus vite que le nombre des habitants. Les besoins des hommes en nourriture et vêtements augmentent d'année en année, et ne sauraient déjà plus être comparés à ceux de nos devanciers d'il y a quelque cent ans. Il est
136 donc fou de penser que chaque augmentation de la production autorise l'hypothèse d'un accroissement de la population : non, ce n'est vrai que dans la mesure où le surplus des produits du sol n'est pas employé à satisfaire les besoins supplémentaires des hommes. Mais même en supposant la restriction maximum d'une part et le zèle le plus laborieux de l'autre, là aussi on arrivera cependant à une limite, fonction du territoire lui-même. Malgré tout le travail possible, on ne pourra plus, à un moment donné, lui faire produire davantage, et ce sera alors, tôt ou tard, l'aboutissement fatal. La famine apparaîtra d'abord de temps en temps, après les mauvaises récoltes, etc. Avec une population en voie d'accroissement, elle sera de plus en plus fréquente, puis elle ne cessera plus qu'à l'occasion d'années exceptionnellement riches remplissant les greniers ; le temps viendra enfin où la misère ne pourra plus être soulagée, et où la faim sera la compagne éternelle de ce peuple. Il faudra alors que la nature intervienne et fasse son choix de ceux qui seront élus pour vivre ; ou bien l'homme s'aidera lui-même, limitant artificiellement sa reproduction, et encourant toutes les suites fâcheuses déjà indiquées pour la race et l'espèce.
On pourra objecter que cette éventualité atteindra un jour, d'une manière ou d'une autre, l'humanité entière et qu'aucun peuple ne saurait donc échapper à ce destin.
C'est exact à première vue. On peut cependant réfléchir à ceci :
Il est certain qu'un jour viendra où l'humanité, ne pouvant plus faire face aux besoins de sa population croissante par l'augmentation du rendement du sol, devra limiter l'accroissement du nombre des humains. Elle laissera la nature se prononcer, ou bien elle essaiera d'établir elle-même un équilibre : par des moyens plus appropriés que les moyens actuels, espérons-le ; mais alors tous les peuples seront touchés, tandis que maintenant seules sont atteintes les races qui n'ont plus assez de force pour s'assurer le sol qui leur est nécessaire en ce monde. Car les choses sont pourtant telles que, à notre époque, il y a encore d'immenses étendues de sol inutilisé, sol qui n'attend que d'être exploité. Et il est sûr aussi que ce sol n'a pas été conservé par la nature comme territoire réservé dans les temps à venir à une nation ou à une race déterminées.
137 Il est certain, au contraire, qu'il est destiné au peuple qui aura la force de le prendre et 1'activité nécessaire à son exploitation.
La nature ne connaît pas de frontières politiques. Elle place les êtres vivants les uns à côté des autres sur le globe terrestre, et contemple le libre jeu des forces. Le plus fort en courage et en activité, enfant de prédilection de la nature, obtiendra le noble droit de vivre.
Si un peuple se cantonne dans la « colonisation intérieure », tandis que d'autres races s'implantent sur des parties toujours plus étendues du globe, il sera forcé de recourir à la limitation volontaire, alors que les autres peuples continueront encore à s'accroître en nombre. Ce cas se présente d'autant plus tôt que l'espace à la disposition de ce peuple se trouve plus réduit. Comme, malheureusement, les meilleures nations - plus exactement les seules races civilisatrices, base de tout le progrès humain - renoncent trop souvent dans leur aveuglement pacifiste à de nouvelles acquisitions territoriales, et se contentent de « colonisation intérieure », alors que des nations de moindre valeur savent s'assurer la possession de territoires de peuplement, cela conduit au résultat final suivant :
Les races de plus haute civilisation, mais moins dépourvues de scrupules, doivent déjà réduire, par suite de leur territoire limité, leur accroissement à un moment où des peuples de moins haute civilisation, mais plus brutaux de nature, se trouvent, grâce à de vastes territoires de peuplement, en mesure de se développer en nombre sans souci de limitation. En d'autres termes, il adviendra qu'un jour le monde sera aux mains d'une humanité de moins haute culture, mais plus énergique. .
Il ne s'offrira donc dans l'avenir que deux possibilités : ou bien le monde sera régi par les conceptions de notre démocratie moderne, et alors la balance penchera en faveur des races numériquement les plus fortes ; ou bien le monde sera régi suivant les lois naturelles : alors vaincront les peuples à volonté brutale, et non ceux qui auront pratiqué la limitation volontaire.
Personne ne peut mettre en doute que l'existence de l'humanité ne donne lieu un jour à des luttes terribles. En fin de compte, l'instinct de conservation triomphera seul, instinct sous lequel fond, comme neige au soleil de
138 mars, cette prétendue humanité qui n'est que l'expression d'un mélange de stupidité, de lâcheté et de pédantisme suffisant. L'humanité a grandi dans la lutte perpétuelle, la paix éternelle la conduirait au tombeau.
Pour nous Allemands, les mots de « colonisation intérieure p sont néfastes, fortifiant en nous l'idée que nous avons trouvé un moyen de gagner notre vie par le travail dans un doux assoupissement. Une fois cette théorie ancrée chez nous, ce sera la fin de tout effort pour nous assurer dans le monde la place qui nous revient. Si l'Allemand moyen acquérait la conviction de pouvoir assurer par ce moyen son existence et son avenir, c'en serait fait de tout essai de défense active et par là-même seule féconde, c'en serait fait des nécessités vitales allemandes. Toute politique extérieure vraiment utile serait enterrée et, avec elle, surtout, l'avenir du peuple allemand.
Aussi n'est-ce pas un effet du hasard que ce soit toujours le Juif qui essaie surtout d'implanter cette mentalité funeste dans notre peuple ; et il s'y entend. Il s'y connaît trop bien en hommes pour ignorer qu'ils sont les victimes reconnaissantes de tous les songe-creux qui leur font croire que le moyen est trouvé de donner à la nature une chiquenaude qui rende superflue la dure et impitoyable lutte pour la vie et fasse d'eux, au contraire, soit par le travail, soit par la simple fainéantise, soit par tout autre moyen, les maîtres de la planète.
On ne saurait trop insister sur le fait qu'une colonisation intérieure: allemande ne doit servir surtout qu'à éviter les anomalies sociales - et avant tout à soustraire le sol à la spéculation - mais que jamais elle ne suffira à assurer l'avenir de la nation sans l'acquisition de nouveaux territoires.
Si nous agissions autrement, nous serions sous peu à bout de sol, et à bout de forces.
Enfin, il faut encore bien établir ceci :
La limitation qui résulte de la colonisation intérieure sur un petit territoire déterminé, tout comme la restriction de la faculté procréatrice, conduisent à la situation militaire et politique la plus défavorable pour une nation.
L'importance territoriale d'un pays est, à elle seule, un facteur essentiel de sécurité extérieure. Plus est grand le territoire dont dispose un peuple, plus est grande aussi sa protection naturelle ; on obtient toujours des décisions
139 militaires plus rapides, et aussi plus faciles, plus efficaces et plus complètes, contre les peuples occupant un territoire restreint ; ce serait le contraire contre des Etats au domaine territorial plus étendu. En outre, l'étendue de celui-ci constitue une protection certaine contre des attaques non poussées à fond, le succès ne pouvant être obtenu qu'après de longs et durs combats, et le risque d'un coup de main à l'improviste devant apparaître trop grand s'il n'y a pas des raisons tout à fait exceptionnelles de le tenter.
L'importance territoriale proprement dite d'un Etat est ainsi, à elle seule, un facteur du maintien de la liberté et de l'indépendance d'un peuple ; tandis que l'exiguïté territoriale provoque l'invasion.
Aussi ces deux premiers moyens d'établir un équilibre, dans le cadre « national n du Reich, entre le chiffre croissant de la population et le territoire qui ne pouvait s'étendre, furent-ils en fait écartés. Les raisons de cette attitude étaient tout autres que celles que nous avons mentionnées plus haut : en ce qui concerne la limitation des naissances, on s'abstint en premier lieu pour certaines raisons morales ; quant à la colonisation intérieure, elle fut repoussée énergiquement, parce qu'on pressentait en elle une attaque contre la grande propriété, ensuite et surtout parce qu'on y voyait le prélude à un assaut général contre la propriété privée. Etant donné surtout la forme sous laquelle oxi préconisait cette « doctrine de salut », une telle hypothèse pouvait se soutenir.
Dans l'ensemble, à l'endroit du grand public, cette résistance n'était pas très opportune, et en tous cas elle n'allait nullement au cœur du sujet.
Ainsi il ne restait plus que deux voies pour assurer le pain et le travail à la population toujours croissante.
3° On pouvait soit acquérir de nouveaux territoires, pour y pousser chaque année les millions d'habitants en surnombre, et obtenir ainsi que la nation continuât à s'assurer à elle-même sa propre subsirtance.
4° Ou bien passer outre, pour amener à notre industrie et à notre commerce la clientèle de l'étranger, en assurant notre existence grâce à ces profits.
Autrement dit : soit une politique territoriale, soit une politique coloniale et commerciale.
Ces deux voies furent considérées de divers points de
140 vue, examinées, préconisées, combattues, jusqu'à ce que l'on choisît définitivement la dernière.
La voie la plus saine des deux eût été certainement la première.
L'acquisition de territoires nouveaux à coloniser par l'excédent de notre population, possède des avantages infiniment nombreux, surtout quand on considère non le présent mais l'avenir.
Tout d'abord on ne saurait trop priser la possibilité de conserver une classe paysanne saine comme base de toute la nation. Beaucoup de nos maux actuels ne sont que la conséquence du rapport faussé entre les populations urbaine et rurale. Une solide souche de petits et moyens paysans fut de tout temps la meilleure sauvegarde contre les malaises sociaux qui sont aujourd'hui les nôtres. C'est aussi la seule solution qui assure à une nation son pain quotidien dans le cadre d'une économie fermée. Industrie et commerce rétrogradent alors de leur situation prééminente et malsaine et s'articuler.t dans le cadre général d'une économie nationale où les besoins s'équilibreraient. Ils ne sont plus la base même, mais les auxiliaires de la subsistance de la nation. Quand leur rôle se borne à garder un juste rapport entre nos propres besoins et notre propre production dans tous les domaines, ils rendent à un certain degré la subsistance du peuple indépendante de l'étranger ; ainsi ils contribuent à assurer la liberté de l'Etat et l'indépendance de la nation, surtout aux jours d'épreuve.
Cependant une telle politique territoriale ne peut plus aujourd'hui s'exercer quelque part au Cameroun, mais bien presque exclusivement en Europe. Il faut se ranger avec calme et sang-froid à ce point de vue qu'il ne saurait être conforme à la volonté divine de voir un peuple posséder cinquante fois plus de territoire qu'un autre. Il n'est pas permis, dans ce cas, de se laisser écarter, par des frontières politiques, des limites du droit éternel. Si cette terre a réellement assez de place pour la vie de tous, qu'on nous donne donc le sol qui nous est nécessaire pour vivre.
Assurément, on ne le fera pas volontiers. Mais alors intervient le droit de chacun à lutter pour son existence ; et ce qui est refusé à la douceur, il appartient au poing de le conquérir. Si nos ancêtres avaient fait dépendre jadis leurs décisions de l'absurde mentalité pacifiste actuelle,
141 nous ne posséderions pas au total le tiers de notre sol national actuel, et le peuple allemand n'aurait plus à se soucier de son avenir en Europe 1 Non, c'est à leur attitude résolue dans la lutte pour l'existence que nous devons les deux marches de l'Est du Reich, et, en outre, cette force intérieure que constitue la grandeur territoriale de notre Etat et de notre peuple, grandeur qui d'ailleurs nous a seule permis de subsister jusqu'à ce jour.
Une autre raison encore fait que cette solution eût été la bonne :
Beaucoup d'Etats européens ressemblent aujourd'hui à des pyramides qui reposent sur leur pointe. Leur superficie européenne est ridiculement petite vis-à-vis de l'étendue exagérée de leurs colonies, de l'importance de leur commerce extérieur, etc. On peut dire : le sommet en Europe, la base dans le monde entier, à la différence des Etats-Unis qui ont leur base sur leur propre continent et ne touchent le reste du monde que par le sommet. C'est aussi là ce qui fait la force intérieure inouïe de cet Etat, et la faiblesse de la plupart des puissances coloniales européennes.
L'Angleterre même n'est pas une preuve contre ce que j'avance, car c'est trop facilement qu'on oublie en regard de l'empire britannique, l'existence du monde anglo-saxon. La position de l'Angleterre, du seul fait de sa communauté de culture et de langue avec les Etats-Unis, ne peut être nullement comparée à celle d'une puissance européenne quelconque.
Pour l'Allemagne, par suite, la seule possibilité de mener à bien une politique territoriale saine résidait dans l'acquisition de terres nouvelles en Europe même. Des colonies ne peuvent servir à ce but tant qu'elles ri apparaissent pas favorables au peuplement massif par des Européens. Mais on ne pouvait plus au dix-neuvième siècle obtenir de tels territoires coloniaux par voie pacifique. On ne pouvait même pas mener une telle politique coloniale sans une guerre sévère qu'il eût été plus opportun de livrer pour acquérir un territoire du continent européen, plutôt que des domaines extra-européens.
Une telle résolution une fois prise exige ensuite que l'on s'y consacre exclusivement. Ce n'est pas avec des demi-mesures et des hésitations que l'on réalise une tâche qui demande toute la volonté et toute l'énergie de chacun. Il
142 fallait aussi subordonner alors toute la politique du Reich à ce but exclusif ; il ne fallait pas se permettre un geste procédant d'autres considérations que de la connaissance de cette tâche et des moyens de l'accomplir.
Il fallait bien se rendre à l'évidence : seul le combat permettrait d'atteindre ce but, et c'est d'un œil froid et calme qu'il fallait considérer la course aux armements.
Tout l'ensemble des alliances devait être examiné de ce seul point de vue, et il fallait en estimer la valeur réelle. Voulait-on des territoires en Europe, cela ne pouvait être en somme qu'aux dépens de la Russie. Alors il eût fallu que le nouveau Reich suivît de nouveau la voie des anciens chevaliers de l'ordre teutonique, afin que l'épée allemande assurât la glèbe à la charrue allemande, et donnât ainsi à la nation son pain quotidien.
Pour une semblable politique, le seul allié possible en Europe était l'Angleterre.
C'est seulement avec l'Angleterre que l'on pouvait, une fois nos derrières assurés, entreprendre la nouvelle croisade des Germains. Notre droit n'y eut pas été moindre que celui de nos ancêtres. Aucun de nos pacifistes ne se refuse à manger le pain de l'Est, et pourtant c'est le glaive qui a ouvert le chemin à la charrue !
Pour se concilier les bonnes grâces de l'Angleterre, aucun sacrifice ne devait être trop grand. Il fallait renoncer aux colonies et à la puissance maritime, et épargner toute concurrence à l'industrie britannique.
Une position nette et sans réticences pouvait seule conduire à ce résultat : renoncer au commerce mondial et aux colonies ; renoncer à une flotte de guerre allemande ; concentrer toute la puissance de l'Etat sur l'armée de terre.
Le résultat aurait été certes une limitation momentanée, mais un avenir de grandeur et de puissance.
Il fut une période où l'Angleterre aurait laissé s'engager des négociations dans ce sens. Car elle aurait très bien compris que c'était pour l'Allemagne une nécessité, du fait de l'accroissement de sa population, de chercher un débouché quelconque, et qu'elle le trouverait avec le concours de l'Angleterre, en Europe ou, sans elle, dans le monde.
Il fallait au premier chef favoriser cette tendance quand, au début du siècle, Londres même chercha à se rapprocher
143 de l'Allemagne. Pour la première fois apparut alors l'état d'esprit dont nous pûmes observer au cours des dernières années les manifestations véritablement effrayantes. La pensée de devoir tirer les marrons du feu pour l'Angleterre nous impressionnait désagréablement ; comme si une alliance pouvait jamais reposer sur une autre base que sur une bonne affaire pour les deux parties. Et on en pouvait très facilement conclure une avec l'Angleterre. La diplomatie anglaise était bien trop rusée pour ignorer que tout avantage veut une contre-partie.
Que l'on se représente encore qu'une politique extérieure allemande avisée eut pris à son compte le rôle du Japon en 1904, et l'on peut à peine évaluer les conséquences qui en auraient découlé pour l'Allemagne.
La guerre mondiale n'aurait pas eu lieu.
Le sang versé en 1904 aurait épargné son décuple de 1914 à 1918.
Et quelle situation aurait aujourd'hui prise l'Allemagne dans le monde !
En tous cas, l'alliance avec l'Autriche était dès lors une ineptie.
Cet état-momie s'attachait à l'Allemagne non pour faire une guerre, mais pour maintenir une paix éternelle, que l'on utiliserait ensuite de façon fort avisée pour un anéantissement lent mais sûr du germanisme dans la monarchie.
Chose impossible encore que cette alliance, parce qu'il n était pas permis d'attendre une défense active des intérêts nationaux allemands, de la part d'un Etat qui n'avait même pas assez de force et d'esprit de décision pour enrayer la dégermanisation à l'intérieur de ses frontières. Si l'Allemagne ne possédait pas assez de sentiment national et de caractère pour arracher à l'impossible Etat des Habsbourg la disposition du destin de dix millions d'hommes de race allemande, on ne pouvait plus véritablement attendre que ce dernier prêtât la main à des plans largement conçus et téméraires. De l'attitude de l'ancien Reich dans la question autrichienne, on pouvait déduire celle qu'il aurait dans la lutte décisive pour toute la nation. En tous cas, on n'aurait pas dû permettre que d'année en année le germanisme fût plus opprimé, car la valeur d'allié de l'Autriche ne pouvait vraiment être assurée que par le maintien de l'élément allemand. Mais on s'écarta encore de cette voie.
144 On ne craignait rien tant que la lutte, et on levait y être contraint su moment le plus défavorable.
On voulait échapper su destin et ce fut en vain. On rêvait du maintien de la paix du monde, et on se réveilla devant la guerre mondiale.
Et ce rêve de paix était la principale raison pour laquelle on ne prit pas en considération cette troisième voie pour donner forme à l'avenir allemand. On savait qu'il n'y avait de territoires à gagner qu'à l'Est, on voyait le combat qu'ils nécessitaient, et l'on voulait cependant à tout prix la paix ; car, dès cette époque et depuis longtemps, la devise de la politique extérieure allemande n'était plus le maintien de la nation allemande par tous les moyens, mais bien plutôt le maintien de la paix universelle par tous les moyens. On sait le résultat !
Je reviendrai tout particulièrement sur ce point.
Restait donc la quatrième éventualité : industrie et commerce mondial, puissance maritime et colonies.
Un tel développement devait certes être atteint plus facilement et plus rapidement. C'est que coloniser un territoire est une chose longue, qui souvent dure des siècles ; c'est là précisément qu'il faut en voir sa force profonde : il ne s'agit point d'une flambée subite, mais d'une poussée à la fois graduelle, profonde et durable, à la différence d'un essor industriel, que quelques années peuvent « souffler », plutôt bulle de savon que puissance sans faille. On a plus tôt fait de bâtir une flotte que de bâtir des fermes avec des luttes opiniâtres, et d'y mettre des fermiers. Mais la flotte est aussi plus facile à anéantir.
Quand l'Allemagne pourtant s'engagea dans cette voie, on eût dû au moins se rendre compte que cette politique, elle aussi, conduirait un jour à la guerre. Des enfants seuls pouvaient croire qu'il leur suffirait de leur amabilité, de leur bonne grâce et de l'affirmation de leurs convictions pacifistes pour pouvoir aller chercher des bananes en dénommant cette opération « conquête pacifique des peuples », comme le disaient les bavards, avec emphase et onction, sans devoir donc recourir aux armes.
Non : si nous nous étions engagés dans cette voie, il était inévitable que l'Angleterre devînt un jour ou l'autre notre ennemie, et il eût été plus que stupide de s'indigner - mais quelle n'était pas notre ingénuité - le jour où
145 elle se serait permis de s'opposer à notre activité pacifique avec la brutalité d'un égoïsme violent.
Il est vrai que nous, hélas ! ne l'eussions jamais fait. Si nous ne pouvions poursuivre une politique de conquêtes territoriales en Europe autrement qu'en nous unissant à l'Angleterre contre la Russie, de même une politique coloniale et de commerce mondial n'était possible que contre l'Angleterre et avec la Russie. Mais, dans ce cas, il fallait adopter cette politique avec toutes ses conséquences, et surtout lâcher l'Autriche au plus vite. De quelque manière qu'on l'envisageât, cette alliance avec l'Autriche était déjà vers 1900 une véritable folie.
Mais on ne pensait pas le moins du monde à s'allier avec la Russie contre l'Angleterre, pas plus qu'on ne pensait à s'allier avec l'Angleterre contre la Russie, car la guerre en eût résulté dans les deux cas, et c'était pour l'empêcher qu'on s'engageait dans cette politique commerciale et industrielle. On pensait posséder dans la conquête « économique et pacifique » du monde une méthode d'action qui devait, une fois pour toutes, tordre le cou à toute politique de force. De cela, on n'était peut-être pas toujours très sûr, surtout quand, de temps en temps, venaient d'Angleterre des menaces tout à fait incompréhensibles. C'est pourquoi on se décida à construire une flotte, mais nullement dans l'intention d'attaquer ou de détruire l'Angleterre, au contraire pour défendre cette « paix mondiale » et poursuivre la conquête « pacifique » du monde. C'est pour cela qu'on créa cette flotte modeste sous tous les rapports, non seulement en ce qui concernait le nombre et le tonnage des vaisseaux, mais aussi l'armement, pour laisser percer de nouveau, en fin de compte, l'intention « pacifique ».
Les bavardages relatifs à une conquête « économique et pacifique n du monde ont été le non-sens le plus complet qui ait jamais été érigé en principe directeur de la politique d'un Etat. Ce non-sens apparaît plus flagrant si l'on considère qu'on n'hésitait pas à désigner l'Angleterre elle-même comme l'exemple le plus probant de la possibilité d'une telle conquête. Ce que notre doctrine et notre conception professorales de l'histoire ont gâché sous ce rapport, est à peine réparable st c'est une preuve éclatante de ce fait, que bien des hommes « apprennent » l'histoire sans y rien comprendre. On eût dû reconnaître que justement l'Angle-
146 terre est l'exemple frappant de la théorie opposée, car aucun peuple n'a mieux ni plus brutalement préparé ses conquêtes économiques par l'épée, et ne les a défendues ensuite plus résolument. N'est-ce pas justement la caractéristique de l'art politique anglais que le fait qu'il sait tirer de sa force politique des conquêtes économiques et inversement, transformer tout succès économique en puissance politique ? En outre, quelle erreur de croire que l'Angleterre elle-même était trop lâche pour verser son propre sang en faveur de son expansion économique I Le fait que l'Angleterre ne possédait pas d'armée « nationale n ne le prouvait nullement ; ce qui importe dans ce cas ce n'est pas la structure militaire momentanée de l'armée, mais la volonté et la décision d'engager l'armée qu'on possède. L'Angleterre a toujours eu l'armement dont elle avait besoin. Elle a toujours eu, pour combattre, les armes qui étaient nécessaires pour vaincre. Elle a envoyé au combat des mercenaires aussi longtemps que des mercenaires suffirent ; mais elle sut toujours puiser jusqu'aux profondeurs du sang Ie plus précieux de sa nation, quand, seul, un tel sacrifice pouvait donner la victoire ; dans tous les cas, la volonté de combat, la ténacité et la conduite brutale des opérations restèrent les mêmes.
Mais en Allemagne on avait peu à peu créé par les écoles, la presse et les journaux satiriques, une idée de l'Anglais et plus encore si possible de son empire, telle qu'elle devait aboutir à une de nos pires déceptions ; peu à peu cette idée fausse se répandit partout comme une contagion, et la conséquence en fut une sous-estimation que nous expiâmes cruellement. Cette illusion fut si profonde qu'on était persuadé que l'Anglais n'était qu'un homme d'affaires aussi roué qu'incroyablement lâche personnellement. Nos distingués professeurs de didactique n'imaginaient aucunement qu'un empire mondial aussi vaste que celui de l'Angleterre ne pouvait avoir été acquis par des ruses et des subterfuges. Les gens, peu nombreux, qui mettaient en garde contre cette erreur, n'étaient pas écoutés ou on les réduisait su silence. Je me rappelle encore nettement quelles mines étonnées firent mes camarades quand les tommies se trouvèrent face à nous en Flandre. Dès les premières journées de combat, chacun commença à se douter que ces Ecossais ne ressemblaient nullement à ceux
147 qu'on avait cru bon de nous dessiner dans les feuilles humoristiques et les communiqués.
J'ai fait à cette occasion mes premières observations sur l'utilité de certaines formes de propagande.
Cette illusion procurait certes quelques avantages à ceux qui la propageaient : on pouvait utiliser cet exemple - bien que faux - pour démontrer la possibilité d'une conquête économique du monde. Ce qui avait réussi à l'Anglais devait nous réussir aussi ; et même un avantage particulier nous était conféré par notre probité sensiblement plus élevée, par notre manque de cette perfidie spécifiquement anglaise. Et on espérait par là gagner d'autant plus facilement la sympathie des petites nations et la confiance des grandes.
Que notre probité fût pour les autres un objet de profonde aversion, nous ne le comprenions point, parce que nous y croyions sérieusement nous-mêmes, tandis que le reste du monde ne voyait dans notre conduite que l'expression d'un raffinement d'hypocrisie, jusqu'à ce que la révolution lui permît d'entrevoir, à son plus grand étonnement sans doute, toute la profondeur de notre psychologie, sincère jusqu'à une bêtise sans limites.
Seul, le non-sens de cette conquête « économique pacifique » du monde peut faire comprendre aussitôt, dans toute sa clarté, cet autre non-sens de la Triplice.
Avec quel Etat pouvait-on donc s'allier ? Avec l'Autriche, on ne pouvait entreprendre une guerre de conquêtes, même en Europe. C'est là que résidait la faiblesse innée de cette alliance. Un Bismarck pouvait se permettre de recourir à ce pis-aller, mais aucun de ses successeurs malhabiles ne le pouvait plus et encore moins à une époque où les bases essentielles de l'alliance conclue par Bismarck n'existaient plus : car Bismarck pouvait encore voir dans l'Autriche un Etat allemand. Mais l'introduction graduelle du suffrage universel avait abaissé ce pays régi suivant les règles parlementaires à un état chaotique n'ayant plus rien d'allemand.
Du point de vue d'une politique ethnique également, l'alliance avec l'Autriche était simplement funeste. On tolérait aux côtés du Reich la formation d'une nouvelle grande puissance slave, qui devait tôt ou tard se tourner contre l'Allemagne bien autrement que ce ne fut le cas, par exemple, pour la Russie. L'alliance devait se pourrir et s'affaiblir d'année en année, à mesure que faiblirait dans
148 la monarchie danubienne l'influence des pangermanistes, que l'on écartait de toutes les situations primordiales.
L'alliance de l'Allemagne avec l'Autriche était déjà entrée vers 1900 dans la même phase que l'alliance de l'Autriche avec l'Italie.
Là aussi une seule alternative : ou bien on était l'allié de la monarchie des Habsbourg, ou bien on devait élever une protestation contre l'oppression du germanisme en Autriche. Mais quand on s'engage dans une pareille voie, la lutte ouverte en résulte dans la plupart des cas.
La valeur de la Triplice n'était que modeste déjà su point de vue psychologique, car la solidité d'une alliance tend à diminuer dans la mesure où elle se réduit de plus en plus au maintien d'un état de choses existant. Une alliance, au contraire, devient d'autant plus forte que les parties contractantes comptent atteindre par ce moyen des buts d'expansion déterminés et accessibles. Dans ce cas aussi, la force n est pas dans la résistance, mais dans l'attaque.
C'est une chose qui fut reconnue alors de divers côtés, malheureusement pas dans les milieux dits « professionnels ».
Ce fut surtout Ludendorff, à cette époque colonel attaché au grand état-major, qui indiqua tous ces côtés faibles dans un mémoire, en 1912. Naturellement, les « hommes d'Etat » n'y attachèrent aucune importance ni aucune valeur ; en général, la raison ne semble apparaître efficacement que chez les simples mortels, et elle disparaît en principe aussitôt qu'il s'agit de « diplomates ».
Pour 1'Allemagne, ce fut encore heureux que la guerre en 1914 éclatât par la voie détournée de l'Autriche et que les Habsbourg, en conséquence, ne pussent se dérober ; si la guerre était survenue d'une autre façon, l'Allemagne eût été seule. L'Etat des Habsbourg n'aurait jamais pu, ni même jamais voulu, prendre part à une lutte qui se serait engagée du fait de l'Allemagne. Ce qu'on blâma tant, plus tard, dans le cas de l'Italie, se serait produit avec l'Autriche; elle serait restée « neutre » pour préserver su moins l'Etat d'une révolution tout au début de la guerre. Les Slaves d'Autriche eussent brisé la monarchie en 1914, plutôt que de lui permettre de porter secours à l'Allemagne. Mais bien peu nombreux furent à cette époque ceux qui purent comprendre tous les dangers et toutes les aggravations de
149 difficultés qui résultaient de l'alliance avec la monarchie danubienne.
En premier lieu, l'Autriche avait trop d'ennemis qui espéraient recueillir l'héritage de cet Etat décrépit, pour que ceux-ci ne finissent pas par éprouver une certaine animosité contre l'Allemagne, considérée comme l'obstacle au démembrement de la monarchie, attendu et espéré de tous côtés. On arriva à la conclusion qu'on ne pouvait parvenir jusqu'à Vienne qu'en passant par Berlin.
En second lieu, l'Allemagne perdit de ce fait les meilleures et les plus prometteuses de ses possibilités d'alliance. Au contraire, en leur lieu et place on observa une tension croissante dans les rapports avec la Russie et même avec l'Italie. Car, à Rome, l'état d'esprit général était favorable à l'Allemagne, mais l'hostilité envers l'Autriche sommeillait - et même parfois flambait - dans le cœur du dernier des Italiens. Du moment qu'on s'était engagé dans une politique commerciale et industrielle, on ne pouvait trouver le moindre motif pour une guerre contre la Russie. Seuls, les ennemis des deux nations pouvaient y trouver un grand intérêt. Ce furent en fait d'abord les Juifs et les marxistes qui poussèrent par tous les moyens à la guerre entre les deux Etats.
En troisième lieu, enfin, cette alliance comportait nécessairement un danger permanent pour l'Allemagne, parce qu'il était toujours facile à un Etat effectivement hostile au Reich de Bismarck de mobiliser toute une série d'Etats contre l'Allemagne, en leur promettant à tous I'enrichissement aux frais de son allié autrichien.
On pouvait mettre en branle contre la monarchie danubienne toute l'Europe orientale, mais surtout la Russie et l'Italie. La coalition mondiale qui se formait sous l'influence directrice du roi Edouard ne serait jamais devenue un fait accompli si cet allié de l'Allemagne, l'Autriche, n'eût constitué un héritage aussi attrayant. De ce fait seulement, il devint possible d'entraîner dans le même front offensif des Etats animés de désirs et poursuivant des buts aussi hétérogènes. Chacun pouvait espérer, au cours d'une attaque générale contre l'Allemagne, s'enrichir aux frais de l'Autriche. Et le fait que la Turquie, elle aussi, faisait tacitement partie de cette alliance de malheur, augmentait encore ce danger dans des proportions extraordinaires.
150 La finance juive internationale avait besoin de cet appât pour mener à bien son projet longtemps caressé d'une destruction de l'Allemagne, qui n'était pas encore soumise au contrôle financier et économique général de ce super-Etat. Ce n'est qu'ainsi qu'on put souder la coalition que, seul, rendait forte et courageuse le nombre de ses millions de soldats, prête enfin pour un corps à corps avec le Siegfried « cornu (1) ».
L'alliance avec la puissance des Habsbourg, qui me remplissait déjà en Autriche de mécontentement, me causa de longues épreuves intérieures, qui renforcèrent encore par la suite mon opinion déjà arrêtée.
Je ne cachais pas, dans les cercles restreints que je fréquentais, ma conviction que ce malencontreux traité avec un Etat voué à la perte conduirait aussi l'Allemagne à un effondrement catastrophique si elle ne s'en dégageait à temps. Je ne fus pas ébranlé, même un instant, dans cette conviction profonde, quand enfin la tempête de la guerre mondiale parut éliminer toute considération raisonnable, et que le vertige de l'exaltation s'empara même des centres qui n'auraient dû être accessibles qu'au réalisme le plus froid. Même quand je me trouvai au front, chaque fois que j'eus l'occasion de discuter ces problèmes, j'émis l'opinion qu'il fallait, dans l'intérêt de la nation allemande, rompre l'alliance et que le plus tôt serait le mieux ; que l'abandon de la monarchie des Habsbourg ne serait pas un sacrifice, si l'Allemagne pouvait par là réduire le nombre de ses adversaires ; car ce n'était pas pour maintenir une dynastie dégénérée, mais bel et bien pour le salut de la nation allemande que des millions d'hommes portaient le casque.
Plusieurs fois il sembla avant guerre que, dans un camp au moins, on commençât à émettre quelques doutes sur l'opportunité de la politique d'alliances adoptée : les milieux conservateurs allemands mirent plus d'une fois en garde contre une confiance excessive, mais comme pour tout avertissement raisonnable, autant en ernporta le vent. On était persuadé qu'on se trouvait sur la voie de la « conquête » du monde, dont les résultats seraient énormes, et où les
(1) Siegfried est appelé « cornu », parce que, dans la légende bien connue. il se couvrit d'une peau dure comme la corne quand il se baigna dans le sang du dragon. - S. O.
151 sacrifices seraient égaux à zéro. Et il ne restait encore une fois aux a profanes » qu'à observer en silence comment et pourquoi les u initiés n marchaient tout droit à leur perte, entraînant à leur suite le bon peuple, comme le chasseur de rats de Hameln.
* La raison plus profonde qui permettait de présenter le
non-sens d'une s conquête économique » comme système de politique pratique, et de donner pour but politique à tout un peuple le maintien de la « paix mondiale n, résidait dans un état général maladif de toute notre pensée politique.
Les triomphes de la technique et de l'industrie allemandes, les succès grandissants du commerce allemand, nous faisaient oublier de plus en plus que tout cela n était possible qu'avec, comme condition préalable, un Etat puissant. Au contraire, dans bien des milieux, on allait même jusqu'à affirmer la conviction que l'Etat lui-même doit son existence à ces phénomènes, qu'il est surtout une institution économique et qu'il dépend de l'économie dans sa constitution actuelle, ce qui était considéré et glorifié comme l'état de choses le plus normal et le plus sain.
Mais l'Etat n'a rien à faire avec une conception économique ou un développement économique déterminé ! Il n'est pas la réunion de parties contractantes économiques dans un territoire précis et délimité, ayant pour but l'exécution de tâches économiques ; il est l'organisation d'une communauté d'êtres vivants, pareils les uns aux autres au point de vue physique et moral, constituée pour mieux assurer leur descendance, et atteindre le but assigné à leur race par la Providence. C'est là, et là seulement, le but et le sens d'un Etat. L'économie n'est qu'un des nombreux moyens nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Elle n'est jamais ni la cause ni le but d'un Etat, sauf le cas où ce dernier repose a priori sur une base fausse, parce que contre nature. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer le fait que l'Etat, en tant que tel, ne repose pas nécessairement sur une délimitation territoriale. Cette condition ne deviendra nécessaire que chez les peuples qui veulent assurer par leurs propres moyens la subsistance de leurs compagnons de race, c'est-à-dire chez ceux qui veulent mener à bien la lutte pour l'existence par leur propre travail. Les peuples
152 qui ont la faculté de se glisser comme des parasites dans l'humanité, afin de faire travailler les autres pour eux sous différents prétextes, peuvent former des Etats sans que le moindre territoire délimité leur soit propre. C'est le cas surtout pour le peuple dont le parasitisme fait souffrir toute l'humanité : le peuple juif.
L'Etat juif ne fut jamais délimité dans l'espace ; répandu sans limites dans l'univers, il comprend cependant exclusivement les membres d'une même race. C'est pour cela que ce peuple a formé partout un Etat dans l'Etat. C'est l'un des tours de passe-passe les plus ingénieux au monde que d'avoir fait naviguer cet Etat sous I'étiquette de « religion », et de lui assurer ainsi la tolérance que l'Aryen est toujours prêt à accorder à la croyance religieuse. En réalité, la religion de Moïse n'est rien d autre que la doctrine de la conservation de la race juive. C'est pour cela qu'elle embrasse aussi presque tout le domaine des sciences sociales, politiques et économiques qui peuvent s'y rapporter.
L'instinct de conservation de l'espèce est la première cause de la formation de communautés humaines. De ce fait, l'Etat est un organisme racial et non une organisation économique, différence qui est aussi grande qu elle reste incompréhensible surtout pour les soi-disant « hommes d'Etat » contemporains. C'est pour cela que ceux-ci pensent pouvoir construire l'Etat par des moyens économiques, tandis qu'en réalité il n'est éternellement que le résultat de l'exercice des qualités qui entrent dans la ligne de l'instinct de conservation de l'espèce et de la race. Et ces qualités sont toujours des vertus héroïques et non l'égoïsme mercantile, car la conservation de l'existence d'une espèce suppose qu'on est prêt à sacrifier l'individu. Tel est aussi le sens des paroles du poète :
Und setzet ihr nicht das Leben ein.
Nie wird euch das Leben gewonnen sein (1).
(Et si vous n'engagez pas votre vie elle-même, jamais vous ne la gagnerez, votre vie). Le sacrifice de l'existence individuelle est nécessaire pour assurer la conservation de la race. Ainsi, la condition essentielle pour la formation et
(1) SCHILLER, Wallenstein (« Camp de Wallenstein ». Chanson des cuirassiers).
153 le maintien d'un Etat, c'est qu'il existe un sentiment de solidarité sur la base d'une identité de caractère et de race, et qu'on soit résolu à le défendre par tous les moyens. Cela doit aboutir chez les peuples qui ont un territoire à eux à la formation de vertus héroïques, et chez les parasites à une hypocrisie mensongère et à une cruauté perfide, à moins qu'on admette que ces caractéristiques fussent innées, et que la différence des formes politiques n'en soit que la preuve évidente. Mais la fondation d un Etat doit toujours résulter, du moins au début, d'une manifestation de ces qualités ; et les peuples qui succombent dans la lutte pour l'existence, c'est-à-dire qui sont vassalisés et condamnés de ce fait à disparaître tôt ou tard, sont ceux qui montrent le moins de vertus héroïques dans cette lutte ou qui sont victimes de la ruse perfide des parasites. Et, même dans ce dernier cas, il ne s'agit généralement pas tant d'un manque d'intelligence que du manque de résolution et de courage, qui cherche à se cacher sous le couvert de sentiments humains.
Le fait que la force intérieure d'un Etat ne coïncide que très rarement avec le prétendu épanouissement économique, montre, de façon éclatante, combien les qualités constructrices et conservatrices des Etats sont peu liées à l'économie. L'épanouissement économique - d'innombrables exemples nous le montrent - paraît plutôt annoncer que le déclin de l'Etat est proche. Et si la formation des communautés humaines s'expliquait en premier lieu par l'action des forces ou des mobiles économiques, ce serait le développement économique maximum qui devrait signifier le summum de puissance de l'Etat et non l'inverse.
La croyance à la force économique pour la fondation ou la conservation des Etats paraît surtout incompréhensible, quand on la rencontre dans un pays où l'histoire à chaque pas démontre le contraire d'une façon claire et répétée. La Prusse surtout démontre, avec une précision prodigieuse, que ce ne sont pas les qualités matérielles, mais les seules vertus morales qui donnent les moyens de fonder un Etat. Ce n'est que sous leur protection que l'économie commence à fleurir, jusqu'au moment où elle s'effondre avec l'effondrement des pures capacités créatrices de l'Etat, développement que nous pouvons observer maintenant même d'une manière si affligeante. Cela a toujours été à l'ombre des
154 vertus héroïques qu'ont pu le mieux prospérer les intérêts matériels des hommes. Mais dès que ces derniers prétendent s'arroger la première place, ils détruisent eux-mêmes les conditions de leur propre existence.
Toutes les fois que la puissance politique de l'Allemagne a traversé une période ascendante, le niveau économique a aussi monté ; par contre, toutes les fois que l'économie seule a occupé la vie de notre peuple et a fait sombrer les vertus idéalistes, l'Etat s'est effondré et a entraîné en peu de temps l'économie dans sa perte.
Mais si on se demande quelles sont donc en réalité ces forces qui créent et qui conservent les Etats, on peut les réunir sous cette même désignation : l'esprit et la volonté de sacrifice de l'individu pour la communauté. Le fait que ces vertus n'ont rien de commun avec l'économie ressort de ce simple fait, que l'homme ne se sacrifie jamais pour celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas pour une affaire, mais pour un idéal. Rien ne prouve mieux la supériorité psychologique de l'Anglais en ce qui concerne la compréhension de l'âme du peuple que la raison qu'il a su donner de son entrée en guerre. Tandis que nous combattions pour notre pain, l'Angleterre luttait pour la « liberté » et même pas pour la sienne, mais pour celle des petites nations. Chez nous, on a ri de cette effronterie, ou bien on s'en est fâché, démontrant ainsi à quel point la diplomatie allemande était, déjà avant la guerre, dépourvue d'idées et stupide. On n'avait plus la moindre notion de ce qu'était cette force qui peut faire aller librement à la mort des hommes conscients et résolus.
Aussi longtemps que le peuple allemand crut, en 1914, combattre pour un idéal, il soutint la lutte ; quand on le fit se battre seulement pour le pain quotidien, il préféra abandonner le jeu.
Nos « hommes d'Etat », si pleins d'esprit, furent surpris de ce changement de mentalité. Ils ne comprirent jamais que l'homme, à partir du moment où il lutte pour un intérêt économique, évite la mort autant qu'il peut, car celle-ci le priverait pour toujours de jouir du fruit de la victoire. Le souci du salut de son enfant transforme la mère la plus faible en une héroïne, et ce ne fut, au cours des âges, que la lutte pour la conservation de la race et du foyer, ou de l'Etat qui la défend, qui jeta les hommes au devant des lances ennemies.
155 On peut proclamer la formule suivante comme une vérité éternelle :
Jamais un Etat ne fut fondé par l'économie pacifique, mais toujours il le fut par l'instinct de conservation de la race, que celui-ci s'exprimât dans le domaine de l'héroïsme ou dans celui de la ruse et de l'intrigue ; dans le premier cas, il en résulte des Etats aryens de travail et de culture, dans l'autre, des colonies parasitaires juives. Aussitôt que l'économie commence chez un peuple à étouffer cet instinct, elle devient elle-même la cause qui amène l'asservissement et l'oppression.
La foi qu'on avait avant guerre dans la possibilité pour le peuple allemand d'accaparer les marchés mondiaux ou même de conquérir le monde par la voie pacifique d'une politique commerciale et coloniale, ét3it un symptôme classique de la perte de toutes les vraies vertus qui forment et conservent l'Etat, et de toutes celles qui en découlent : discernement, force de volonté et décision dans l'action ; c'était dans les lois naturelles que la guerre mondiale avec toutes ses conséquences en fut le résultat.
Pour celui qui n'approfondit pas les questions, cette attitude de la nation allemande - car elle fut presque générale - dut paraître une énigme insoluble ; car c'est précisément l'Allemagne elle-même qui fut l'exemple le plus prodigieux d'un empire qui avait surgi sur les bases d'une pure politique de puissance. La Prusse, cette cellule génératrice du Reich, surgit d'un héroïsme rayonnant et non d'opérations financières ou d'affaires commerciales, et le Reich lui-même ne fut que la récompense la plus magnifique d'une politique orientée vers la puissance, et du courage de ses soldats.
Comment le peuple allemand put-il donc se trouver ainsi atteint dans son instinct politique ? Car il ne s'agissait pas là d'un phénomène isolé, mais de symptômes de décadence apparaissant de divers côtés en nombre vraiment effarant, tantôt parcourant le corps de la nation comme des feux follets, tantôt formant dans tel ou tel endroit des abcès qui rongeaient la chair de la nation. Il semblait qu'un flot incessant de venin était poussé par une force mystérieuse jusqu'aux dernières veines de ce corps jadis héroïque, entraînant à sa suite une paralysie croissante de la saine raison et de l'instinct de conservation le plus élémentaire.
156 Ayant passé en revue d'innombrables fois toutes ces questions qui avaient rapport à la politique allemande d'alliances et de la politique économique du Reich de 1912 à 1914, je ne trouvais comme seule explication possible que cette force que j'avais déjà appris à connaître à Vienne en me plaçant à un tout autre point de vue : la doctrine et la conception marxiste de la vie, ainsi que leur expression organisée.
Pour la seconde fois dans ma vie, je me plongeai dans l'étude de cette doctrine destructrice ; cette fois, il est vrai, ce ne furent pas les impressions et les influences de mon entourage quotidien qui m'y amenèrent, ce fut l'observation des phénomènes généraux de la vie politique. Tandis que je m'enfonçais de nouveau dans la littérature théorique de ce monde nouveau, et que je m'efforçais de voir clair dans ses conséquences possibles, je les comparai aux signes et manifestations réels que son action provoquait dans la vie politique, culturelle, et aussi économique.
Pour la première fois aussi je tournai mon attention vers les tentatives faites pour maîtriser cette peste mondiale. J'étudiai la législation exceptionnelle de Bismarck dans
sa conception, sa période de lutte, et ses résultats. Peu à peu j'assis sur une base solide comme un roc mes propres convictions en cette matière, de sorte que, depuis lors, je ne me suis jamais senti obligé de procéder à une réorientation de mes conceptions intimes sur ce point. Je soumis aussi à une nouvelle analyse approfondie les rapports entre le marxisme et la juiverie.
Si auparavant, de Vienne surtout, l'Allemagne m'avait paru un colosse inébranlable, des doutes inquiets commencèrent alors à surgir en moi. Je me mis à critiquer dans mon esprit et aussi dans le cercle restreint de mes relations, la politique extérieure allemande aussi bien que la façon incroyablement légère, selon moi, avec laquelle on traitait le problème le plus important qu'il y eût à cette époque en Allemagne, celui du marxisme. Je n'arrivais pas à comprendre, comment on pouvait aller aussi aveuglément au devant d'un danger dont les répercussions devaient être aussi terribles, comme le marxisme le promettait lui-même. J'élevais déjà à ce moment la voix dans mon entourage immédiat, ainsi fais-je maintenant en plus grand, contre le rabâchage endormant de tous les lâches pleurnichards :
157 « Il ne peut rien nous arriver ! » Une pareille peste mentale a déjà détruit jadis un empire gigantesque. Est-ce que l'Allemagne seule ne serait point soumise aux mêmes lois que toutes les autres communautés humaines ?
Dans les années 1913 et 1914, j'exprimai pour la première fois, dans différents cercles, dont une partie est maintenant au nombre des adeptes fidèles du mouvement national-socialiste, la conviction que le problème de l'avenir de la nation allemande, c'est le problème de la destruction du marxisme.
Je ne vis dans notre malencontreuse politique des alliances que l'une des conséquences amenées par l'action dissolvante de cette doctrine ; car, ce qui était le plus atroce, c'était que ce poison détruisait presque imperceptiblement toutes les bases d'une conception saine de l'économie et de l'Etat, sans que ceux qui en subissaient l'influence, se doutassent jusqu'à quel point toute leur activité et toute leur volonté n'étaient plus que l'expression de cette conception de vie, qu'ils repoussaient, d'autre part, de la façon la plus décidée.
La décadence intérieure du peuple allemand avait commencé déjà depuis longtemps, sans que les hommes - ainsi que cela arrive souvent dans la vie - aient découvert le destructeur de leur existence. On essaya parfois quelque cure contre la maladie, mais on confondit toujours ses formes extérieures avec ses causes. Comme on ne connaissait pas ces dernières, ou qu'on ne voulait pas les connaître, cette lutte contre le marxisme eut autant d'effet que les cures d'un charlatan guérisseur.
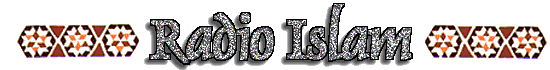
HOME
![]()
Svenska
![]()
English
![]()
German
![]()
French
![]()
French
![]()
English
![]()
German
![]()
Italian
![]()
Spanish.
![]()
Norsk
The Jewish
Plots!
Must
Germany
Perish?
A Jewish plan
for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her
people!
| English
|
French
|
Deutsch
| Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
|
English
|
French
|
Deutsch
|
Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
Italian
|
Danish
|