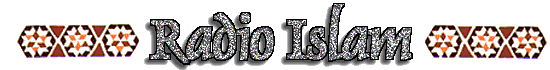
Mon Combat
ADOLF HITLER
7
La lutte contre le front rouge
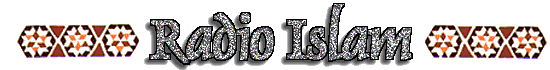
Mon Combat
ADOLF HITLER
7
La lutte contre le front rouge
En 1919-1920 et aussi en 1921, j'ai assisté moi-même à des réunions qu'on appelle bourgeoises. Elles produisirent toujours sur moi la même impression qu'une cuillerée d'huile de foie de morue dans ma jeunesse. On doit l'avaler, et cela est peut être très bon, mais le goût en est abominable ! Si on pouvait ligoter le peuple allemand avec des cordes, et le traîner de force à ces « manifestations » bourgeoises, tenir fermées toutes les portes jusqu'à la fin du spectacle et ne laisser sortir personne, alors, peut-être, en quelques siècles, arriverait-on au succès. Il est vrai que je dois avouer ouvertement que, dans ce cas, la vie n'aurait probablement aucun attrait pour moi, et que j'aurais alors préféré n'être plus un Allemand. Mais comme, Dieu merci ! il ne peut en être question, il ne faut pas s'étonner de ce que le peuple sain et non corrompu évite ces « réunions bourgeoises de masses u comme le diable l'eau bénite.
J'ai appris à les connaître, ces prophètes d'une conception bourgeoise de la vie, et je ne m'étonne vraiment pas, mais je comprends bien pourquoi ils n'attachent aucune importance à l'art oratoire. J'ai fréquenté alors les réunions des démocrates, des nationaux allemands, du parti populiste allemand et du parti populiste bavarois (centre bavarois). Ce qui sautait tout de suite aux yeux, c'était l'uniformité homogène des auditeurs. Ce n'étaient presque toujours que des membres du parti qui assistaient à la réunion. Le tout, sans discipline aucune, ressemblait plutôt à un club où on bâille en jouant aux cartes qu'à une réunion de gens venant de traverser la plus grande des révolutions. Le conférencier, de son côté, faisait tout son possible pour maintenir cette atmosphère languissante. Les orateurs
479 parlaient, ou plutôt ils lisaient à haute voix leurs discours, dans le style d'un article spirituel de journal ou dans celui d'une dissertation scientifique, ils évitaient toutes les expressions fortes et, proféraient çâ et là une plaisanterie professorale anodine, qui faisait rire obligeamment toute la table du vénérable bureau : non pas aux éclats, ce qui eût été provocant, mais en sourdine, avec réserve et distinction.
Oh ! ce bureau !
Je vis une fois une réunion dans la salle Wagner, à Munich ; c'était une manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la bataille des nations à Leipzig. Le discours fut lu par un vieux monsieur vénérable, professeur d'une université quelconque. Sur la tribune se tenait le bureau. Un monocle à gauche, un monocle à droite, et au milieu un monsieur sans monocle. Tous les trois en redingote : on avait l'impression d'un tribunal qui venait annoncer une condamnation à mort, ou bien d'un baptême solennel, en tout cas d'une cérémonie plutôt religieuse. Le prétendu discours, qui, imprimé, aurait peut-être été assez joli, produisait un effet simplement effroyable. Après trois quarts d'heure à peine, toute la réunion était plongée dans une sorte de sommeil hypnotique, troublé seulement quand un homme ou une femme sortait, ou par le bruit que faisaient les serveuses et par les bâillements de plus en plus fréquents des auditeurs. Trois ouvriers présents à cette réunion, soit par curiosité, soit délégués par leur parti, se regardaient de temps en temps avec des sourires ironiques mal dissimulés ; ils se poussèrent enfin du coude et quittèrent tout doucement la salle. On pouvait voir qu'ils ne voulaient troubler la réunion à aucun prix. Il est vrai que cela ne valait pas la peine de discuter dans un tel milieu. Enfin la réunion parut toucher à sa fin. Quand le professeur, dont la voix était devenue de plus en plus faible, eut fini sa conférence, le président de la réunion, celui qui était assis entre les deux porteurs de monocle, se leva, et d'une voix claironnante s'adressa aux « sœurs allemandes » et aux « frères » qui étaient là, en proclamant son sentiment de la plus profonde reconnaissance pour la conférence unique et admirable que le professeur X... venait de leur faire d'une façon aussi agréable que consciencieuse et profonde, cette conférence ayant été un « événement
480 intérieur » dans le sens le plus vrai de ce mot, et même « une action ». Ce serait une profanation de cette heure si sublime que de livrer à la discussion ces dissertations lumineuses ; c'est pourquoi, sûr d'être l'interprète de tous les auditeurs, il renonçait à ouvrir une discussion, et proposait à tous de lever la séance et de chanter en chœur : a Nous sommes tous un peuple uni de frères » (1), etc. Enfin, en clôturant la réunion, il proposa de chanter l'hymne national allemand. Et ils le chantèrent ; il me parut qu'au deuxième couplet les voix devinrent moins nombreuses, pour ne s enfler qu'au refrain ; au troisième, cette impression se renforça encore, de sorte que j'eus l'impression que tous n'étaient pas tout à fait sûrs du texte.
Mais est-ce que cela importe, quand une pareille chanson s'élance vers le ciel pleine de ferveur, du fond d'une âme patriote allemande ?
Et la réunion se dispersa, c'est-à-dire chacun se pressa de sortir au plus vite, les uns pour prendre un bock, les autres un café, d'autres encore pour être à l'air libre.
Eh ! oui, sortir à l'air libre, être dehors ! Tel était aussi mon unique désir. Et c'est cela qui doit servir à glorifier la lutte héroïque de centaines de milliers de Prussiens et d'Allemands ? Au diable de pareilles manifestations !
Le gouvernement, certes, peut aimer ça. Certes, c est une réunion « pacifique ». Ici, un ministre n'a vraiment pas à redouter, pour l'ordre et la sécurité, que les flots de l'enthousiasme dépassent la mesure administrative de correction bourgeoise, il n'a pas à redouter que des hommes, dans l'ivresse de l'enthousiasme, s'élancent de la salle non pas pour arriver au plus vite dans un café ou une brasserie. mais pour parcourir, en rangs par quatre, en marchant en cadence, et en chantant : « Honneur à l'Allemagne ! » les rues de la ville, et causer par cela des désagréments à la police qui a bien besoin de repos.
Non, on peut être content de ces citoyens-là !
* Les réunions national-socialiste, au contraire, ri étaient pas des réunions « paisibles u. Ici, les vagues de deux conceptions de vie s'entrechoquaient, et elles ne finissaient pas
(1) Wilhelm Tell, serment du Rütli.
481 par de fades déclamations de chants patriotiques, mais par une éruption fanatique des passions raciste et nationale.
Il importait, dès le début, d établir dans nos réunions une discipline rigoureuse et d'assurer au bureau une autorité absolue. Car nos discours n'étaient pas un bavardage impuissant de « conférenciers » bourgeois, ils étaient, par leur sujet et par leur forme, faits pour provoquer 4a riposte de l'adversaire. Et il y eut des adversaires dans nos réunions ! Bien souvent ils venaient en foules compactes, encadrant quelques démagogues, et leurs visages reflétaient cette conviction : « Aujourd'hui, nous allons en finir avec vous ! "
Oui, bien souvent, ils ont été amenés chez nous en véritables colonnes, nos amis du parti communiste, avec le mandat bien inculqué d'avance de casser ce soir-là toute la boutique et d'en finir avec toute cette histoire. Et combien, souvent, tout ne tint qu'à un fil, et seule l'énergie sans bornes de notre bureau et la combativité brutale de notre propre police de salle purent encore une fois contrecarrer les desseins de nos adversaires.
Et ils avaient toutes les raisons pour être excités contre nous.
Rien que la couleur rouge de nos affiches les attirait dans nos salles de réunions. La bourgeoisie ordinaire fut épouvantée quand nous recourûmes su rouge des bolcheviks, et elle vit là quelque chose de très louche. Les nationaux allemands faisaient courir le bruit que nous n'étions au fond qu'une variété du marxisme, que nous n'étions que des socialistes larvés. Car ces têtes dures n'ont pas compris jusqu'à ce jour la différence entre le vrai socialisme et le marxisme. Surtout quand on découvrit que nous nous adressions dans nos réunions non pas à des « Mesdames et Messieurs », mais seulement à des « compatriotes », et que nous nous traitions entre nous de camarades de parti ; alors beaucoup d'entre nos adversaires nous prirent pour des marxistes. Bien souvent, nous nous sommes . tordus de rire au sujet de la panique de ces stupides bourgeois en peau de lapin, devant ce spirituel jeu de devinettes sur notre origine, nos intentions et notre but.
* Nous avons choisi la couleur rouge pour nos affiches après mûre et solide réflexion, pour faire enrager la gauche,
482 pour provoquer son indignation, et pour l'amener à venir à nos réunions, ne fût-ce que dans le but de les saboter, parce que c'était la seule façon de nous faire entendre de ces gens-là.
Ce fut réjouissant de suivre ces années-là les changements perpétuels de la tactique de nos ennemis, qui témoignaient qu'ils se sentaient désorientés et impuissants. D'abord, ils enjoignirent à leur partisans de ne prêter aucune attention à nous et d'éviter nos réunions.
Cette consigne, en général, fut suivie.
Mais comme, peu à peu, quelques-uns des leurs vinrent quand même, et que leur nombre eut une tendance à grandir, quoique lentement, et que l'impression faite sur eux par notre doctrine était visible, les chefs devinrent peu à peu nerveux et inquiets, et s'arrêtèrent à la conviction qu'on ne pouvait se borner à rester toujours spectateurs de ce développement, mais qu'on devait en finir avec lui par la terreur.
Ce furent alors des appels aux « prolétaires conscients et organisés » qui devaient aller en masse à nos réunions, afin d'asséner les coups de poing du prolétariat à l'« agitation monarchiste et réactionnaire » dans la personne de ses représentants.
Alors, tout d'un coup, il arriva que nos salles de réunions furent remplies d'ouvriers trois quarts d'heure avant l'ouverture de la séance. Elles étaient pareilles à des barils de poudre, qui pouvaient à chaque moment voler en l'air, la mèche étant déjà allumée. Mais il en advint toujours autrement. Ces hommes vinrent en ennemis, et ils partirent, sinon déjà en partisans, du moins avec des doutes sur la valeur de leur propre doctrine. Peu à peu j'arrivai à fondre partisans et adversaires, après un discours de trois heures, en une seule masse enthousiasmée. Tout signal pour briser la réunion restait vain. Les chefs furent alors vraiment pris de peur, et enfin prévalut l'avis de ceux qui s'étaient déjà auparavant opposés à cette tactique de participation aux réunions, et qui pouvaient maintenant, avec un semblant de raison, déclarer que l'expérience avait prouvé qu'on devait défendre aux ouvriers, par principe, de venir à nos séances.
De nouveau, ils ne vinrent plus, ou plutôt il en vint moins. Mais bientôt le même jeu recommença.
483 L'interdiction rie fut pas observée, les camarades vinrent toujours plus nombreux, et, enfin, ce furent les partisans d'une tactique radicale qui prirent de nouveau le dessus. Il fallait rendre nos réunions impossibles.
Quand il s'avéra après deux, trois, souvent après huit ou dix réunions qu'il était plus facile de les rompre en théorie qu'en pratique, et que le résultat de chaque réunion était l'effritement de troupes rouges de combat, de nouveau on entendit l'autre mot d'ordre : « Camarades, ouvriers et ouvrières, évitez les réunions des agitateurs nationaux-socialistes ! »
Cette même hésitation dans la tactique se retrouva aussi dans la presse rouge. Tantôt on s'efforça de nous ensevelir dans le silence, puis, se rendant compte que c'était inopérant, on recourut de nouveau à la méthode contraire. On nous « mentionna » tous les jours de l'une ou de l'autre façon, et la plupart du temps, on démontrait à l'ouvrier à quel point toute notre activité était ridicule. Peu à peu, ces messieurs durent enfin sentir que cela ne nous nuisait nullement bien au contraire, parce que beaucoup de gens commencèrent à se demander pourquoi on consacrait tant de phrases à notre mouvement s'il était si ridicule que cela. La curiosité des gens s'éveilla. Alors on fit demi-tour et on commença, pendant quelque temps, à nous représenter comme d'épouvantables criminels devant l'humanité. Article sur article, commentant et démontrant toujours nos crimes, des histoires scandaleuses où tout, de A jusqu'à Z, était inventé de toutes pièces, devaient couronner ce travail. Mais on parut se rendre bientôt compte que ce genre d'attaque était également sans effet ; au fond, il n'a fait que contribuer à concentrer sur nous l'attention générale. J'adoptais alors l'attitude suivante : peu importe qu'ils se moquent de nous, ou qu'ils nous injurient ; qu'ils nous représentent comme des polichinelles ou des criminels ; l'essentiel, c'est qu'ils parlent de nous, qu'ils s'occupent de nous, que peu à peu nous apparaissions aux yeux des ouvriers comme la seule force avec laquelle il s'agit de lutter. Ce que nous étions en réalité, ce que nous voulions vraiment, nous saurions bien le montrer un beau jour à la meute juive de la presse.
Une des raisons pour lesquelles il n'y eut pas, à proprement parler, de sabotage de nos réunions, ce fut aussi la
484 lâcheté presque inimaginable des chefs de nos adversaires. Dans tous les cas critiques, ils n'envoyèrent en ligne que des subalternes, et, tout au plus, attendirent l'issue de la bagarre en dehors de la salle.
Nous étions presque toujours très bien renseignés sur les intentions de ces messieurs. Non seulement parce que nous laissâmes, pour des raisons d'opportunité, un grand nombre des nôtres dans les formations rouges, mais parce que les indicateurs rouges furent atteints d'un penchant au bavardage qui nous fut très utile, mais qui, en général, se rencontre malheureusement trop souvent chez le peuple allemand. Ils ne pouvaient tenir la bouche close, quand ils avaient conçu quelque plan, et dans la plupart des cas, ils se mettaient à caqueter avant que l'œuf ne fût pondu. C'est ainsi que, bien souvent, nous avions fait les préparatifs les plus détaillés sans que les équipes de briseurs rouges se doutassent le moins du monde qu'ils allaient immédiatement être jetés dehors.
A cette époque, nous étions forcés de faire nous-mêmes la police de nos réunions ; on ne pouvait jamais compter sur la protection des autorités ; au contraire, elles ne protègent que les fauteurs de troubles, ainsi que l'expérience le prouve. Car le seul résultat réel d'une intervention des autorités, c'est-à-dire de la police, était la dispersion d'une réunion, c'est-à-dire sa clôture. Et c'était le but et l'unique intention des saboteurs ennemis.
D'ailleurs, un usage s'est établi dans la police à cet égard, qui est le plus monstrueux et le plus contraire à toute notion de droit qu'on puisse imaginer. Quand les autorités apprennent de quelque manière qu'an peut redouter une tentative de faire échouer une réunion, non seulement elles ne font rien pour arrêter les perturbateurs, mais elles défendent aux autres, aux innocents, de tenir leur réunion, et un esprit normal de policier considère encore que c'est la preuve d'une grande sagesse. Ils appellent cela « une mesure préventive pour empêcher une infraction aux lois ».
Le bandit résolu a donc toujours la possibilité de rendre impossible à l'homme honnête toute action et toute activité politique. Au nom de la sécurité et de l'ordre, l'autorité de l'Etat s'incline devant le bandit, et enjoint à l'innocent de bien vouloir ne pas le provoquer. Ainsi, quand les
485 nationaux-socialistes voulaient tenir des réunions dans tel ou tel local, et que les syndicats déclaraient que cela amènerait leurs membres à s'y opposer par la violence, non seulement la police ne mettait point sous les verrous ces messieurs les maîtres-chanteurs, mais elle interdisait notre réunion. Oui, ces représentants de la loi eurent même l'impudence incroyable de nous faire savoir cela par écrit un nombre incalculable de fois.
Si on voulait se protéger contre de telles éventualités, il fallait prendre des mesures pour que toute tentative de désordre fût rendue impossible dès le début.
A cela s'ajoutait la considération suivante :
Toute réunion qui est protégée uniquement par la police, discrédite ses organisateurs aux yeux de la grande masse. Les réunions qui nécessitent la protection d'un fort barrage de police n'exercent aucune attraction, parce qu'un déploiement de force est la condition préalable du succès parmi les couches inférieures du peuple.
De même qu'un homme courageux peut conquérir plus aisément les cœurs féminin~ qu'un lâche, de même un mouvement héroïque conquiert le cœur d'un peuple mieux qu'un mouvement pusillanime, ne se maintenant que grâce à la protection de la police.
C'est surtout pour cette dernière raison que le jeune parti devait prendre des mesures pour défendre son existence lui-même et briser le terrorisme de l'adversaire par ses propres forces.
La protection des réunions fut obtenue :
1° En les dirigeant avec énergie et avec un sens psychologique sûr.
2° Grâce à une troupe organisée de camarades chargés de maintenir l'ordre.
Quand nous organisions une réunion, nous en étions les maîtres et nul autre. Et nous avons affirmé, inlassablement et en toute occasion, ce droit à rester les maîtres. Nos adversaires savaient parfaitement que celui qui nous provoquait était jeté dehors sans aucune indulgence, ne fussions-nous qu'une douzaine contre cinq cents. Dans les réunions d'alors, surtout en dehors de Munich, il arriva qu'il y avait quinze ou seize nationaux-socialistes devant cinq, six, sept ou huit cents adversaires. Mais nous n'aurions quand même pas toléré une provocation quelconque, et
486 ceux qui assistaient à nos réunions savaient très bien que nous nous serions fait assommer sur place plutôt que de capituler. Il arriva plus d'une fois qu'une poignée de nos camarades s'affirma héroïquement contre une énorme masse de rouges qui hurlaient et cognaient. Il est vrai qu'on eût pu, finalement, venir à bout de ces quinze à vingt hommes. Mais les autres savaient qu'auparavant au moins une quantité double ou triple de leurs partisans aurait eu le crâne défoncé, et ils ne s'y risquaient pas volontiers.
Nous avons essayé donc de nous instruire en étudiant la tactique des réunions marxistes et bourgeoises, et ces observations ont porté fruit.
Les marxistes eurent toujours une discipline aveugle, à tel point que l'idée même de tenter de saboter une réunion marxiste ne pouvait se poser, du moins de la part des bourgeois. Par contre, les rouges nourrissaient d'autant plus ces intentions-là. Ils étaient non seulement parvenus sous ce rapport à une véritable virtuosité, mais ils étaient arrivés à faire régner dans de nombreuses provinces cette idée que le seul fait d'y organiser une réunion non-marxiste était une provocation envers le prolétariat ; surtout quand ceux qui tiraient les ficelles chez eux pressentaient que. dans cette réunion, on pourrait peut-être dresser la liste de leurs crimes et dévoiler leur bassesse de menteurs acharnés à tromper le peuple. Quand une telle réunion était annoncée, toute la presse rouge poussait un tolle furieux, et bien souvent ces détracteurs systématiques des lois s'adressaient d'abord aux autorités, avec la prière aussi instante que menaçante, d'interdire aussitôt cette provocation du prolétariat, afin que « le pire fût évité ». Ils conformaient leur langage à la bêtise de l'administration, et obtenaient ainsi le succès voulu. Mais si, par hasard, ils se trouvaient en face non pas d'une piteuse créature indigne de ses fonctions, mais d'un vrai fonctionnaire allemand qui repoussait leur honteux chantage, alors on lançait l'appel bien connu de ne pas tolérer une telle « provocation du prolétariat » et de se trouver à telle date en masse à cette réunion, pour « rabattre le caquet des misérables bourgeois avec les poings noueux du prolétariat ».
Ah ! il faut avoir vu une de ces réunions bourgeoises, avoir assisté une fois à toute la détresse et à toute l'anxiété de son bureau ! Bien souvent, devant de pareilles menaces,
487 ils renonçaient à leur réunion: Ou bien, la peur restait si grande qu'ils ne la commençaient qu'à 8 heures trois quarts ou à 9 heures au lieu de 8 heures. Le président se donnait toutes les peines du monde pour expliquer aux « messieurs de l'opposition » ici présents, en leur faisant mille compliments, combien il lui était agréable (pur mensonge !) à lui et aux autres assistants, que des hommes qui ne partageaient pas encore leurs convictions fussent venus ; car, seule, une discussion contradictoire (qu'ainsi il promettait solennellement d'avance) pouvait confronter les opinions, faire naître la compréhension mutuelle et jeter un pont des uns aux autres. Il assurait encore, de plus, qu'il n'entrait aucunement dans les buts de cette réunion de rendre qui que ce soit infidèle à son ancienne opinion. En effet, chacun peut gagner le ciel à sa façon (1), il faut donc laisser à autrui sa liberté d'opinion ; il prie donc qu'on permette au conférencier d'achever son discours, qui d'ailleurs ne sera pas long, et qu'on ne donne pas au monde, du moins dans cette réunion, le spectacle honteux de la discorde entre frères allemands... Pouah !
Les braves frères de gauche, pour la plupart, ne montrèrent aucune mansuétude ; le conférencier n'avait pas eu le temps d'entamer son discours qu'il devait déjà plier bagages sous une pluie d'injures des plus violentes ; et souvent on avait même l'impression qu'il devait encore remercier le sort qui abrégeait de la sorte son martyre. Sous une avalanche de huées, tous ces toréadors des réunions bourgeoises quittaient l'arène, si on ne les faisait pas descendre précipitamment par l'escalier la tête pleine de bosses, ce qui arriva bien souvent.
Ce fut donc pour les marxistes quelque chose de nouveau, quand nous, les nationaux-socialistes, nous organisâmes nos réunions, et surtout la façon dont nous les organisâmes. Ils venaient chez nous, sûrs de pouvoir naturellement répéter ce petit jeu qu'ils avaient joué tant de fois. « Aujourd'hui, nous en finissons avec ces gens-là ! » Bien souvent, l'un d'eux criait fièrement cette phrase à un autre en entrant dans notre salle, mais se trouvait mis dehors instantanément avant d'avoir pu proférer une seconde interjection.
(1) Mot de Frédéric le Grand : « Ein jeder mag nach seiner Fasson selig werden. »
488 D'abord, nous avions une tout autre méthode pour diriger les réunions. Chez nous, on ne mendiait pas pour que le public ait la bonté d'écouter notre conférence, on ne promettait pas une discussion interminable, noua décrétions dès l'abord que nous étions les maîtres de la réunion, et que celui qui se permettrait, ne fût-ce qu'une seule fois, de nous interrompre, serait impitoyablement jeté dehors. Nous déclinions d'avance toute responsabilité pour son sort ; si nous en avions le temps et si cela nous convenait, nous pourrions peut-être admettre une discussion ; sinon, il n'y en aurait pas, voilà tout ; pour le moment M. le conférencier Untel a la parole.
Cela déjà les frappa de stupeur.
En second lieu, nous possédions une police de salle bien organisée. Chez les partis bourgeois, ce service d'ordre était effectué la plupart du temps par des personnages qui croyaient que leur âge leur donnait un certain droit à se faire obéir et respecter. Comme les masses embrigadées par le marxisme se souciaient peu de l'âge, de l'autorité et du respect, ce service d'ordre bourgeois était pour ainsi dire inexistant. Dès le début de notre campagne, j'ai jeté les fondements de l'organisation de notre service de protection sous la forme d'un service d'ordre, recruté exclusivement parmi des jeunes. Pour la plupart, c'étaient des camarades de régiment, d'autres étaient de jeunes camarades de parti récemment inscrits, auxquels on devait surtout apprendre ceci : que la terreur ne pouvait être brisée que par la terreur ; que sur cette terre, seul l'homme audacieux et résolu a toujours triomphé ; que nous luttions pour une idée si puissante, si noble et si élevée qu'elle méritait bien qu'on la défendît et la protégeât su prix de la dernière goutte de son sang. Ils étaient pénétrés de cette conviction, que quand la raison se tait, la dernière décision appartient à la violence, et que la meilleure arme défensive est l'attaque ; et que notre service d'ordre devait être partout précédé de la réputation qu'il n'était pas un club de rhéteurs, mais une association de combat extrêmement énergique. Et que cette jeunesse avait soif d'un tel mot d'ordre !
Que cette génération de combattants était déçue et indignée ! Qu'elle était pleine de mépris et de répulsion pour ces poules-mouillées de bourgeois !
On voyait clairement que la révolution n'avait pu avoir
489 lieu que grâce à l'anéantissement des forces vives de notre peuple par le gouvernement bourgeois. Les poings pour protéger le peuple allemand étaient encore là, mais ce sont les têtes qui ont manqué pour les diriger. Quelles lueurs je vis poindre dans les yeux de mes gars quand je leur expliquais la nécessité de leur mission, quand je leur assurais que la plus grande sagesse du monde reste impuissante si aucune force ne la sert, ne la défend, ne la protège, que la douce déesse de la paix ne peut paraître qu'aux côtés du dieu de la guerre, et que toute grande œuvre de paix doit être soutenue et protégée par la force. Comme l'idée de la conscription militaire leur parut sous une forme nouvelle ! Non pas dans le sens où la conçoit l'esprit pétrifié de vieux fonctionnaires ankylosés, au service de l'autorité morte d'un Etat mort, mais dans la conscience vivante du devoir de s'engager à défendre, par le sacrifice de la vie individuelle, la vie du peuple entier, toujours et en tout temps, à toute place et en tout lieu.
Et comme ces gars entraient alors dans la mêlée ! Comme une nuée de guêpes, ils se ruaient sur les perturbateurs de nos réunions, sans se soucier de leur supériorité numérique, fût-elle écrasante, sans craindre d'être blessés et de verser leur sang, pleins de cette grande idée unique de frayer la voie à la mission sacrée de notre mouvement.
Dès la fin de l'été 1920, l'organisation de notre service d'ordre acquit des statuts précis et, au printemps 1921, il fut peu à peu divisé en centuries, qui se subdivisaient encore en groupes.
Et c'était urgent et nécessaire, car notre activité s'était toujours accrue. Nous nous assemblions encore assez souvent dans la salle des fêtes du Hofbräuhaus de Munich, mais encore plus souvent dans des salles plus grandes de cette ville. La salle des fêtes du Bürgerbräu (1) et le Kindlkeller (2) de Munich virent, au cours de l'automne et de l'hiver 1920-1921, des réunions toujours plus nombreuses et imposantes, et la même scène se répétait toujours : l'accès aux manifestations du parti national-socialiste allemand ouvrier devait être fermé par la police avant même le début de la réunion, parce que la salle était comble. L'organisation
(1) Brasserie bourgeoise, nom d'une grande brasserie.
(2) Caveau de l'Enfant, encore une grande brasserie.
490 de notre service d'ordre nous amena à résoudre une question très essentielle. Le mouvement ne possédait jusqu'à ce moment aucun insigne du parti, ni aucun drapeau. L'absence de tels symboles ri avait pas seulement des inconvénients momentanés, mais était inadmissible pour l'avenir. Les inconvénients étaient surtout que les camarades du parti ne possédaient aucun signe extérieur de leur association, et, d'autre part, on ne pouvait admettre pour l'avenir l'absence d'un insigne, symbole du mouvement, à opposer à l'emblème international.
Dès ma jeunesse, j'ai eu bien souvent l'occasion de reconnaître et aussi de sentir toute l'importance psychologique d'un pareil symbole. Je vis après la guerre une manifestation de masses marxistes devant le palais royal et au Lustgarten. Une mer de drapeaux rouges, de brassards rouges, de fleurs rouges donnaient à cette manifestation, qui réunissait près de cent vingt mille personnes, un aspect extérieur vraiment impressionnant. Je pouvais sentir et comprendre moi-même combien il est aisé à un homme du peuple de se laisser séduire par la magie suggestive d'un spectacle aussi grandiose.
La bourgeoisie, qui ne possède ni ne représente, comme parti politique, aucune conception philosophique de la vie, n'avait en conséquence aucun drapeau à elle. Composée de « patriotes », elle s'ornait des couleurs du Reich. Si ces couleurs avaient été le symbole d'une conception de la vie déterminée, on aurait pu croire que les dirigeants voyaient dans ce symbole la représentation de leur conception de la vie, devenu, par leur activité même, le drapeau de l'Etat et du Reich.
Mais tel n'était point le cas.
Le Reich avait été charpenté sans le secours de la bourgeoisie allemande et son drapeau était né du sein de la guerre. En conséquence, il n'était véritablement qu'un drapeau représentatif d'un Etat et n'avait aucun sens philosophique spécial.
Sur un seul point du territoire de langue allemande, dans l'Autriche allemande, existait quelque chose d'approchant d'un drapeau bourgeois de parti. En adoptant les couleurs de 1848, noir-rouge-or, comme le drapeau de son parti, une partie de la bourgeoisie nationale autrichienne créa un symbole qui, bien que sans signification idéologique, avait
491 un caractère révolutionnaire su point de vue de l'Etat. Les adversaires les plus acharnés de ce drapeau noir-rouge-or-on ne devrait jamais l'oublier de nos jours - ont été les social-démocrates et les chrétiens-sociaux, c'est-à-dire les cléricaux. Ce sont eux qui ont alors injurié, souillé et sali ces couleurs, tout comme ils jetèrent, en 1918, les couleurs noir-blanc-rouge dans la poubelle. Il est vrai que le noir-rouge-or des partis allemands de l'ancienne Autriche fut la couleur de 1848, e'est-à-dire celle d'une époque, peut-être pleine d'illusions, mais qui eut pour représentants les âmes allemandes les plus honnêtes, quoique le Juif qui tira les ficelles se tînt invisible dans la coulisse. Donc, ce n'est que la trahison à la patrie et le maquignonnage impudent d'hommes allemands et de territoires allemands qui rendirent ces drapeaux tellement sympathiques au marxisme et au centre, au point qu'ils l'adoptent aujourd'hui comme ce qu'ils ont de plus sacré et qu'ils fondent des « ligues » (1) à eux pour la protection de ce drapeau sur lequel ils crachaient auparavant.
Jusqu'à l'année 1920, ne s'opposait donc en fait au marxisme aucun drapeau qui incarnât une conception de la vie diamétralement opposée à celui-ci. Quoique les partis les plus sains de la bourgeoisie allemande ne voulussent pas, après 1918, se prêter à l'adoption du drapeau noir-rouge-or du Reich qu'on avait découvert tout à coup, on n'avait aucun programme d'avenir à opposer aux tendances nouvelles, tout au plus l'idée d'une reconstitution de l'empire disparu.
C'est à cette idée que le drapeau noir-blanc-rouge de l'ancien Reich doit sa résurrection sous la forme du drapeau de nos partis bourgeois soi-disant nationaux.
Il est évident que le symbole d'une situation qui pouvait être détruite par le marxisme dans des circonstances et avec des conséquences très peu glorieuses, convient mal comme emblème au nom duquel ce même marxisme doit être anéanti. Si sacrées et si chères que doivent être ces anciennes couleurs d'une beauté unique, dans leur jeune et frais assemblage, à tout Allemand honnête qui a combattu sous ce drapeau et qui a vu toutes les victimes tomber, elles ne peuvent être le symbole d'une lutte pour l'avenir.
(1) Pendant l'hiver 1923-1924, les partis républicains fondèrent la ligue Reichsbanner (Bannière d'empire).
492 J'ai toujours, différant en ceci des politiciens bourgeois, défendu dans notre mouvement le point de vue que c'est un vrai bonheur pour la nation allemande d'avoir perdu son ancien drapeau. Ce que la république fait sous son propre drapeau, cela peut nous rester indifférent. Mais nous devons du fond de notre cœur remercier le sort de ce qu'il fut assez clément pour préserver le drapeau de guerre le plus glorieux de tous les temps de l'opprobre de servir de drap de lit pour la prostitution la plus honteuse. Le Reich actuel qui se vend et vend ses citoyens, n'aurait jamais dû arborer le drapeau noir-blanc-rouge de l'honneur et de l'héroïsme.
Aussi longtemps que dure la honte de novembre, le régime actuel doit en porter la marque extérieure et n'a pas le droit de voler l'emblème d'un passé plus honorable. Nos politiciens bourgeois devraient se rendre compte que quiconque revendique le drapeau noir-blanc-rouge pour cet Etat-ci, commet un vol à l'égard de notre passé. Le drapeau de jadis convenait seulement à l'empire de jadis, et la république - Dieu soit loué ! - a choisi pour elle celui qui lui convenait le mieux (1).
C'est ainsi que nous, les nationaux-socialistes, nous ne considérons pas que le déploiement de l'ancien drapeau soit un symbole expressif de notre activité, car nous ne voulons pas ressusciter le vieil empire qui a péri par ses propres fautes, nous voulons fonder un Etat nouveau.
Le mouvement qui combat aujourd'hui dans ce sens contre le marxisme doit exprimer aussi par son drapeau le symbole d'un Etat nouveau.
La question du nouveau drapeau, c'est-à-dire celle de son aspect, nous préoccupa alors beaucoup. De tous côtés nous recevions des suggestions pavées de bonnes intentions, mais dénuées de valeur pratique. Le nouveau drapeau devait être en même temps un symbole de notre propre lutte, être décoratif et suggestif. Celui qui a souvent eu affaire aux masses sait que ces détails insignifiants en apparence sont, en réalité, très importants. Un insigne impressionnant peut, dans des centaines de milliers de cas, éveiller le premier intérêt à l'égard d'un mouvement.
Pour cette raison, nous devions rejeter toutes les propositions qu'on nous faisait de différents côtés de symboliser
(1) Noir-rouge-or.
493 notre mouvement par un drapeau blanc, ce qui eût rappelé l'ancien Etat ou plutôt les partis débiles dont Ie but unique était la reconstitution d'un état de choses disparu. L'e plus, le blanc n'est pas une couleur entraînante. Elle convient à de chastes sociétés de jeunes filles, mais pas à des mouvements explosifs d'une époque de révolutions.
Le noir nous fut aussi proposé : quoiqu'il convînt bien à l'époque présente, on ne pouvait voir en lui aucune indication définie sur Ies aspirations de notre mouvement. Enfin, cette couleur non plus n'exerce pas une action entraînante.
Blanc-bleu devait être éliminé, malgré son merveilleux effet esthétique, parce que c'était la couleur d'un Etat allemand particulier (l) et d'une tendance politique suspecte à cause de son étroit particularisme. En outre, on y aurait aussi difficilement trouvé une indication quelconque sur notre mouvement. Les mêmes raisons 6rent écarter le noir-blanc (2).
Pour noir-rouge-or, la question ne se posait même pas. Pour noir-blanc-rouge non plus, pour les raisons déjà indiquées, du moins dans leur composition actuelle. Mais cet ensemble de couleurs exerce quand même une action bien supérieure aux autres. C'est l'accord le plus rayonnant qui existe.
Je me prononçai toujours pour la conservation des anciennes couleurs, non seulement parce qu'elles sont pour moi, en tant qu'ancien soldat, Ce qu'il y a de plus sacré au monde, mais aussi parce qu'elles correspondent le plus à mon sens esthétique. Néanmoins je dus refuser sans exception les projets innombrables qui me parvenaient du sein de notre jeune mouvement, et qui, pour la plupart, traçaient la croix gammée sur le fond de l'ancien drapeau. Moi-même, étant le chef, je ne voulais pas imposer mon propre projet, parce que quelqu'un pouvait m'en suggérer un autre aussi bon ou même meilleur. En effet, un dentiste de Starnberg me soumit un projet qui n'était pas mauvais du tout, qui, d'ailleurs, se rapprochait du mien, et n'avait qu'un seul défaut : la croix gammée, aux branches caudées, se profilait sur un rond blanc. Moi-même, après d'innombrables essais, je m'arrêtai à une forme définitive : un rond blanc
(1) Couleurs de la Bavière.
(2) Couleurs de la Prusse.
494 sur fond rouge, et une croix gammée noire su milieu. Après de longs essais, je trouvai aussi une relation définie entre la dimension du drapeau, la grandeur du rond blanc, la forme et l'épaisseur de la croix gammée.
Et c'est resté ainsi.
Dans le même esprit, nous commandâmes aussitôt des brassards pour les membres de notre service d'ordre, une bande rouge, sur laquelle se voyait un rond blanc avec une croix gammée noire.
L'insigne du parti fut tracé suivant les mêmes lignes : un rond blanc sur fond rouge, une croix gammée au milieu. Un orfèvre de Munich, Füss, livra le premier insigne valable, qui fut conservé par la suite.
A la fin de l'été 1920, notre nouveau drapeau fut présenté pour la première fois au public. Il convenait parfaitement à notre jeune mouvement. Il était jeune et nouveau comme celui-ci. Personne ne l'avait encore vu, il agit comme une torche enflammée. Nous éprouvâmes nous-mêmes une joie presque enfantine, quand une fidèle camarade de parti exécuta pour la première fois le croquis et nous livra le drapeau. Peu de mois plus tard, nous en avions déjà à Munich une demi-douzaine, et notre service d'ordre qui grandissait toujours en nombre contribua surtout à répandre ce nouveau symbole du mouvement.
Car, c'est' vraiment un symbole ! Non seulement parce que les couleurs uniques, ardemment aimées de nous tous, et qui avaient jadis acquis tant d'honneur au peuple allemand, témoignaient de notre respect pour le passé, c' était aussi la meilleure incarnation des aspirations de notre mouvement. Nationaux-socialistes, nous voyions dans notre drapeau notre programme. Dans le rouge, nous voyions l'idée sociale du mouvement ; dans le blanc, l'idée nationaliste ; dans la croix gammée, la mission de la lutte pour le triomphe de l'aryen et aussi pour le triomphe de l'idée du travail productif, idée qui fut et restera éternellement antisémite.
Deux ans plus tard, quand notre service d'ordre fut devenu une troupe de combat, englobant des milliers d'hommes, il parut nécessaire de donner à cet organisme de combat un symbole spécial de victoire : l'étendard. C'est moi qui l'ai tracé, et j'ai confié son exécution à un vieux et fidèle camarade de parti, le maître-orfèvre Gahr. Depuis, l'étendard est l'emblème du combat national-socialiste.
495 Notre activité, qui s'intensifia sans cesse au cours de l'année 1920, nous amena enfin à tenir parfois deux réunions par semaine. Des foules s'assemblaient devant nos affiches, les plus grandes salles de la ville étaient combles, et des dizaines de milliers de marxistes égarés ont retrouvé le sentiment de leur communauté avec leur peuple pour devenir des pionniers du libre Reich de l'avenir.
Le public commença à nous connaître à Munich. On parla de nous, le mot « national-socialiste » devint courant, et c'était déjà un programme en soi. Le nombre de sympathisants, et même celui des membres du parti commença à croître sans interruption, de sorte que nous pûmes, déjà pendant l'hiver 1920-1921, paraître à Munich comme un parti puissant.
Les partis marxistes exceptés, aucun parti, surtout aucun parti national, ne put se prévaloir de manifestations aussi nombreuses, aussi imposantes que les nôtres. La salle du Kindlkeller de Munich, qui pouvait contenir cinq mille hommes, fut plus d'une fois pleine à craquer, et il n'y avait qu'une seule salle que nous n'avions pas encore osé affronter, c'était celle du cirque Krone.
Fin janvier 1921, de graves soucis assaillirent à nouveau l'Allemagne. L'accord de Paris, sur la base duquel l'Allemagne s'était engagée à payer la somme insensée de cent milliards de marks-or, devait se concréter sous la forme de l'ultimatum de Londres. L'union des associations dites racistes, qui existait à Munich depuis . longtemps déjà, voulait organiser à cette occasion une grande protestation en commun. Le temps pressait beaucoup, et moi-même je devenais nerveux devant les éternelles hésitations et les atermoiements dans l'application des résolutions prises. On parla d'abord d'une manifestation sur la Königsplatz, mais on y renonça, parce qu'on avait peur d'être dispersés et roués de coups par les rouges, et on projeta une manifestation de protestation devant la Feldherrnhalle (1). Mais on renonça aussi à cela, et on proposa une réunion en commun dans le Kindlkeller de Munich. Entre temps, les jours
(1) C'est au même endroit que, le 9 novembre 1923, échoua le putsch hitlérien.
496 fuyaient, les grands partis ne se souciaient aucunement de l'extrême gravité des événements et le comité central ne put se décider à fixer une date précise pour la manifestation projetée.
Le mardi 1er février 1921, je réclamai d'urgence une décision définitive. On me renvoya su mercredi. Le mercredi, j'exigeai une réponse absolument nette : la réunion aurait-elle lieu ? et quand ? La réponse fut de nouveau imprécise et évasive ; on déclara que le comité « avait l'intention » d'organiser la manifestation le mercredi suivant.
je fus à bout de patience, et je décidai d'organiser seul la réunion de protestation. Mercredi à midi, je dictai le texte de l'affiche en dix minutes, à la machine, et je fis en même temps louer le cirque Krone pour le lendemain, jeudi 3 février.
C'était alors infiniment hasardeux. Non seulement il était douteux que nous pussions remplir l'immense salle, mais nous courions aussi Ie danger d'être mis en pièces. Notre service d'ordre était bien insuffisant pour cette salle immense. Je n'avais non plus aucune idée précise sur la tactique à suivre dans le cas d'une tentative de sabotage de la réunion. Je pensai que la réaction serait beaucoup plus difficile dans I'amphithéâtre d'un cirque que dans une salle ordinaire. En réalité, il s avéra que c'était juste le contraire. Il était plus facile de maîtriser une bande de saboteurs dans l'espace immense d'un cirque que dans des salles bondées.
On était sûr d'une chose : tout échec pouvait nous rejeter dans l'ombre .pour longtemps. Car un seul sabotage réussi d'une de nos réunions eût détruit d'un coup notre auréole et aurait encouragé nos adversaires à répéter ce qui leur aurait réussi une fois. Cela aurait pu conduire au sabotage de toute notre activité en fait de réunions, et nous n'aurions pu rétablir la situation que dans bien des mois et après les luttes les plus dures.
Nous ri avions qu'un seul jour pour afficher, ce même jeudi. Malheureusement, il plut dans la matinée, et l'on put redouter avec quelque raison que, dans de telles conditions, la plupart des gens ne préfèrent rester chez eux su lieu de courir, sous la pluie et la neige, à une réunion où on pouvait se faire assommer.
En somme, dans la matinée, j'eus peur tout d'un coup que la salle ne fût pas remplie (j'aurais été, dans ce cas, com-
497 promis aux yeux du comité central), de sorte que je dictai à la hâte plusieurs proclamations et les fis imprimer pour les distribuer dans l'après-midi. Elles contenaient naturellement l'invitation d'assister à la réunion.
Deux camions, que je fis louer, furent décorés d'autant de rouge que possible, on y planta quelques drapeaux, et on les fit occuper par quinze à vingt camarades du parti ; ils reçurent l'ordre de circuler inlassablement dans les rues de la ville, en jetant les proclamations, afin de faire de la propagande pour la manifestation populaire du soir. Ce fut la première fois que, dans les rues, circulèrent des camions avec drapeaux, qui ne fussent pas occupés par des marxistes. La bourgeoisie, bouche bée, suivait d'un regard fixe ces camions décorés de rouge et ornés de drapeaux à croix gammée, flottant au vent, tandis que dans les quartiers extérieurs s'élevaient d'innombrables poings serrés, dont les possesseurs paraissaient remplis de rage par cette nouvelle « provocation au prolétariat ». Car le marxisme seul avait le droit de tenir des réunions, ainsi que celui de circuler en camion.
A 7 heures du soir, le cirque était encore peu garni. On me renseignait par téléphone toutes les dix minutes, et je devenais quelque peu inquiet ; car à 7 heures ou à 7 heures et quart, les autres salles avaient toujours été à moitié pleines, sinon plus. Mais ce fait allait m'être expliqué peu après. Je ri avais pas songé aux dimensions gigantesques de ce nouveau local : mille personnes suffisaient à remplir la salle du Hofbräuhaus, tandis que le même nombre d'assistants était comme englouti dans le cirque Krone. On les voyait à peine. Peu de temps après arrivèrent des nouvelles plus favorables et, à 7 heures trois quarts, on annonça que la salle était pleine aux trois quarts, et que des masses compactes s'amassaient encore devant les guichets. Sur ce, je me mis en route.
J'arrivai devant le cirque à 8 heures deux minutes. Il y avait encore foule devant l'édifice ; c'étaient, en partie, des curieux, en partie des adversaires, qui voulaient voir venir Ies événements.
Quand je pénétrai dans la salle, la même joie s'empara de moi qu'un an auparavant à notre première réunion dans la salle des fêtes au Hofbräuhaus. Mais seulement après m'être frayé un chemin parmi les murailles d'hommes, et
498 avoir atteint l'estrade élevée, je pus voir notre succès dans toute sa grandeur. La salle béait devant moi comme un coquillage gigantesque, remplie de milliers et de milliers d'hommes. Même la piste était noire de monde. On avait vendu plus de cinq mille six cents cartes d'entrée et, en comptant tous les chômeurs, les étudiants pauvres et les équipes de notre service d'ordre, on arrive à peu près au chiffre de six mille cinq cents personnes.
« Bâtir l'avenir ou disparaître », tel était le titre de ma conférence, et mon cœur se réjouit en voyant que l'avenir, il était là, sous mes yeux.
Je commençai mon discours et je parlai près de deux heures et demie ; après la première demi-heure, je sentis que cette réunion serait un grand succès. Le contact entre ces milliers d'hommes et moi s'était établi. Dès cette première demi-heure, des acclamations spontanées, éclatant de plus en plus nourries, commencèrent à m'interrompre ; au bout de deux heures, elles firent place à ce silence religieux qui, bien des fois, depuis, dans cette même salle, me pénétra et qui restera inoubliable pour tous ceux qui l'ont vécu. On eût presque entendu un souffle dans cette foule immense, et quand j'eus prononcé mes dernières paroles, un flot d'acclamations déferla, puis la foule entonna avec ferveur le chant rédempteur : Deutschland über alles.
Je suivis encore des yeux le lent reflux de cette mer d'hommes qui s'écoulait par le vaste passage central pendant presque vingt minutes, tandis que la salle géante se vidait lentement. Alors seulement, transporté de joie, je quittai ma place pour rentrer chez moi.
De cette première réunion dans le cirque Krone furent prises des photographies. Elles montrent mieux que tous les mots le caractère grandiose de cette manifestation. Les feuilles bourgeoises en publièrent quelques reproductions, avec des notes, mais n'indiquèrent pas que c'était une manifestation « nationale » et passèrent consciencieusement sous silence ses organisateurs.
Par cette manifestation, nous sortîmes pour la première fois de la catégorie des partis sans importance. On ne pouvait plus nous ignorer. Et, pour ne pas laisser s'établir dans le public l'impression que le succès de cette réunion n'était qu'éphémère, j'annonçai aussitôt, pour la semaine suivante, une seconde manifestation dans le même cirque,
499 et le résultat fut le même. De nouveau l'espace immense fut plein à craquer de masses humaines ; de sorte que je décidai de tenir la semaine suivante encore une réunion dans le même genre. Pour la troisième fois, le cirque géant, de haut en bas, fut comble.
Dans le courant de l'année 1921, j'intensifiai encore plus notre activité à Munich en fait de réunions. J'arrivai à tenir non seulement une réunion tous les huit jours, mais quelquefois deux réunions dans la même semaine, et même, en plein été et à la fin de l'automne, il y en eut parfois trois. Nous nous assemblions toujours dans le cirque, et nous pouvions constater, à notre satisfaction, que toutes nos soirées remportaient le même succès.
Il en résulta un nombre toujours croissant de sympathisants et une grande augmentation du nombre des membres du parti.
Devant de tels succès, nos adversaires ne restèrent naturellement pas inactifs. Ayant hésité dans leur tactique entre la terreur et le silence, ils ne purent, comme ils durent le reconnaître eux-mêmes, entraver le développement de notre mouvement. Ils se décidèrent donc à un dernier effort, à un acte de terreur qui devait définitivement exclure toute possibilité de poursuivre nos réunions.
Comme prétexte apparent, on utilisa un attentat très mystérieux contre un député de la diète, nommé Erhard Auer (1). Quelqu'un aurait fait feu, un soir, sur lui. On n'aurait pas tiré effectivement sur lui, mais on aurait tenté de le faire. Une présence d'esprit inouïe et le courage proverbial de ce chef social-démocrate auraient non seulement déjoué cet attentat criminel, mais auraient mis en fuite les scélérats. Ils avaient fui si vite et si bien que la police ne put jamais en trouver la moindre trace. Cet événement mystérieux fut utilisé par l'organe socialiste de Munich pour commencer contre nous une campagne d'excitation frénétique, en laissant pressentir, avec sa verbosité accoutumée, ce qui allait maintenant avoir lieu. De toutes façons, des mesures allaient être prises pour que nos arbres ne s'élèvent pas jusqu'au ciel ; il fallait que les bras prolétariens les abattent à temps.
Quelques jours plus tard, ce fut le grand coup.
(1) Socialiste bavarois.
500 Une réunion dans la salle des fêtes du Hofbäuhaus, dans laquelle je devais parler, fut choisie pour ce règlement de comptes définitif.
Le 4 novembre 1921, entre 6 et 7 heures de l'après-midi, nous reçûmes les premières communications annonçant que notre réunion serait impitoyablement sabotée et qu'on avait l'intention d'y envoyer dans ce but de grandes masses d'ouvriers des usines les plus rouges.
Il faut attribuer à une malchance que cette communication ne nous soit pas parvenue plus tôt. Le même jour, nous avions quitté notre vieux et vénérable bureau de la Sterneckgasse à Munich, et nous avions transféré notre siége dans un local nouveau ; ou plus exactement nous avions déjà évacué l'ancien local, mais n'avions pu nous installer dans le nouveau, parce qu'on y travaillait encore. Comme le téléphone avait été enlevé dans l'ancien bureau et n'avait pas encore été installé dans le nouveau, un grand nombre de tentatives de nous apprendre par téléphone ces projets de sabotage restèrent vaines.
En conséquence, cette réunion ne fut protégée que par un service d'ordre numériquement très faible, soixante hommes environ, l'appareil pour donner l'alarme n'était pas encore suffisamment perfectionné pour pouvoir amener en une heure ries renforts suffisants. Signalons en outre que, souvent, des bruits alarmants de ce genre étaient parvenus à nos oreilles et qu'il n'était jamais rien arrivé d'anormal. Le vieux dicton que les révolutions annoncées d'avance meurent dans l'œuf, s'était jusqu'à présent montré vrai en ce qui nous concernait.
Pour cette raison aussi, donc, on ne fit peut-être pas tout ce qui pouvait être fait pour empêcher par la force le sabotage de notre réunion. Enfin, nous avons toujours estimé que la salle des fêtes du Hofbräuhaus de Munich était la moins appropriée pour une tentative de sabotage. Nous en avions plutôt redouté dans des salles plus grandes, surtout dans le cirque. Sous ce rapport, cette journée nous a donné une leçon précieuse. Plus tard, nous avons étudié toutes ces questions - je puis le dire - avec des méthodes scientifiques et nous sommes arrivés à des conclusions aussi imprévues qu'intéressantes ; par la suite, elles furent d'une importance décisive pour l'organisation et la tactique de nos sections d'assaut.
501 Quand je pénétrai, à 8 heures moins un quart,. dans le vestibule du Hofbräuhaus, l'intention de sabotage ne pouvait plus faire de doutes. La salle était archi-pleine et la police, en conséquence, en avait fermé l'accès. Les adversaires qui étaient venus très tôt, se trouvaient dans la salle et nos propres partisans étaient encore dehors pour la plupart. La petite section d'assaut m'attendait dans le vestibule. Je fis fermer les portes de la grande salle et je dis à nos quarante-cinq ou quarante-six hommes de se mettre au garde à vous. Je déclarai alors à mes gars que c'était probablement la première fois qu'ils devaient prouver leur fidélité au mouvement, quoi qu'u arrive, aucun de nous ne devait quitter la salle, qu'à l'état de cadavre, personnellement je resterais dans la salle et je ne pouvais croire que nul d'entre eux pût m'abandonner ; si j'en voyais un se conduire en lâche, je lui arracherais moi-même son brassard et lui enlèverais son insigne. Ensuite, je leur enjoignis de réagir immédiatement contre toute tentative de sabotage, et de se rappeler toujours que la meilleure forme de la défense, c'est l'attaque.
Un Heil proféré trois fois, d'un son plus âpre et plus rauque que d'habitude, répondit à mes paroles.
Alors j'entrai dans la salle et je pus me rendre compte de la situation par mes propres yeux. C'était plein et une foule innombrable me foudroyait d'un regard de haine. Tandis que certains proféraient des interjections très explicites avec des grimaces ironiques : « On en finirait avec nous... Nous devions veiller à nos tripes... On nous fermerait la gueule une fois pour toutes » et bien d'autres expressions aussi élégantes. Ils étaient sûrs d'être les plus forts, et se comportaient en conséquence.
Néanmoins, la séance put être ouverte, et je commençai à parler. Dans le Hofbräuhaus, je me tenais toujours à un des fronts latéraux de la salle, et mon estrade était une table de brasserie. Je me trouvais donc au beau milieu des assistants. Peut-être cette circonstance contribua-t-elle à créer dans cette salle un état d'esprit tel que je n'ai retrouvé depuis rien de pareil nulle part. Devant moi, surtout à ma gauche, se tenaient assis et debout, exclusivement, des adversaires. C'étaient tous des hommes ou des gars robustes pour la plupart venant de la fabrique Maffei ou de chez Kustermann, au de l'usine de compteurs Isaria, etc. Le
502 long du mur de la salle, à gauche, ils s'étaient massés jusqu'à ma table même, et ils commandaient sans cesse de la bière, alignant les cruches vides sur la table devant eux. Des batteries entières s'ammoncelaient et je compris qu'il était impossible que la soirée se passât sans accrochage.
Après une heure et demie environ - je pus parler tout ce temps en dépit des interruptions - on put croire que je m'étais rendu maître de la situation. Les meneurs de la troupe des saboteurs paraissaient le sentir aussi, ils devenaient de plus en plus inquiets, sortaient souvent, revenaient et parlaient à leurs hommes avec un énervement manifeste.
Une petite erreur psychologique que je commis en ripostant à une interruption, et dont je me rendis compte sur-le-champ, donna le signal de la tempête.
Quelques interruptions furieuses se firent entendre et tout d'un coup un homme sauta sur une chaise et hurla dans la salle : Liberté ! A ce signal, les champions de la liberté commencèrent leur tâche. En peu de secondes, la salle fut remplie d'une masse humaine hurlante, au-dessus de laquelle, pareilles aux décharges des obusiers, volaient d'innombrables cruches ; tout autour, le craquement des pieds de chaises, l'écrasement des cruches, des hurlements, des beuglements, des cris stridents, c'était un vacarme infernal.
Je restai debout à ma place et je pus observer comment mes gars remplissaient sans réserve leur devoir.
J'aurais bien voulu voir une réunion bourgeoise en pareil cas.
La danse n'avait pas encore commencé que mes hommes de la section d'assaut - qui s'appelèrent ainsi depuis ce jour-là - se lancèrent à l'attaque. Comme des loups, ils se jetèrent sur leurs adversaires par meutes de huit à dix, et commencèrent en effet à les chasser de la salle en les rouant de coups. Cinq minutes après, tous étaient couverts de sang. C'étaient des hommes i J'appris à les connaître en cette occasion : à leur tête, mon brave Maurice ; mon , secrétaire particulier actuel, Hess, bien d autres qui, même grièvement atteints, attaquaient toujours tant qu'ils pouvaient se tenir debout. Le vacarme dura vingt minutes ; à ce moment, les adversaires qui étaient peut-être sept à huit cents, avaient été pour la plupart jetés hors de la salle et chassés au bas de l'escalier par mes hommes qui n'étaient même pas cinquante.
503 Mais dans le coin à gauche, au fond de la salle, se maintenait encore un bloc considérable d'adversaires qui nous opposaient une résistance acharnée. Tout à coup, près de l'entrée de la salle, éclatèrent deux coups de revolver dans la direction de l'estrade, et il s'ensuivit une terrible fusillade. Cela faisait tressaillir le cœur d'une sorte de jubilation, en évoquant des souvenirs de la guerre.
De mon poste, on ne pouvait distinguer qui tirait ; on ne pouvait établir qu'une chose : à partir de ce moment, la fureur de mes gars ensanglantés atteignit son paroxysme et les derniers saboteurs, vaincus, furent enfin expulsés de la salle. Vingt-cinq minutes à peu près s'étaient écoulées ; il semblait qu'une grenade eût éclaté dans la salle. On pansait beaucoup de mes partisans ; d'autres durent être emmenés en voiture, mais nous étions les maîtres de la situation. Hermann Esser, qui avait assumé ce soir la présidence de la réunion, déclara : « La séance continue. La parole est au conférencier », et je continuai mon discours. Nous avions déjà clos notre réunion, qu'arriva en courant un lieutenant de police, très excité, qui cria dans la salle, en agitant les bras comme un forcené : « La réunion est dissoute ! »
Je ne pus m'empêcher de rire à la vue de ce retardataire, arrivant après la bataille ; voilà bien la manière de faire l'important, si propre à la police ! Plus ils sont petits, plus ils cherchent à paraître grands.
Ce soir-là, nous avons vraiment appris beaucoup de choses et nos adversaires aussi n'ont plus oublié les leçons qu'ils reçurent alors.
Jusqu'à l'automne de 1923, la Münchener Post (1) ne nous menaça plus des « poings du prolétariat ».
(l) Organe socialiste de Munich.
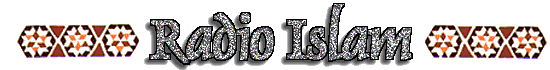
HOME
![]()
Svenska
![]()
English
![]()
German
![]()
French
![]()
French
![]()
English
![]()
German
![]()
Italian
![]()
Spanish.
![]()
Norsk
The Jewish
Plots!
Must
Germany
Perish?
A Jewish plan
for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her
people!
| English
|
French
|
Deutsch
| Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
|
English
|
French
|
Deutsch
|
Svenska
|
Portug
|
Russian
|
Spanish
|
Italian
|
Danish
|