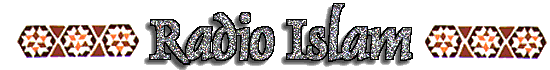
HOME
Léon Degrelle
( 15-6-1906 à Bouillon en Belgique- 31-3-1994 à Malaga en Espagne)
Qu´importe de souffrir si on a
eu dans
sa vie quelques heures immortelles.Au moins, on a vécu!

A côté
des Allemands
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
Les mois de la fin de 1940 et du début de 1941 ne furent drôles pour personne en Europe, en Belgique pas plus qu’ailleurs. Des Hollandais, nul ne parlait. Eux allaient sans doute être inclus dans le complexe géographique grand-allemand. Le Grand-Duché de Luxembourg également, de toute évidence. Quant aux Français, ils étaient déjà parvenus, sous l’œil narquois des occupants, à se manger le nez entre eux, avec un acharnement qui eût nettement fait plus d’effet derrière un canon antichar en juin 1940. Un mois après avoir jeté les bases de la collaboration avec Hitler, le maréchal Pétain avait vidé par-dessus bord son Premier ministre Pierre Laval que les Allemands n’aimaient pas, dont les ongles sales, les dents jaunes, le poil de corbeau déplaisaient à Hitler, mais dont l’ambassadeur Abetz, alors très en cour à Berchtesgaden, appréciait l’habileté, la bonhomie, le sens très auvergnat du maquignonnage et de l’adaptation. Laval, sarcastique, chiquotant ses cigarettes sous ses moustaches brûlées, avait répondu du tac au tac et traité le Maréchal comme un vieil uniforme de troupier désaffecté. Bref, c’était la pleine pagaille. Elle durerait jusqu’au dernier jour, en France et même hors de France, au château d’exil de Sigmaringen, où les « collaborateurs » français se fuyaient dans les sombres couloirs du faux burg féodal, peuplés d’armures énormes et sinistres. Restait notre cas à nous, Belges, le cas le plus compliqué. J’avais pu renouer des contacts avec le roi Léopold, prisonnier, enchaîné par Hitler et déchaîné par la nurse de la famille, dont il ferait sa femme, promue brusquement princesse de Rethy. Son secrétaire, le baron Capelle, nous servait d’estafette. Il m’avait conseillé vivement, de la part du souverain – et j’avais pris grand soin de noter aussitôt ses propos par écrit – de tenter quelque chose pour jeter un pont dans la direction du vainqueur. L’ambassadeur Abetz, ami pittoresque avec qui j’avais passé, en 1936, un semaine de vacances dans l’Allemagne du Sud et dont la femme avait été, en même temps que la mienne, élève d’un pensionnat français du Sacré-Cœur, était un esprit très curieux. Les non-conformistes lui plaisaient tout spécialement. Après mon odyssée de prisonnier, il m’avait invité, à plusieurs reprises, à déjeuner ou à dîner à son ambassade de Paris, dans le ravissant palais de la Reine Hortense, rue de Lille. Il collait une fanfare entière de le Wehrmarcht dans le jardin, au bas de notre petite table, pour le plaisir de faire retentir d’un immense tapage musical la rive gauche de la Seine, à l’usage exclusif de deux jeunes garçons. Nous avions étudié ensemble toutes les possibilités d’avenir de la Belgique. Il s’était rendu à Berchtesgaden pour parler de ce problème avec le Führer. Il lui avait rappelé notre entrevue de 1936, lui avait redit l’impression qu’elle lui avait faite alors. Il décida Hitler à m’inviter. Il me prévint qu’une auto viendrait incessamment me chercher à Bruxelles, me demandant de me tenir prêt à partir pour Berchtesgaden à n’importe quel moment. J’attendis. J’allais attendre trois ans avant de rencontrer enfin Hitler, sous des sapins sombres de la forêt lithuanienne, une nuit, où, blessé quatre fois au cours de dix-sept corps à corps, ayant rompu, la veille, l’encerclement de Tcherchassy en Ukraine, j’avais été ramené dans l’avion personnel d’Hitler, afin qu’il me passât au cou le collier de la Ritterkreuz. Mais trois années avaient été perdues. Tout échoua en octobre 1940, je l’appris par la suite, parce que des dirigeants flamands, à l’instigation de services de Sécurité allemands qui rêvaient de casser la Belgique en deux, avaient fait savoir qu’un accord d’Hitler avec un Wallon se heurtait à l’opposition de la partie flamande de la Belgique. C’était imbécile et absolument contraire à la vérité. J’avais, en 1936, obtenu aux élections à peu près autant de vois en Flandre qu’en Wallonie. Et un accord avec les chefs nationalistes flamands eux-mêmes avait, en 1937, coordonnés nos conceptions politiques et notre plan d’action. Mais, puisque des services d’espionnage allemands affirmaient qu’un arrangement avec moi aboutiraient à déclencher des oppositions linguistiques très violentes dans une zone de combat, base principale de la lutte aérienne de l’Allemagne contre l’Angleterre, Hitler remit les négociations à plus tard. C’était l’impasse, la nuit absolue. Après l’annulation de mon entrevue, le roi Léopold lui-même tenta, envers et contre tout, de rencontrer Hitler. Sa sœur, la princesse héritière d’Italie, la femme d’Humberto, alors allié privilégié du Reich, jeune femme puissamment carrossée, la jambe haute, l’œil clair et dur, était allée à Berchtesgaden relancer le Führer, avec l’acharnement que savent déployer les femmes, parfois à contretemps. Hitler avait reçu finalement Léopold III, mais froidement. Il ne lui avait rien dévoilé. L’entrevue s’était limitée à cette distribution de liquide tiède, moins révélateur encore que du marc de café. L’échec avait été complet. Tout ce que nous fîmes durant l’hiver 1940-1941 pour dégeler l’iceberg allemand échoué sur nos rivages, ne nous conduisit guère plus loin. Nos avances – notamment au cours d’un grand meeting que je donnai au Palais des Sports après le Nouvel An – n’eurent d’autre résultat que quelques lignes de compte rendu banal dans le Volkischer Beobachter. Au fond, Hitler savait-il lui-même alors ce qu’il voulait ? Comme dirait, en mai 1968, le général de Gaulle, lorsque la révolution des étudiants de la Sorbonne faillit le submerger, « la situation était insaisissable ». La guerre contre les Anglais allait-elle se prolonger ? Ou, comme le croyait et le disait le général Weygand, le Royaume-Uni allait-il tomber sur les genoux, tout d’un coup, écrasé sous le fer et le feu ? Et les Soviets ? Molotov, fouinard sous ses besicles, était venu en octobre 1940 à Berlin, apporter à Hitler, outre le spectacle de sa dégaine de voyageur de commerce au pantalon ondoyant comme un pneu, la liste des plats copieux que Staline prétendait se voir offrir à brève échéance. Les armées du Troisième Reich venaient à peine de balayer la moitié de l’Europe que les Soviets prétendaient se faire allouer, sans frais et sans risques, l’autre moitié du continent ! Déjà, profitant de la campagne de Pologne en 1939, Staline avait englouti les trois pays baltes, en un coup de dents vigoureux de goinfre insatiable. Il avait récidivé en juin 1940, dévorant la Bessarabie. Maintenant, ce qu’il exigeait, c’était, ni plus ni moins, le contrôle complet des Balkans. Hitler avait été l’ennemi numéro un des Soviets. Bien à contrecœur , afin de ne pas être amené à devoir combattre sur deux fronts dès le début de la guerre, il avait marqué un temps d’arrêt, en août 1939, dans sa lutte contre le communisme. Mais il était impossible qu’il permît l’installation des Soviets à la lisière même du continent qu’il achevait à peine de rassembler. La menace était nette. Le danger, non seulement était grand, mais il était évident,.. Hitler ne pouvait pas se laisser acculer à une ruée des Russes vers le Reich si un gros revers à l’Ouest ts le frappait un jour. Il devait être prêt à devancer un mauvais coup, sur les possibilités duquel les menaces sorties de la petite bouche de belette jaune de Molotov ne laissaient guère de doute. Prenant prudemment les devants, Hitler avait mis en route, secrètement, la préparation de l’Opération Barberousse, dont l’élaboration des plans avait été confiée au général Paulus, le futur vaincu de Stalingrad. Entre-temps, tout, en Europe, restait indécis. Les divisions internes des Français et la liquidation rapide d’une politique de rapprochement avec Pétain avaient conseillé à Hitler de laisser le temps passer et les affaires de l’Occident se tasser. Le moral des différents peuples de l’Ouest se liquéfiait. Des oppositions de races, de langues, de clans, d’ambitions les rongeaient, sans qu’une grande action ou, au moins, une grande espérance les soulevât. Pour moi, c’était clair : deux ans, trois ans d’une telle stagnation, et la Belgique serait mûre pour la liquidation, l’absorption, plus ou moins directe des Flamands dans une Germanie unifiée, la mise au rancart des Wallons, Européens asexués, ni Français ni Allemands ; et l’élimination silencieuse d’un roi Léopold devenu totalement invisible, séparé de son peuple, naviguant entre sa bibliothèque vide et une nursery moins solitaire mais qui, tout de même, politiquement, ne conduisait pas bien loin. Espérer revoir Hitler ? Il n’était même plus question d’une rencontre. Discuter avec des sous-fifres à Bruxelles ? Ils n’avaient aucun pouvoir de discussion. Ils étaient, en outre, gorgés de la suffisance des militaires vainqueurs traitant de haut des civils vaincus. Nous nous détestions avec une égale vigueur. Il fallait arriver à pouvoir discuter un jour d’égal à égal avec Hitler et avec le Reich victorieux. Mais comment ? L’horizon politique restait désespérément impénétrable. C’est alors que, brusquement, le 22 juin 1941, se déclencha la guerre préventive contre les Soviets, accompagnée de l’appel d’Hitler aux volontaires de toute l’Europe, pour un combat qui ne serait plus le combat des Allemands seuls mais des Européens solidaires. Pour la première fois depuis 1940, un plan européen apparaissait. Courir au front de l’Est ? De toute évidence, ce ne seraient pas les modestes contingents belges que nous pourrions rassembler au départ qui feraient que Staline mordrait la poussière ! Parmi des millions de combattants, nous ne serions qu’une poignée. Mais le courage pouvait suppléer au petit nombre. Rien ne nous empêcherait de lutter comme des lions, de nous comporter avec une vaillance exceptionnelle, d’amener l’ennemi d’hier à constater que les camarades de combats d’aujourd’hui étaient forts, que leur peuple n’avait pas démérité, qu’ils pourraient, un jour, dans l’Europe nouvelle, être une élément vigoureux, digne d’action. Et puis, il n’y avait pas d’autre solution. Certes les Alliés pouvaient gagner, eux aussi, Mais, à cette victoire des Alliés, franchement, combien d’Européens envahis croyaient-ils, à l’automne de 1940 et au début de 1941 ? dix pour cent ? cinq pour cent ? Ces cinq pour cent étaient-ils plus lucides que nous ? Qui le prouve ? Les Américains, sans lesquels un effondrement du Troisième Reich n’était même pas imaginable en 1941, s’en tenaient toujours à une politique « chèvre-choutiste ». Leur opinion restait, dans sa majorité, nettement isolationniste. Tous les sondages et de l’opinion publique aux Etats-Unis l’établisssaient et le rappelaient à chaque nouveau test. Quant aux Soviets, qui eût imaginé en 1941 que leur résistance serait coriace comme elle le fut ? Churchill lui-même déclarait à ses intimes que la liquidation de la Russie par l’Allemagne serait une affaire de quelques semaines. Le probable, pour une Européen de 1941, c’était donc qu’Hitler l’emporterait, qu’il deviendrait vraiment « le maître de l’Europe pour mille ans » que nous avait annoncé Spaak. Dans ce cas, ce n’était pas en pataugeant dans les marais troubles et stériles de l’attentisme, à Bruxelles, à Paris et à Vichy, que des titres pourraient être acquis, assurant aux vaincus de 1940, dans l’Europe de demain, une participation correspondant à l’Histoire, aux vertus et aux possibilités de leurs patries. Cela compris, il s’agissait de donner l’exemple. Je n’allais tout de même pas encourager mes fidèles a courir au casse-pipe entre Mourmansk et Odessa sans être mêlé à eux, sans partager avec eux les souffrances et les dangers des combats ! Je m’engageais donc, bien que je fusse père de cinq enfants. Et je m’engageais comme simple soldat, pour que le plus défavorisé de nos camarades me vît partager avec lui ses peines et ses infortunes. Je n’avais même pas prévenu les Allemands de ma décision. Deux jours après que je l’eusse rendue publique, un télégramme d’Hitler m’annonça qu’il me nommait officier. Je refusai à l’instant. J’allais en Russie pour conquérir des droits qui me permettraient de discuter honorablement, un jour, des conditions de survie de mon pays, et non pour recevoir, avant le premier coup de feu, des galons qui ne seraient que des galons d’opérette. Je deviendrais par la suite (au long de quatre années harassantes de combats) caporal, puis sergent, puis officier, puis officier supérieur, mais chaque fois ce serait « pour acte de valeur au combat », après avoir, au cours de soixante-quinze corps-à-corps, trempé préalablement mes épaulettes dans le sang de sept blessures. – « Je ne verrai Hitler, déclarai-je à mes intimes au moment du départ, que lorsqu’il me passera au cou la Cravate de la Ritterkreuz. » Ainsi, exactement, se passèrent les choses, trois ans plus tard. A ce moment-là, je pouvais parler net, blessé à maintes reprises, maintes fois décoré, achevant d’effectuer une rupture du front soviétique qui avait sauté onze divisions de l’encerclement. Et j’allais obtenir d’Hitler – la preuve écrite en existe – un statut reconnaissant à mon pays, au sein de l’Europe nouvelle, un espace et des possibilités supérieures à tout ce qu’il avait connu, même au temps les plus glorieux de son histoire, sous les ducs de Bourgogne et sous Charles Quint. De l’existence de ces accords, nul ne peut plus douter. L’ambassadeur français François-Poncet, qui ne m’aime guère, les a publiés dans le Figaro, carte à l’appui. Hitler a été vaincu. Donc, notre accord, obtenu au prix de tant de souffrances, de tant de sang et malgré tant de crocs-en-jambe, est resté sans suites. Mais le contraire eût pu se passer. Eisenhower écrit dans ses Mémoires que, même au début de 1945, il restait à Hitler des possibilités de gagner. A la guerre, tant que le dernier fusil n’est pas tombé, tout reste possible. D’ailleurs, nous n’empêchions pas les Belges qui croyaient à la solution de Londres de se sacrifier de la même manière, pour assurer, eux aussi, en cas de victoire de l’autre « bloc », le renouveau et la résurrection de notre pays. Ils n’ont pas dût, plus que nous, avoir la vie facile, en butte, certainement, à des pièges et à des intrigues de tous genres. L’exemple de De Gaulle, les persécutions sournoises dont il fut l’objet de la part des Anglais et surtout des Américains, les humiliations qu’il dut encaisser, ont dût être du même ordre que les déboires qu’il nous fallut subir maintes fois, du côté allemand, avant d’obtenir que notre cause fût assurée de la réussite. A Londres comme dans notre camp, il fallait tenir bon, ne pas se laisser intimider, faire corps, toujours, avec l’intérêt de son peuple. Malgré les aléas, il était utile, j’allais dire indispensable, que, des deux côtés, des nationalistes tentassent les deux chances, afin que nos patries survécussent, quel que fût le chapitre final du conflit. Ce n’était pas un motif, toutefois, pour que ceux qui se retrouvèrent du côté des gagnants, en 1945, égorgeassent les autres. Des mobiles très divers animèrent donc nos esprits et nos cœurs lorsque nous partîmes, sac au dos, pour le front de l’Est. Nous allions – premier objectif, objectif officiel – y combattre le communisme. Mais la lutte contre le communisme eût pu parfaitement se passer de nous. Nous partions aussi – second objectif, et en fait, objectif essentiel à nos yeux – non pas, exactement, pour combattre les Allemands, mais pour nous imposer aux Allemands qui, grisés par l’orgueil d’innombrables victoires eussent pu nous traiter par-dessus la jambe dans chacun de nos pays occupés. Certains ne s’en étaient pas fait faute déjà et leur duplicité prolongée ne fut pas sans nous scandaliser à maintes reprises. Après l’épopée du front russe, il leur deviendrait difficile de saboter encore les représentants de peuples qui auraient lutté courageusement à côté de leurs armées, dans un combat qui nous rendait tous solidaires. Ce fut là le grand motif de notre départ : forcer le sort, forcer l’attention et l’adhésion des Allemands vainqueurs, en édifiant avec eux une Europe que notre sang, à nous aussi, aurait cimentée. Nous allions vivre en Russie des années horribles, connaître physiquement, moralement, un calvaire qui n’a pas de nom. Dans l’Histoire des hommes, il n’y a jamais eu de guerre à ce point atroce, dans des neiges sans fin, dans des boues sans fin. Affamés souvent, sans repos jamais, nous étions accablés de misère, de blessures, de souffrances de tous ordres. Pour arriver finalement à un désastre qui engloutit nos jeunesses et anéantit no vies… Mais, dans la vie, qu’est-ce qui compte ? Le monde nouveau ne se fera que dans la purification du don. Nous nous sommes donnés. Même le don apparemment inutile ne l’est jamais complètement. Il trouve un jour une signification. L’immense martyre de millions de soldats, le long râle d’une jeunesse qui se sacrifia totalement au front russe, ont fourni à l’avance à l’Europe la compensation spirituelle indispensable à son renouveau.
Une Europe de boutiquiers n’eût pas été suffisante. Il fallait aussi une
Europe de héros. Celle-ci allait se créer avant l’autre, au cours de quatre
années de luttes effroyables. |
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!