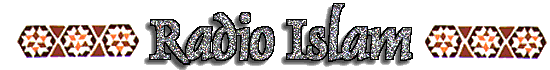HITLER POUR MILLE ANS
![]() :Par
:Par
Léon Degrelle

Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
Chapitre premier Le musellement des vaincus [7] A nous, rescapés en 1945 du front de l’Est, déchirés par les blessures, accablés par les deuils, rongés par les peines, quels droits nous reste-t-il encore ? Nous sommes des morts. Des morts avec des jambes, des bras, un souffle, mais des morts. Prononcer un mot en public, ou écrire dix lignes lorsqu’on a combattu, arme au poing, contre les Soviets, et, surtout, lorsqu’on a été un chef dit « fasciste », est considéré sur-le-champ, du côté « démocratique », comme une sorte de provocation. A un bandit de droit commun, il est possible de s’expliquer. Il a tué son père ? Sa mère ? Des banquiers ? Des voisins ? Il a récidivé ? Vingt journaux internationaux ouvriront leur colonnes à ses Mémoires, publieront sous des titres ronflants le récit de ses crimes, agrémenté de mille détails hauts en couleur, qu’il s’agisse de Cheisman ou de dix de ses émules. Les descriptions cliniques d’un vulgaire assassin vaudront les tirages et les millions d’un best-seller à son analyste pointilleux, l’Américain Truman Capote. D’autres tueurs publics comme les Bonnie et Clyde [8] connaîtront la gloire des cinémas et dicteront même la mode dans les drugstores les plus huppés. Quant aux condamnés politique, ça dépend. C’est la couleur de leur parti qui commandera leur justification ou leur exécration. Un Campesino, paysan rustaud devenu chef de bande du Frente Popular, et que les scrupules n’étouffaient guère lorsqu’il s’agissait de faucher les rangs des Nationaux, a pu, en Espagne même, et à des centaines de milliers d’exemplaires, dans le journal au tirage le plus élevé de Madrid, expliquer, largement et librement, ce qu’avait été son aventure sanglante d’Espagnol de « Gauche ». Mais voilà, lui était de Gauche. Alors, lui avait le droit, comme tous les gens de Gauche ont tous les droits. Quels qu’eussent été les crimes, voire les exterminations massives auxquels les régimes marxistes se soient livrés, nul ne leur fera grise mine, la Droite conservatrice parce qu’elle se pique d’être, assez imbécilement, ouverte au dialogue, la Gauche parce qu’elle couvre toujours ses hommes de main. Un agitateur révolutionnaire à la Régis Debray pourra compter sur toutes les audiences qu’il voudra ; cent journaux bourgeois reprendront avec éclat ses propos. Le Pape et le général de Gaulle se précipiteront pour le protéger, l’un sous sa tiare, l’autre sous son képi . Comment, à ce propos, ne pas tracer un parallèle avec Robert Brasillach, le plus grand écrivain de France de [9] la Deuxième Guerre mondiale ? Passionné de son pays, à qui il avait vraiment voué son oeuvre et sa vie, il fut, lui, impitoyablement fusillé à Paris, le 6 février 1945, sans qu’un képi quelconque ne s’agitât, si ce n’est pour donner le signal du tir du peloton d’exécution… De même, l’anarchiste juif, né en Allemagne, nommé Cohn-Bendit, mollement recherché et, bien entendu, jamais retrouvé par la police de Paris alors qu’il avait été tout près d’envoyer la France en l’air, a pu, tant qu’il l’a voulu et comme il l’a voulu, publier ses élucubrations, aussi incendiaires que médiocres, chez les éditeurs capitalistes, empochant, en ricanant, les chèques que ceux-ci lui tendaient pour couvrir ses droits d’auteur ! Les Soviets ont perché leur dictature sur seize millions et demi d’assassinés : évoquer encore le martyre de ceux-ci serait considéré comme nettement incongru. Khrouchtchev, bateleur vulgaire pour marché aux porcs, pois chiche sur le nez, suintant, vêtu comme un sac de chiffonnier, a parcouru, triomphant, sa mémère au bras, les Etats-Unis d’Amérique, escorté par des ministres, des milliardaires, des danseuses de french-cancan et la fine fleur du clan Kennedy, se payant même, pour finir, un numéro de savates sur tables et de chaussettes humides en pleine session de l’O.N.U. Kossyguine a offert sa tête de pomme de terre mal cuite aux hommages fleuris de Français toujours bouleversés à l’évocation d’Auschwitz, mais qui ont oublié les milliers d’officiers polonais, leurs alliés de 1940, que l’U.R.S.S. assassina méthodiquement à Katyn. Staline lui-même, le pire tueur du siècle, le tyran implacable, intégral, faisant massacrer, dans ses fureurs [10] démentes, son peuple, ses collaborateurs, ses chefs militaires, sa famille, reçut un mirobolant sabre d’or du roi le plus conservateur du monde, le roi d’Angleterre, qui ne comprit même pas ce que le choix d’un tel cadeau à un tel criminel avait de macabre et de cocasse ! Mais que nous, les survivants « fascistes » de la Seconde Guerre mondiale, poussions l’impertinence jusqu’à desserrer les dents un seul instant, aussitôt mille « démocrates » se mettent à glapir avec frénésie, épouvantant nos amis eux-mêmes, qui suppliants, nous crient : attention ! attention ! Attention à quoi ? La cause des Soviets était-elle vénérable à un tel point ? Tout au long d’un quart de siècle, les spectateurs mondiaux ont eu d’éclatantes occasions de se rendre compte de sa malfaisance. La tragédie de la Hongrie, écrasée sous les chars soviétiques, en 1956, en expiation du crime qu’elle avait commis de reprendre goût à la liberté ; la Tchécoslovaquie terrassée, muselée par des centaines de milliers d’envahisseurs communistes, en 1968, parce qu’elle avait eu l’ingénuité de bouloir se dégager un peu du carcan que Moscou lui avait enserré autour du cou, comme à un forçat chinois ; le long soupir des peuples opprimés par l’U.R.S.S., du golfe de Finlande jusqu’aux rivages de la mer Noire, démontrent [sic] clairement quelle horreur eût connu l’Europe entière si Staline eût pu – et sans l’héroïsme des soldats du front de l’Est, il l’eût pu – s’abattre dès 1943 jusqu’aux quais de Cherbourg et jusqu’au rocher de Gibraltar. [11] De l’enfer de Stalingrad (novembre 1942) à l’enfer de Berlin (avril 1945), neuf cent jours s’écoulèrent, neuf cent jours d’épouvante, de lutte chaque fois plus désespérée, dans des souffrances horribles, au prix de la vie de plusieurs milliers de jeunes garçons qui se firent délibérément écraser, broyer, pour essayer de contenir, malgré tout, les armées rouges dévalant de la Volga vers l’ouest de l’Europe. En 1940, entre l’irruption des Allemands à la frontière française près de Sedan et l’arrivée de ceux-ci à la mer du Nord, il se passa tout juste une semaine. Si les combattants européens du front de l’Est, parmi lesquels se trouvaient un demi-million de volontaires de vingt-huit pays non allemands, avaient détalé avec la même vélocité, s’ils n’avaient pas opposé, pied à pied, au long de trois années de combats atroces, une résistance inhumaine et surhumaine à l’immense marée soviétique, l’Europe eût été perdue, submergée sans rémission dès la fin de 1943, ou au début de 1944, bien avant que le général Eisenhower eût conquis son premier pommier de Normandie. Un quart de siècle est là qui l’établit. Tous les pays européens que les Soviets ont conquis, l’Esthonie [sic], la Lithuanie [sic], la Lettonie, la Pologne, l’Allemagne orientale, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie sont restés, depuis lors, implacablement, sous leur domination. Au moindre écart, à Budapest ou à Prague, c’est le « knout » moderne, c’est-à-dire les chars russes fauchant à bout portant les récalcitrants. [12] Dès juillet 1945, les Occidentaux, qui avaient misé si imprudemment sur Staline, commencèrent à déchanter. - Nous avons tué le mauvais cochon, murmura Churchill au président Truman, à Potsdam, tandis qu’il sortaient tous deux d’une entrevue avec Staline, le vrai vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Regrets tardifs et pitoyables… Celui qui leur avait paru précédemment le « bon cochon », installé par eux sur deux continents, grognait de satisfaction, la queue à Vladivostok, le groin fumant à deux cent kilomètres du territoire français. Le groin est toujours là, depuis un quart de siècle, plus menaçant que jamais, à tel point que nul ne se risque, à l’heure actuelle, à l’affronter, sinon à coups de courbettes. Au lendemain de l’écrasement de Prague, à l’été de 1968, les Johnson, les de Gaulle, les Kiesinger s’en tinrent à des protestations platoniques, à des regrets craintifs et réservés. Entre-temps, sous la panse dudit cochon, la moitié de l’Europe étouffe. Ça ne suffit-il donc pas ? Est-il juste, est-il décent que ceux qui virent clair à temps, ceux qui jetèrent, de 1941 à 1945, leur jeunesse, les doux liens de leur foyer, leurs forces, leurs intérêts en travers du chemin sanglant des armées soviétiques, continuent à être traités comme des parias jusqu’à leur mort et au-delà même de leur mort ?… Des parias à qui on cloue les lèvres dès qu’ils essayent de dire : « tout de même ». [13] Tout de même… Nous avions des vies heureuses, des maisons où il faisait bon vivre, des enfants que nous chérissions, des biens qui donnaient de l’aisance à notre existence… Tout de même… Nous étions jeunes, nous avions des corps vibrants, des corps aimés, nous humions l’air neuf, le printemps, les fleurs, la vie, avec une avidité triomphante… Tout de même… Nous étions habités par une vocation, tendus vers un idéal… Tout de même…Il nous a fallu jeter nos vingt ans, nos trente ans et tous nos rêves vers d’horribles souffrances, d’incessantes angoisses, sentir nos corps dévorés par les froids, nos chairs déchirées par les blessures, nos os rompus dans des corps à corps hallucinants. Nous avons vu hoqueter nos camarades agonisants dans des boues gluantes ou dans les neiges violettes de leur sang. Nous sommes sortis vivants, tant bien que mal, de ces tueries, hagards d’épouvante, de peine et de tourments. Un quart de siècle après, alors que nos parents les plus chers sont morts dans des cachots ou ont été assassinés, et que nous-mêmes sommes arrivés, dans nos exils lointains, au bout du rouleau du courage, les « Démocraties », hargneuses, bilieuses, continuent à nous poursuivre d’une haine inextinguible. Jadis, à Breda, comme on peut le voir encore dans l’inoubliable tableau de Velasquez, au musée du Prado à Madrid, le vainqueur offrait ses bras, sa commisération et son affection au vaincu. Geste humain ! Etre vaincu, [14] quelle souffrance déjà, en soi ! Avoir vu s’effondrer ses plans et ses efforts, rester là, les bras ballants devant un avenir disparu à jamais, dont on devra pourtant regarder le cadre vide, en face de soi, jusqu’au dernier souffle ! Quel châtiment, si l’on avait été coupable ! Quelle douleur injuste, si l’on n’avait rêvé que de triomphes purs ! Alors, on comprend qu’en des temps moins féroces, le vainqueur s’avançait, fraternel, vers le vaincu, accueillait l’immense peine secrète de celui qui, s’il avait sauvé sa vie, venait de perdre tout ce qui donnait à celle-ci un sens et une valeur… Que signifie encore la vie pour un peintre à qui on a crevé les yeux ? Pour un sculpteur à qui on a arraché les bras ? Que signifie-t-elle pour l’homme politique rompu par le destin, et qui avait porté en lui, avec foi, un idéal brûlant, qui avait possédé la volonté et la force de le transposer dans les faits et dans la vie même de son peuple ?… Plus jamais il ne se réalisera, plus jamais il ne créera… Pour lui, l’essentiel s’est arrêté. Cet « essentiel », dans la grande tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, que fut-il pour nous ? Comment les « fascismes » - qui ont été l’essentiel de nos vies – sont-ils nés ? Comment se sont-ils déployés ? Comment ont-ils sombré ? Et, surtout, après un quart de siècle : de toute cette affaire énorme, quel bilan peut-on dresser ? Chapitre II Quand l’Europe était fasciste [15] A un jeune garçon des temps actuels, l’Europe dite « fasciste » apparaît comme un monde lointain, déjà confus. Ce monde s’est effondré. Donc, il n’a pas pu se défendre. Ceux qui l’ont jeté au sol restaient seuls sur le terrain, en 1945. Ils ont, depuis lors, interprété les faits et les intentions, comme il leur convenait. Un quart de siècle après la débâcle de l’Europe « fasciste » en Russie, s’il existe quelques ouvrages à demi corrects sur Mussolini, il n’existe pas encore un seul livre objectif sur Hitler. Des centaines d’ouvrages lui ont été consacrés, tous bâclés, ou inspirés par une aversion viscérale. Mais le monde attend toujours l’oeuvre équilibrée qui établira le bilan de la vie du principal personnage politique de la première moitié du XIXe siècle. Le cas d’Hitler n’est pas un cas isolé. L’Histoire si l’on peut dire ! – s’est écrit depuis 1945 à sens unique. Dans la moitié de l’univers, dominée par l’U.R.S.S. et par la Chine rouge, il n’est même pas pensable que la [16] parole soit donnée à un écrivain qui ne serait pas un conformiste ou un adulateur. Dans l’Europe occidentale, si le fanatisme est plus nuancé, il n’en est que plus hypocrite. Jamais un grand journal français, ou anglais, ou américain ne publierait un travail qui mettrait en relief ce qu’il put y avoir d’intéressant, voire de sainement créateur, dans le Fascisme ou dans le National-Socialisme. La seule idée d’une telle publication paraîtrait aberrante. On crierait aussitôt au sacrilège. Un secteur a été tout spécialement l’objet de soins passionnés : on a publié, dans un gigantesque tapage, cent reportages, souvent exagérés, parfois grossièrement mensongers, sur les camps de concentration et sur les fours crématoires, seuls éléments que l’on veuille bien considérer dans l’immense création que fut, pendant dix ans, le régime hitlérien. Jusqu’à la fin du monde, on continuera d’évoquer la mort des Juifs dans les camps d’Hitler sous le nez épouvanté de millions de lecteurs, peu férus d’additions exactes et de rigueur historique. Là aussi, on attend un ouvrage sérieux sur ce qui s’est réellement passé, avec des chiffres vérifiés méthodiquement et recoupés ; un ouvrage impartial, non un ouvrage de propagande ; non pas des choses soi-disant vues et qui n’ont pas été vues ; non pas surtout des « confessions » criblées d’erreurs et de nonsens, dictées par des tortionnaires officiels – comme une commission du Sénat américain a dû le reconnaître – à des accusés [17] allemands jouant leur tête et prêts à signer n’importe quoi pour échapper au gibet. Ce fatras incohérent, historiquement inadmissible, a fait de l’effet, sans aucun doute, sur le vaste populo sentimental. Mais il est la caricature d’un problème angoissant, et malheureusement vieux comme le sont les hommes. L’étude reste encore à écrire – et d’ailleurs, nul éditeur ne la publierait ! – qui exposerait les faits exacts selon des méthodes scientifiques, les replacerait dans leur contexte politique, les insérerait honnêtement, dans un ensemble de rapprochements historiques, hélas tous indiscutables : la traite des Nègres, menée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles par la France et l’Angleterre, au prix de trois millions de victimes africaines succombant au cours de rafles et de transferts atroces : l’extermination, par cupidité, des Peaux- Rouges traqués à mort sur les terres des Etats-Unis d’aujourd’hui ; les camps de concentration d’Afrique du Sud où les Boers envahis furent parqués comme des bestiaux par les Anglais, sous l’oeil complaisant de Mr. Churchill ; les exécutions effroyables des Cipayes aux Indes, par les mêmes serviteurs de Sa Gracieuse Majesté ; le massacre par les Turcs de plus d’un million d’Arméniens ; la liquidation de plus de seize millions de non-communistes en U.R.S.S. ; la carbonisation par les Alliés, en 1945, de centaines de milliers de femmes et d’enfants dans les deux plus gigantesques fours crématoires de l’Histoire : Dresde et Hiroshima : la série de massacres de populations civiles qui n’a fait que se poursuivre et s’accroître depuis 1945 : au Congo, au Vietnam, en Indonésie, au Biafra. [18] On attendra encore longtemps, croyez-moi, avant qu’une telle étude, objective et de portée universelle, fasse le point sur ces problèmes et les soupèse sans parti pris. Même sur des sujets beaucoup moins brûlants toute explication historique reste encore, à cette heure, à peu près impossible, si l’on a eu le malheur de tomber, politiquement, du mauvais côté. Il est déplaisant de parler de soi-même. Mais enfin, de tous les chefs dits « fascistes » qui ont pris part à la Deuxième Guerre mondiale, je suis le seul survivant. Mussolini a été assassiné, et ensuite pendu. Hitler s’est tiré une balle dans la tête puis a été brûlé. Mussert, le leader hollandais et Quisling, le leader norvégien, ont été fusillés. Pierre Laval, après avoir subi une courte parodie de justice, s’est empoisonné dans sa geôle française. Sauvé à grand-peine de la mort, il fut abattu dix minutes plus tard, à demi paralysé. Le général Vlassov, le chef des Russes anti-soviétiques, livré à Staline par le général Eisenhower, a été accroché à un gibet sur une place moscovite. Même en exil, les derniers rescapés ont été sauvagement poursuivis : le chef de l’Etat croate, Anton Pavlevitch a été farci de balles en Argentine ; moi-même, traqué partout, n’ai échappé qu’au millimètre à diverses tentatives de liquidation par assassinat ou par rapt. Néanmoins, je n’ai pas encore été éliminé à l’heure actuelle. Je vis. J’existe. C’est-à-dire que je pourrais encore apporter un témoignage susceptible de présenter [19] historiquement un certain intérêt. J’ai connu Hitler de tout près, je sais quel être humain, vraiment, il était, ce qu’il pensait, ce qu’il voulait, ce qu’il préparait, quelles étaient ses passions, ses mouvements d’humeur, ses préférences, ses fantaisies. J’ai connu, de la même manière, Mussolini, si différent dans son impétuosité latine, ses sarcasmes, ses effusions, ses faiblesses, ses élans, mais, lui aussi, extraordinairement intéressant. Si des historiens objectifs existaient encore, je pourrais dont être, devant leurs fichiers, un témoins assez valable. Qui, parmi les survivants de 1945, a connu Hitler ou Mussolini plus directement que moi ? Qui pourrait, avec plus de précision que moi, expliquer quels types d’hommes ils étaient, hommes tout court, hommes tout cru ? Il n’empêche que je n’ai, exactement, que le droit de me taire. Même dans mon propre pays. Que je publie – vingt-cinq ans après les faits ! – en Belgique, un ouvrage sur ce que fut mon action publique, est tout simplement impensable. Or, j’ai été avant la guerre le chef de l’Opposition dans ce pays, le chef du Mouvement rexiste, mouvement légal, s’en tenant aux normes du suffrage universel, entraînant des masses politiques considérables et des centaines de milliers d’électeurs. J’ai commandé, durant les quatre années de la Deuxième Guerre mondiale, les volontaires belges du front de l’Est, quinze fois plus nombreux que ne le [20] furent leurs compatriotes combattant du côté des Anglais. L’héroïsme de mes soldats est indiscuté. Des milliers d’entre eux ont donné leur vie, pour l’Europe, certes, mais d’abord et avant tout, pour obtenir le salut de leur pays et préparer sa résurrection. Pourtant, aucune possibilité n’existe pour nous d’expliquer aux gens de notre peuple ce que furent l’action politique de REX avant 1941 et son action militaire d’après 1941. Une loi m’interdit formellement de publier une ligne là-dessus en Belgique. Elle prohibe la vente, la diffusion, le transport de tout texte que je pourrais écrire sur ces sujets ! Démocratie ? Dialogue ? Depuis un quart de siècle, les Belges n’entendent qu’un son de cloche- quant à l’autre cloche – la mienne ! – l’Etat belge braque sur elle tous ses canons. Ailleurs, ce n’est pas mieux. En France, mon livre La campagne de Russie, à peine paru, a été interdit. Il en fut de même, récemment encore, de mon ouvrage Les Ames qui brûlent. Ce livre est purement spirituel. Néanmoins il a été officiellement mis hors de circuit en France, et cela vingt ans après que ma vie politique eut été broyée ! Ce ne sont donc même pas les idées des excommuniés qui sont à l’index, mais c’est leur nom, sur lequel s’abat, inlassablement, l’inquisition démocratique. En Allemagne, mêmes procédés. L’éditeur de mon livre Die verlorene Legion fut, dès la parution du volume, l’objet de telles menaces, qu’il fit lui-même détruire, quelques jours après le lancement, [21] les milliers d’exemplaires qui allaient être distribués dans les librairies. Le record fut battu par la Suisse, où, non seulement la police confisqua des milliers d’exemplaires de mon livre La Cohue de 1940 deux jours après sa parution, mais où elle se précipita à l’imprimerie, y fit fondre sous ses yeux les plombs de la composition, afin que toute réimpression de l’ouvrage devînt matériellement impossible. Or, l’éditeur était suisse ! L’imprimerie était suisse ! Et si quelques personnages s’estimaient malmenés dans le texte, il leur était facile d’exiger de mon éditeur ou de moi-même des comptes en justice. Ce à quoi nul, bien entendu, ne se risqua ! Mêmes difficultés à l’oral qu’à l’écrit. J’ai mis au défi les Autorités belges responsables de me laisser m’expliquer devant le peuple de mon pays au Palais des Sports de Bruxelles ou d’accepter – rien de plus ! – que je me présente comme candidat aux élections du Parlement. Le peuple souverain eût tranché. Pouvait-on être plus démocrate ? Le ministre de la Justice répondit lui-même que je serais reconduit illico presto à la frontière si je débarquais à Bruxelles ! Pour être absolument sûr que je ne réapparaîtrai pas, on improvisa une loi spéciale, baptisée Lex Degreliana, qui prolongeait de dix ans les délais de ma prescription, arrivée à son terme ! Alors, comment les foules pourraient-elles soupeser les faits, les intentions, se faire une opinion ?… Et comment, face à un tel imbroglio, un jeune pourrait-il [22] déceler le vrai du faux, d’autant plus que l’Europe d’avant 1940 n’était pas un monobloc ? Chaque pays, au contraire, présentait des caractéristiques très particulières. Et chaque « fascisme » avait ses orientations propres. Le fascisme italien, par exemple, était très distinct du national-socialisme allemand. Socialement, les positions allemandes étaient plus audacieuses. Par contre, le fascisme italien n’était pas antijuif dans son essence. Il était de tendance plutôt chrétienne. Et plus conservateur aussi. Hitler avait liquidé les derniers vestiges de l’Empire des Hohenzollern tandis que Mussolini, même s’il y rechignait, continuait à suivre le plumeau, d’un demi-mètre de hauteur, qui agitait sa vaste ramure au-dessus de la petite bobine édentée du roi Victor-Emmanuel. La fascisme eût pu, tout aussi bien, être contre Hitler qu’avec Hitler. Mussolini était, avant tout, nationaliste. Après le meurtre du chancelier autrichien Dolfuss, en 1934, il avait aligné plusieurs divisions à la frontière du Reich. Au fond de lui-même, il n’aimait pas Hitler. Il s’en méfiait. - Faites attention ! Attention surtout à Ribbentrop ! me répéta-t-il vingt fois. L’Axe Rome-Berlin fut forgé, avant tout, par les maladresses et les provocations d’une grande presse des plus douteuse et de politiciens déchus et ambitieux, tel Paul-Boncour, pitre ébouriffé de Paris, don Juan dénervé et flétri des quais de Genève, tel Anthony Eden, long balai vernis de Londres, tel, surtout, Churchill. J’ai connu celui[23]-ci aux Communes à cette époque. Il y était très discuté et discrédité. Amer quand il avait l’estomac sec (c’était assez rare d’ailleurs), les dents tordues entre ses bajoues de bouledogue trop engraissé, on lui prêtait à peine attention. Seule une guerre pouvait encore lui offrir une ultime chance d’accéder au pouvoir. Il s’accrocha avec acharnement à cette chance-là. Mussolini, jusqu’à son assassinat, en 1vril 1945, resta, au fond de lui-même, anti-allemand et anti-Hitler, malgré tous les témoignages d’attachement que celui-ci lui prodigua. L’oeil noir, brillant comme une bille de jais, le crâne aussi lisse que le marbre des fonts baptismaux, les reins cambrés d’un chef de fanfare, il était né pour donner en spectacle sa supériorité. A vrai dire, Mussolini rageait de voir Hitler disposer d’un meilleur instrument humain le peuple allemand, discipliné, ne demandant pas trop d’explications) que celui qui était à sa portée (le peuple italien, charmant, se complaisant dans la critique, volage aussi, alouette vibrante qu’emporte le vent). De cette mauvais humeur, ressortait sourdement un étrange complexe d’infériorité, qu’aggravèrent de plus en plus les victoires d’Hitler qui, jusqu’à la fin de 1943, gagna toujours, malgré les risques inouïs qu’il prenait. Mussolini, par contre, chef d’Etat exceptionnel, n’avait pas plus la vocation d’un meneur de guerre qu’un garde champêtre romagnol. Bref, en tant qu’hommes, Hitler et Mussolini étaient différents. Le peuple allemand et le peuple italien étaient différents. En tant que doctrines, le fascisme et le national-socialisme étaient différents. [24] Il ne manquait pas de points de rencontres sur le terrain idéologique, de même que dans l’action, mais des oppositions existaient aussi, que l’Axe Rome-Berlin atténua, à ses débuts, mais que la défaite, frappant l’Italie dans son sang et son orgueil, amplifia, renforça. Si les deux principaux mouvements « fascistes » d’Europe, ceux-là mêmes qui s’étaient hissés au pouvoir à Rome et à Berlin, et qui barraient le continent de Stettin à Palerme, paraissaient déjà si distincts l’un de l’autre, qu’était-ce lorsqu’on considérait les autres « fascismes » surgis en Europe, que ce fût en Hollande ou au Portugal, en Roumanie, en Norvège ou ailleurs ! Le « fascisme » roumain était d’essence presque mystique. Son chef, Codreanu, arrivait à cheval, vêtu de blanc, aux grandes assemblées des foules roumaines. Son apparition semblait presque surnaturelle. C'est à tel point qu’on l’appelait l’Archange. L’élite militante de ses membres portait le nom de Garde de Fer. Le mot était dur comme étaient dures les circonstances de combat et les méthodes d’action. Les plumes des ailes de l’Archange étaient saupoudrées de dynamite. Par contre, le « fascisme » du Portugal était dépassionnalisé, comme l’était son mentor, le professeur Salazar, un cérébral, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui vivait dans une cellule monacale, était vêtu comme un clergyman, fixait les points de sa doctrine et les [25] étapes de son action aussi froidement que s’il eût commenté les Pandectes. En Norvège, c’était encore autre chose. Quisling était gai comme un croque-mort. Je le revois encore, la figure boursouflée, l’oeil morne, ténébreux, lorsque, Premier ministre, il me reçut à son palais d’Oslo, au bout d’une cour d’honneur où un roi, d’un bronze devenu vert comme un chou cueilli trop tôt, portait, haut et fier, un front criblé de déjections d’oiseaux. Quisling, malgré son allure compassée de chef comptable mécontent de sa caisse, était aussi militaire que Salazar l’était peu. Il s’appuyait sur des milices dont les bottes étaient nettement plus brillantes que la doctrine. Même l’Angleterre avait des « fascistes », ceux d’Oswald Mosley. A l’opposé des « fascistes » prolétariens du Troisième Reich, les fascistes anglais étaient, dans leur majorité, des fascistes aristocratiques. Leurs meetings rassemblaient des milliers de membres de la Gentry, venus voir ce que pouvaient bien être ces phénomènes lointains et fabuleux qu’on appelait les ouvriers (il y en avait tout de même un certain nombre chez Mosley). Les auditoires étaient bariolés des couleurs vives et voyantes de jeunes élégantes, moulées de tout près dans de fines robes de soie ; le contenant et le contenu vibraient de charme. Très excitant et très appétissant, ce fascisme ! surtout dans un pays où les longues perches [26] maigres du monde féminin tiennent si souvent de la plantation de houblon ! Mosley m’avait invité à déjeuner dans un théâtre désaffecté, perché sur la Tamise, où il recevait ses hôtes derrière un table de bois blanc. C’était austère et très capucin au premier abord. Mais des valet parfaits apparaissaient vite, et la vaisselle dans laquelle ils vous servaient était en or ! A côté de l’Hitler prolétarien, du Mussolini théâtral, du Salazar professoral, Mosley était le paladin d’un fascisme assez fantaisiste qui, si extraordinaire que cela paraisse, était conforme aux moeurs britanniques. L’Anglais le plus rigide tient à faire étalage de spécialités très personnelles, qu’elles soient politiques, ou vestimentaires. Mosley en apportait une de plus, comme Byron ou Brummel en avaient apporté d’autres jadis, et comme les Beatles en fourniraient d’autres beaucoup plus tard. Churchill lui-même tiendrait à se distinguer à sa façon, recevant d’importants visiteurs complètement nu, dans la majesté boudinée d’un roi Bacchus anglicisé, drapé dans la seule fumée de ses havanes. Le fils de Roosevelt, envoyé à Londres en mission pendant la guerre, crut mourir de suffocation lorsqu’il vit s’avancer vers lui un Churchill adamique, la panse soufflée, lardeux comme un cabaretier obèse qui achève de se laver l’arrière-train dans un baquet de zinc, le samedi soir. A l’extrême opposé, le Mosley d’avant 1940, le fasciste impeccable, coiffé d’un melon gris au lieu d’un casque d’acier, armé d’un parapluie de soie au lieu d’une matraque, ne sortait donc pas spécialement de la ligne de l’excentricité britannique. [27] Mais tout de même, le fait que les Anglais, solennels comme des portiers de ministères et conservateurs comme des moteurs de Rolls Royce, se soient laissé griser, eux aussi, par les fluides des fascismes européens d’avant 1940, dit jusqu’à quel point le phénomène correspondait en Europe à un état d’esprit général. Pour la première fois depuis la Révolution française, malgré la diversité des nationalismes, des idées brûlantes et un idéal brûlant provoquaient des réactions assez identiques. Une même foi jaillissait, en même temps, d’un bout à l’autre du vieux continent, que ce fût à Budapest, à Bucarest, à Amsterdam, à Oslo, à Athènes, à Lisbonne, à Varsovie, à Londres, à Madrid, à Bruxelles, ou à Paris. A Paris, non seulement les poussées fascistes possédaient leurs caractéristiques propres, mais, en outre, elles se décomposaient en des subdivisions multiples : de tendance dogmatique, avec Charles Maurras, vieillard barbichu, courageux, intègre, sourd comme un débiteur, père intellectuel de tous les fascismes européens mais limitant le sien, jalousement, au pré carré français ; de tendance militaire, avec les anciens combattants de 1914-1918, émouvants, sonnaillants, sans idées ; de tendance « classes moyennes », avec les Croix de Feu du colonel de La Rocque, qui adorait multiplier avec les civils les grandes manoeuvres et les inspections de caserne ; de tendance prolétaire avec le Parti Populaire Français de Jacques Doriot, ancien « coco » à lunettes, jouant volontiers, dans sa propagande, de ses grosses godasses, de ses bre[28]- telles, du tablier de cuisine de sa femme, pour faire peuple, un peuple qui lui resta rétif, dans son ensemble, après un début assez réussi ; de tendance activiste et sentant la poudre, avec la Cagoule d’Eugène Deloncle et de Joseph Darnand, des durs, des fonceurs, qui dynamitaient avec ravissement, en plein Paris, les centrales engourdies des super-capitalistes, pour les sortir avec éclat de leur assoupissement doré. Deloncle, polytechnicien génial, serait abattu par les Allemands de 1943 et Joseph Darnand, par les Français de 1945 malgré qu’il eût été l’un des héros les plus impavides des deux guerres mondiales. Cette surabondance de mouvements parisiens « fascistes », théoriquement parallèles et pratiquement rivaux, divisait et désorganisait les élites françaises. Elle aboutirait, le soir du 6 février 1934, aux émeutes sanglantes de la place de la Concorde à Paris, sans que le pouvoir, tombé dans le talus de la panique, fût repris en mains par un seul des vainqueurs de la « Droite ». Leur grand homme de cette nuit-là s’appelait Jean Chiappe, préfet de police de Paris, révoqué trois jours plus tôt par le gouvernement de Gauche. C’était un Corse volubile, rougeoyant, portant une rosette de la Légion d’honneur du format d’une tomate, tout petit malgré des semelles superposées et qui faisaient croire, lorsqu’il nous parlait, qu’ il était perché sur un tabouret. Tout en se portant comme un cerisier printanier, il se tâtait les côtes, se soignait ; rhumatisant disait-il, il n’était même pas sorti le 6 février avec les manifestants. Il venait de prendre un bain chaud et se préparait à se coucher, en pyjama déjà. Malgré les objurgations de plus en plus insistants, puis affolées, de ses fidèles, il refusa [29] de se rhabiller, alors qu’il n’aurait eu qu’à traverser la rue pour s’asseoir dans le fauteuil vide de l’Elysée ! En 1958, le général de Gaulle, en face su même fauteuil, ne se ferait pas autant prier ! Entre ces multiples partis « fascistes » francais, le dénominateur commun avant 1940 était faible. En Espagne, le général Primo de Rivera avait, avant bien d’autres, été un « fasciste » à sa manière, « fasciste monarchiste, un peu comme Mussolini. Cette concession au trône contribua beaucoup à sa perte. Trop de courtisans de palais, spécialistes des crocs-en-jambe, lisses comme des anguilles, creux comme des tuyaux, le guettaient. Trop peu de prolétaires l’épaulaient, prolétaires au coeur simple, aux bras forts, qui eussent peu, tout aussi bien, suivre un Primo de Rivera attelé à la réforme sociale de son pays, que s’aligner derrières les pistoleros et les incendiaires du Frente Popular. Les comploteurs de cour enlisèrent cette expérience dans la glu des préjugés d’une aristocratie salonnarde, vaniteuse et politiquement stérilisée depuis plusieurs siècles. José-Antonio, fils du général déboulonné et mort à Paris quelques jours plus tard, était un orateur inspiré. Il avait compris, lui, malgré son hérédité de senorito, que l’essentiel du combat politique de son époque résidait dans le fait social. Son programme, son éthique, son fluide personnel eussent pu lui rallier des millions d’Espagnols qui rêvaient d’un renouveau de leur pays, non seulement dans la grandeur et dans l’ordre mais aussi, et surtout, dans la justice sociale. Malheureusement [30] pour lui, le Frente Popular avait miné partout le terrain, égaré les masses, hissé entre les Espagnols les barrages de la haine, du feu et du sang. José-Antonio eût pu être le jeune Mussolini de l’Espagne de 1936. Ce grand garçon splendide vit son rêve fauché l’année même par un peloton d’exécution à Alicante. Ses idées marquèrent longtemps son pays. Elles animèrent des centaines de milliers de combattants et de militants. Elles rebondiraient même, revivifiées par les héros de la Division Azul, jusqu’aux neiges ensanglantées du front russe, apportant leur part à la création de la nouvelle Europe d’alors. On le voit, l’Espagne de 1939 n’était pas l’Allemagne de 1939. Pas plus que le colonel de La Rocque, à Paris, raide comme un métronome et l’esprit terne comme une coulée de macadam, n’était le sosie du docteur Goebbels, vif comme un flash de reporter ; par plus qu’un Oswald Mosley, le fasciste raffiné de Londres, n’était l’alter ego de l’épais docteur Ley de Berlin, violet comme un baril de vin nouveau. Pourtant un même dynamisme travaillait partout leurs foules, une même foi les soulevait, et même un soubassement idéologique asse semblable se notait chez eux tous. Ils avaient en commun les mêmes réactions vis-à-vis des vieux partis, sclérosés, corrompus dans des compromissions sordides, dépourvus d’imagination, n’ayant apporté, nulle part, de solutions sociales qui fussent vastes et vraiment révolutionnaires, alors que le peuple, accablé d’heures de travail, payé misérablement (six pese[31]-tas par jour sous le Frente Popular !) sans protection suffisante contre les accidents de travail, les maladies, la vieillesse, attendait avec impatience et angoisse d’être enfin traité avec humanité, non seulement matériellement mais moralement. Je me souviendrai toujours du dialogue que j’entendis, à l’époque, dans une fosse de charbonnage où était descendu le roi des Belges : - Que désirez-vous ? demanda le souverain, assez guindé, plein des meilleures intentions, à un vieux mineur, noir de suie. - Sire, répondit celui-ci, tout de go, ce que nous voulons, c’est qu’on nous respecte ! Ce respect du peuple et cette volonté de justice sociale s’alliaient, dans l’idéal « fasciste », à la volonté de restaurer l’ordre dans l’Etat et la continuité dans le service de la nation. Besoin de s’élever spirituellement aussi. A travers tout le continent, la jeunesse rejetait la médiocrité des politiciens professionnels, pense-petit redondants, sans formation, sans culture, électoralement appuyés sur des cabarets et sur des semi-notables, affublés de femmes épousées trop tôt, mal foutues, dépassées par les événements et qui fauchaient la moindre idée ou la moindre audace du mari à grands coups de sécateurs. Cette jeunesse voulait vivre pour quelque chose de grand, de pur. Le « fascisme » était jailli partout, en Europe, spontanément, avec des formes très diverses, de ce besoin vital, [32], total et général, de rénovation : rénovation de l’Etat, fort, autoritaire, ayant le temps pour lui, et la possibilité de s’entourer de compétences, échappant aux aléas de l’anarchie politique ; rénovation de la société, dégagée du conservatisme asphyxiant de bourgeois gantés et à col dur, sans horizons, violets de victuailles trop riches et de bourgogne trop épais, fermés intellectuellement, sentimentalement et surtout financièrement, à toute idée de réformes ; rénovation sociale, ou plus exactement, révolution sociale, liquidant le paternalisme, si cher aux nantis, qui jouaient à bon compte, avec des trémolos calculés, aux grands coeurs et préféraient à la reconnaissance des droits de la justice, la répartition condescendante des charités limitées et très appuyées ; révolution sociale remettant le capital à sa place d’instrument matériel, le peuple, substance vivante, redevenant la base essentielle, l’élément primordial de la vie de la Patrie ; rénovation morale enfin en réapprenant à une nation, à la jeunesse avant tout, à s’élever et à se donner. Il n’est pas un pays d’Europe qui, entre 1930 et 1940, ait échappé à cet appel. Celui-ci présentait des nuances distinctes, des orientations distinctes, mais il possédait, politiquement, socialement, des bases assez semblables, ce qui explique que rapidement se tissa une étonnante solidarité : le Français « fasciste » allait, inquiet d’abord mais assez vite enthousiasmé, assister aux défilés des « Chemises brunes » à Nuremberg ; les Portugais chantaient le Giovinezza des Balilas, comme le Sévillan chantait le Lili Marleen des Allemands du Nord. [33] Dans mon pays, le phénomène surgirait comme ailleurs avec ses caractéristiques propres, que coifferaient au court de peu d’années les éléments unificateurs surgis de la Deuxième Guerre mondiale dans les divers pays européens. J’étais, à ces temps-là, un tout jeune garçon. Au dos d’une photo, j’avais écrit (j’étais déjà modeste) : Voici plus ou moins vrais, les traits de mon visage Le papier ne dit pas le feu brûlant et fier Qui me brûle aujourd’hui, qui me brûlait hier Et qui demain éclatera comme un orage. L’orage, je le portais en moi. Mais qui d’autre le savait ? A l’étranger, personne ne me connaissait. J’avais le feu sacré, mais ne disposais d’aucun appui qui puisse brusquement assurer une grande réussite. Pourtant, une seule année me suffirait pour rassembler des centaines de milliers de disciples, pour mettre en pièces la tranquillité somnolente des vieux partis et pour envoyer au Parlement belge, en un seul coup, trente et un de mes jeunes camarades. Le nom de REX, en quelques semaines, au printemps de 1936, serait révélé au monde entier. J’arrivais au bord même du pouvoir à vingt-neuf ans, à l’âge où normalement les garçons prennent un apéritif à une terrassent et lissent les doigts d’une jolie fille aux yeux émus. Temps prodigieux où nos pères n’avaient plus qu’à nous suivre où, partout, des jeunes, aux yeux de loups, aux dents de loups, se dressaient, bondissaient, gagnaient, se préparaient à changer le monde ! Chapitre III Vers le pouvoir à vingt-cinq ans [35] j’ai vu, à trente-huit ans, éclater en mille débris ma vie de chef politique et se briser ma vie militaire (général, commandant un Corps d’Armée). Comment, voilà vingt-cinq ans, pouvait-on forcer si jeune à travers la vie d’un Etat, arriver au seuil du pouvoir si vite et si tôt ? La réussite, c’est l’évidence, dépend des époques. Il en est certaines qui suintent l’ennui et qui étouffent toute vocation. Il en est d’autres, où ce qui est exceptionnel surgit, s’accroît, se déploie. Bonaparte, né cinquante ans plus tôt, eût sans doute terminé sa carrière comme commandant de place bedonnant dans une ville de province. Hitler, sans la Première Guerre mondiale, eût sans doute végété, comme semibourgeois aigri, à Munich ou à Lintz. Et Mussolini eût pu rester instituteur en Romagne tout sa vie, ou passer celle-ci à la prison de Mamertine, comploteur impénitent, aux siècles ensommeillés des Etats pontificaux. Les courants spirituels et passionnels, ainsi que les exemples qui animaient l’Europe vers les [36] années 1930, ont ouvert des horizons exceptionnels aux vocations et aux ambitions. Tout fermentait. Tout éclatait : la Turquie d’Ataturk – colosse impressionnant de santé, festoyant la nuit comme un soudard, exerçant, le jour, une autorité omnipotente, le seul dictateur qui ait eu la chance de mourir à temps, c’est-à-dire dans son lit – aussi bien que l’Italie dont venait de s’emparer Mussolini, César motorisé. D’un pays anarchiste et lassé, le Duce avait, en quelques années, refait un pays ordonné. Si j’étais italien, je serais fasciste, s’était écrié un jour Winston Churchill. Il me répéta lui-même cette affirmation, un soir, à table, à Londres, au restaurant des Communes. Et pourtant, l’Italie l’irritait, elle qui avait osé passer du rôle modeste que lui assignaient les Puissants, à celui de pays impérial, réservé, jusqu’alors, en exclusivité, à la boulimie et à l’orgueil britanniques. Plus que n’importe quoi, l’exemple de Mussolini avait fasciné l’Europe et le monde. On le photographiait le torse nu, fauchant les blés dans les marais Pontins asséchés. Ses avions franchissaient, en escadres impeccables, l’Atlantique. Une Anglaise était accourue à Rome, non pour lui crier un amour hystérique, comme beaucoup d’autres, mais pour décharger sur lui, fort peu aimablement, une balle qui lui avait rasé une aile du nez. Ses jeunes Balillas défilaient partout en chantant. Ses ouvriers inauguraient d’impressionnantes installations sociales, les plus vivantes du continent, en cette époque-là. Les trains italiens ne s’arrêtaient plus en pleine campagne, comme en 1920, pour obliger à descendre le curé qui avait eu le front d’y prendre place ! L’ordre régnait. Et la vie. Tout progres[37]-sait. Sans paris pour criailler. Et sans grabuges sociaux. L’Italie industrielle naissait, de l’ENI à la Fiat, où Agnelli créait, sur ordre du Duce, une voiture populaire bien avant qu’il ne partît avec les volontaires italiens au front russe, en 1941, où il lutta à nos côté dans le bassin du Donetz. Cette Italie industrielle qui fit sa trouée mondiale après que Mussolini fut mort, c'est – on l’oublie trop souvent – Mussolini qui la créa. Son grand Empire africain allait s’étendre, en quelques années, de Tripoli à Addis-Abéba, sans que Mussolini se laissât intimider par les protestations internationales de pays hypocrites qui s’étaient repus d’abord et ne supportaient pas l’idée que les pays pauvres eussent l’insolence de s’épanouir ou, tout du moins, de manger à leur faim sans devoir laisser émigrer misérablement, chaque année, cent mille ou deux cent mille estomacs creux vers les bas-fonds de Brooklyn ou vers les fièvres des pampas sudaméricaines. Dans chaque pays, des milliers d’Européens regardaient Mussolini, étudiaient le fascisme, en admiraient l’ordre, le panache, l’élan, les importantes réalisations politiques et sociales. - On devrait en faire autant ! répétaient-ils, en hochant la tête. D’innombrables mécontents et, surtout, toute une jeunesse assoiffée d’idéal et d’action, aspiraient à ce que quelqu’un les soulevât, à leur tour, comme Mussolini l’avait fait sans sa partie. Même en Allemagne, l’exemple italien ne manqua pas d’aider à la victoire d’Hitler. Certes, Hitler se fût suffi [38] à lui-même. Il possédait un sens prodigieux des foules et de l’action, un courage éclatant. Il risquait sa peau chaque jour. Il cognait. Il lançait des idées-force élémentaires. Il enflammait des masses de plus en plus véhémentes. Il était rusé et, en même temps, un organisateur extraordinaire. Le père d’Hitler était mort très tôt, un matin, frappé d’apoplexie, tombant la tête en avant dans la sciure de bois d’un café. Sa mère s’était éteinte, tuberculeuse, peu d’années après. A seize ans il était orphelin. Plus jamais personne ne l’aiderait. Il devrait faire sa percée tout seul. Il n’était même pas citoyen allemand. Il allait pourtant, en douze ans, devenir le chef du plus important parti du Reich, puis son chancelier. En 1933, i était le maître, il s’était hissé au pouvoir, démocratiquement, soulignons-le, approuvé par la majorité absolue des citoyens allemands et par un Parlement élu selon des normes démocratiques, où démocrates-chrétiens et socialistes approuveraient, par un vote positif, la confiance à son gouvernement naissant. Des plébiscites, de plus en plus impressionnants, réaffirmeraient ce soutien populaire. Et ces plébiscites étaient sincères. On a prétendu le contraire, par la suite. C’est matériellement faux. Dans la Sarre, province allemande jusqu’alors occupée par les Alliés, qui y étaient installés depuis l’automne de 1918, le plébiscite fut organisé et surveillé par des délégués étrangers, appuyés sur des troupes étrangères. Hitler ne fut même pas autorisé à faire acte de présence dans cette région pendant la campagne électorale. Pourtant il obtint en Sarre exactement le même vote triomphal (plus de quatre-vingts pour cent des voix) que dans le reste de l’Allemagne. Des propor[39]-tions identiques se retrouvèrent à Dantzig et à Memel, villes allemandes, elles aussi sous contrôle étranger. Le vrai est le vrai : l’immense majorité des allemands, ou bien s’étaient rangés derrière Hitler dès avant sa victoire, ou bien, dans un enthousiasme sans cesse croissant, avaient rallié ses troupes, comme le firent des millions d’ex-socialistes et d’ex-communistes, convaincus des bienfaits de son dynamisme. Il avait remis de millions de chômeurs au travail. Il avait injecté une force nouvelle à tous les secteurs de la vie économique. Il avait rétabli partout l’ordre social et politique, un ordre mâle, mais aussi un ordre heureux. La fierté d’être allemand rayonnait dans tout le Reich. Le patriotisme avait cessé d’être une tare, il se déployait comme un étendard glorieux. Prétendre le contraire, affirmer qu’Hitler n’était pas suivi par son peuple, est déformer grossièrement l’état d’esprit d’alors et nier l’évidence des faits. A l’extrême opposé, et exactement à la même époque, l’Espagne du Frente Popular étonnait l’observateur étranger par ses violences absurdes et par sa stérilité. Bien avant de perdre la guerre militairement, le Frente Popular avait, en Espagne, perdu la guerre socialement. Le peuple ne vit pas de coups de fusils tirés sur des bourgeois plus ou moins bornés ou sur des curés rondouillards, ni sur de [sic] squelettes de carmélites qu’on déterre pour les exposer à la rue d’Alcala. Le Frente Popular avait été incapable – et c’était cela, pourtant, qui importait – de créer en Espagne ne fût-ce qu’une ébauche de réforme sociale. On ne le [40] répétera jamais assez au jeunes ouvriers espagnols : leurs pères, de 1931 à 1936, ne connurent rien d’autre, sous leurs chefs rouges – parmi les pétarades des assassinats et les incendies de couvents – que des salaires scandaleusement misérables, l’instabilité de l’emploi, l’insécurité face à la maladie, à l’accident, à la vieillesse. Le Frente Popular eût dû – c’était l’occasion ou jamais de prouver que les politiciens de Gauche défendaient le peuple ! – donner à l’Espagne ouvrière des salaires qui lui eussent permis de vivre, des assurances sociales qui eussent garanti matériellement son existence, menacée par l’égoïsme capitaliste, par les grèves et par les crises, qui eussent assuré à la famille du travailleur la sécurité en cas d’accident ou de décès de ce dernier. Socialement, le Frente Popular fut un zéro sanglant. En 1936, sa faillite sociale et politique face aux réalisations sociales, puissantes, toujours accrues, du fascisme et de l’hitlérisme, sautait aux yeux de tous les spectateurs objectifs. Elle ne pouvait que mettre davantage en relief les bienfaits des formules d’ordre, politique et social, la malfaisance des formules démagogiques, communistes ou socialistes, que ce fût dans un Moscou écrasé – et sans cesse purgé – par Staline, ou dans l’anarchie de Madrid où le Frente Popular achevait, avec une lâcheté de lapins, d’enlever en pleine nuit et de faire assassiner à la mitrailleuse, par ses policiers, le chef de l’opposition, le député Calvo Sotelo. Dans cette atmosphère, la crise ne pouvait que se précipiter au sein de chaque pays d’Europe. Elle m’aida, c’est certain, à planter en un tournemain ma bannière sur les remparts de la vieille citadelle politique, décré-[41]pite dans mon pays comme elle l’était alors dans tous les pays du continent. Bien sûr, moi aussi, j’étais né pour ce combat. L’occasion, les circonstances aident. Elles dégagent le terrain mais elles ne suffisent pas. Il faut posséder le flair politique, le sens de l’action, sauter sur les occasions, inventer, renouveler sa propre tactique en cours de route, n’avoir jamais peur de rien et, surtout, être embrasé par un idéal que rien n’arrête. Jamais, au cours de toute mon action publique, je n’ai douté, une seconde, de mon succès final. Qui, devant moi, eût émis la moindre réserve à ce propos, m’eût stupéfié. Ai-je disposé, au moins, de collaborations extraordinaires, ou de moyens imposants ? En aucune façon. Absolument pas. je n’ai été poussé par aucune personnalité, même de second ordre. J’ai atteint mon grand triomphe électoral de 1936 en ayant pêché des candidats n’importe où, sans secours financier d’aucun dirigeant ni d’aucun groupe économique. J’étais né au fond des Ardennes belges, dans une petite bourgade de moins de trois mille habitants. Nous vivions enserrés, mes parents, bons bourgeois provinciaux, et se sept frère [sic] et soeurs, au creux de nos montagnes. La vie de famille. La rivière. Les forêts. Les champs. A quinze ans, j’étais entré, à Namur, au collège des jésuites. Dés alors j’écrivais. Et même, je parlais parfois en public. Mais combien d’autres écrivent ou parlent ! A vingt ans, étudiant en droit et en sciences politiques à l’université de Louvain, j’avais publié quelques bouquins. [42] Je sortais un journal hebdomadaire. Mes papiers se lisaient. Mais, enfin, tout cela était encore à peu près normal. Puis le démarrage s’accéléra. Je repris une maison d’édition de l’Action catholique, qui s’appelait REX (Christus-REX), d’où naquit l’hebdomadaire REX qui allait, en deux ans, atteindre des tirages véritablement fabuleux pour la Belgique d’alors : 240 000 exemplaires vendus, à chaque numéro. J’avais dû me débrouiller. Lancer à travers un pays un grand mouvement politique apparaît à tous comme une entreprise qui réclame de nombreux millions. Je ne possédais pas d’argent, c’était bien simple. J’ai débuté en publiant à brûle-pourpoint des brochures, collées à chaque événement un peu sensationnel. J’en rédigeais le texte en une nuit. Je les lançais tapageusement, comme une marque de savon ou de sardines, à coups d’imposants placards, payés, dans la grande presse. J’avais, très rapidement, monté une équipe de quatorze propagandistes motorisés (motos gratuites, compensées en publicité dans mes premières publications). Ils couraient par tout le pays, collaient mes brochures aux dirigeants des établissements scolaires qui aimaient empocher des commissions considérables en confiant la diffusion de mes papiers à leur marmaille. Les conducteurs de mes bolides rugissants étaient payés, eux aussi, uniquement d’après leur chiffre de vente. Mes brochures atteignirent vote des tirages très élevés : jamais moins de [43] 100 000 exemplaires ; e même, une fois, 700 000 exemplaires. Donc, ça tournait rond. Lorsque mon hebdomadaire REX parut, je disposais déjà, en plus de mes agents motorisés, de groupes nombreux de propagandistes acharnés. Ils se baptisèrent eux-mêmes Rexistes. Ils entreprirent la grande conquête du public, postés partout aux entrées des églises et des cinémas. Chaque centre de propagande de REX vivait de ses ristournes et supportait, grâce à elles, tous ses frais. Bientôt notre presse fut une source de revenus considérables, couvrant tous les débours de notre action. On peut dire que le développement foudroyant de REX se fit ainsi, grâce à une presse écrite de façon dynamique et vendue de façon dynamique, payée par les lecteurs qui financèrent eux-mêmes, complètement, la grande percée du rexisme. Notre combat m’obligea brusquement à créer un quotidien, le Pays réel. Je disposais de dix mille francs. Pas un centime de plus. De quoi payer le tiers de l’édition du premier jour. Il fallut trimer. J’écrivais moimême l’essentiel du journal, dans des conditions impossibles. Ma copie représentait l’équivalent d’un volume de trois cent pages tous les quinze jours. Mais le quotidien fit sa percée, atteignit après notre victoire, un tirage sensationnel : en octobre 1936, plus de 200 000 exemplaires de moyenne quotidienne, vérifiée par un constat d’huissier, chaque nuit. Mais la conquête politique d’un pays doit pouvoir s’appuyer sur la parole autant que sur l’écrit. On n’avait [44] jamais vu un mouvement politique, en Belgique, ou ailleurs, réunir des auditeurs sans qu’il en coûtât très cher aux organisateurs. Or, décaisser de telles sommes ou même des sommes beaucoup moindres, m’était matériellement impossible. Il me fallait donc atteindre les auditeurs comme j’avais atteint les lecteurs, sans nulle dépense. Je cherchai le public qui ne me coûterait rien. Dans les meetings marxistes, la contradiction était offerte sur les affiches, bien que nul ne se présentât jamais à cette gin, chacun tenant à ses os et à leur intégrité. Je m’y amenai, ponctuel. Chaque soir, j’étais là. - C’est le Léon ! murmurait la foule. Chaque rapidement, un public considérable me connut. Et les bagarres déchaînées pour me mettre à bout m’aidèrent puissamment, répercutées par la presse. Mes os, à part une fracture du crâne en 1934, étaient restés remarquablement intacts. Entre-temps, nos propagandistes, en flammés par leur idéal, émoustillés par cette action directe et par ces risques, étaient devenus des milliers : les garçons les plus ardents, les filles les plus belles et les mieux bâties. – Le Rex- Appeal, dirait le roi Léopold. Je pus alors monter mes propres meetings. Meetings qui, dès le premier jour, furent payants. Ça ne s’était jamais vu, mais je tins bon. Jusqu’au dernier soir des campagnes électorales, l’auditeur belge aligna, chaque soir, cinq francs, au moins, pour m’entendre. L’explication avait été nette : une salle coûte tant ; la publicité, tant ; le chauffage, tant ; l’éclairage, tant ; total : tant ; chacun paie sa part ; c’est clair et c’est propre. Je donnai ainsi, en trois ans, plusieurs milliers de meetings, plusieurs chaque soir, de deux heures chaque fois, ou davantage, toujours contradictoires. Un jour, je [45] parlai quatorze fois, de sept heures du matin jusqu’à trois heures du matin de la nuit suivante. Je choisissais les salles les plus grandes, telles que le Sport-Paleis à Anvers (35 000 places) et le Palais des Sports de Bruxelles (25 000 places). Plus de 100 000 F d’entrées chaque fois ! J’y donnai même six grands meetings, six jours de suite, que j’appelai les Six Jours, puisque je battais ce record dans la plus grande enceinte cycliste de Belgique : 800 000 F d’entrées ! Je louais des usines désaffectées. Je montai, en plein air, à Lombeck, aux portes de Bruxelles, un meeting où accoururent plus de 60 000 auditeurs ; 325 000 F d’entrées ! Cet argent m’importait peu. Jamais, comme chef de REX, je n’ai touché un centime de traitement. L’argent de vaut que comme moyen d’action. Mais nous possédions ainsi, partout, sans bourse délier, un second et formidable moyen d’action. L’imagination fit le reste. Nos propagandistes peignaient les ponts, les arbres, les routes. Ils badigeonnèrent même des troupeaux entiers de vaches qui arborèrent, sur leurs flancs, le long de lignes de chemin de fer, les trois énormes lettres rouges de REX, mettant de bonne humeur les usagers des trains, enchantés par l’imprévu du spectacle. En un an, sans appui de quiconque, à force d’acharnement, de sacrifices et de foi, nous avions, à quelques milliers de jeunes garçons et de jeunes filles, révolutionné toute la Belgique. Dans leurs pronostics électoraux, les vieux politiciens ne nous accordaient pas un élu : nous en eûmes trente et un, d’un seul coup ! Certains étaient vraiment des gamins. Celui qui culbuta le ministre de la Justice, à Renaix, avait tout juste sa majorité électorale, ces jours-là ! La preuve avait été [46] faite qu’avec de la volonté et surtout lorsqu’un idéal puissant vous jette en avant, tout peut s’enfoncer et tout peut se gagner. La victoire est à ceux qui veulent et à ceux qui croient. Je dis cela pour encourager des jeunes, ardents, qui douteraient de leur réussite. Mais, en réalité, qui doute de réussir ne peut pas réussir. Celui qui doit forcer le Destin porte en lui des forces inconnues que des savants perspicaces et tenaces découvriront certainement un jour, mais qui n’ont rien à voir avec la machinerie, physique et psychique, de l’être normal. - Si j’étais un homme comme les autres, je serais maintenant en train de boire un pot de bière au Café du commerce, m’avait répondu Hitler, un jour où je lui racontais, sur on ton goguenard, que le génie est normalement anormal. Mussolini n’était pas, lui non plus, un être « normal ». Napoléon ne l’avait pas été avant lui. Lorsque les forces anormales qui le soutenaient l’abandonnèrent, sa vie publique s’abattit au sol, comme un aigle dont on eût fauché les deux ailes, tout d’un coup. Mussolini, durant la dernière année de sa vie, - c’était visible et c’était tragique – flottait comme un radeau déboussolé, sur une mer qui l’absorberait n’importe quand. Lorsque la vague mortelle fut là, il l’accueillit sans réaction. Sa vie était finie depuis que les forces inconnues qui l’avaient fait Mussolini avaient cessé d’être son sang secret. Le sang secret. C’est cela. Les autres ont un sang commun, analysé, catalogué. Ils deviennent, lorsqu’ils réussissent, d’honnêtes généraux à la Gamelin, con[47]-naissant toutes les ficelles d’état-major et les tirant avec correction, ou des hommes politiques à faux col, à la Poincaré, méticuleux, appliqués et ordonnés comme des receveurs de contribution. Ils ne cassent rien. L’humanité normale débouche, à son stade supérieure, sur des forts en thème, que le thème soit l’Etat, ou l’Armée, ou la construction impeccable d’un gratte-ciel, d’une autoroute ou d’un ordinateur. En dessous de ces esprits normaux qui se sont distingués, paît l’immense troupeau des êtres normaux qui ne se sont pas distingués. L’humanité, c’est eux : quelques milliards d’êtres humains au cerveau moyen, au coeur moyen, au train-train moyen. Et voilà qu’un jour, brusquement, le ciel d’un pays est traversé par le grand éclair foudroyant de l’être qui n’est pas comme les autres, dont on ne sait pas encore au juste ce qu’il a d’exceptionnel. Cet éclair-là atteint, dans l’immense foule, des forces de la même origine que la sienne, mais atrophiées et qui, recevant le choc émetteur, se raniment, répondent, correspondent, à petite échelle, sentant, néanmoins, leur vie transformée. Ils sont animés, soulevés par des fluides qui n’avaient jamais atteint leur vie normal et dont ils n’avaient jamais soupçonné qu’ils transperceraient leur existence. L’homme de génie est ce formidable poste émetteur et récepteur, qu’il s’appelle Alexandre ou Gengis Khan, Mahomet ou Luther, Victor Hugo ou Adolf Hitler. Les génies, entraîneurs de peuples, les génies, enchanteurs de couleurs, de volumes ou de mots, sont projetés, à des [48] degrés plus ou moins intenses, vers des destins inéluctables. Certains fous sont aussi, sans doute, des génies, des génies qui ont dérapé, dans le potentiel mystérieux desquels un engrenage a dû être faussé, ou mal emboîté au départ. En fait, de cette nature des génies, les savants, les médecins, les psychologues ne savent encore à peu près rien. Mais un génie ne se fabrique pas, il n’est pas le résultat d’un énorme travail, il relève d’un état physique et psychique jusqu’à présent ignoré, d’un cas spécial qui doit se produire une fois sur cent mille, ou sur un million, ou sur cent millions. D’où l’ahurissement du public. Et le côté grotesque des jugements portés par l’être banal sur l’être extraordinaire qui le dépasse en tout. Quand j’entends des primaires émettre avec assurance des jugements olympiens sur Hitler, ou tout aussi bien sur Van Gogh ou sur Beethoven, ou sur Baudelaire, j’ai parfois envie de pouffer de rire. - Qu’y comprennent-ils ? L’essentiel leur échappe, parce qu’ils ne possèdent pas activement cette force-mystère qui est l’essentiel du génie, soit du génie total, au survoltage maximum, soit du génie limité parce que son pouvoir d’expansion est moins chargé, moins dense, moins riche, ou qu’il est orienté vers un secteur limité. Le génie, bon ou mauvais, est, qu’on le veuille ou non, la levure de la lourde et monotone pâte humaine. Celle-ci retomberait sur elle-même sans ce stimulant. Cette levure est indispensable. Et la Nature ne la dispense que très chichement. Encore faut-il que les circonstances soient là, qui permettent à ces molécules de vie supérieure de féconder la nature uniforme, mille fois plus considérable, matériellement, mais qui, laissée à elle seule, est vaine, [49] végète, ne représente rien. Sans le génie qui, de temps en temps, le transperce, le monde serait un monde de commis. Seul le génie fait que l’univers sort parfois de sa médiocrité et le dépasse. L’éclair éteint, il retombe dans la grisaille dont, seul, un éclair nouveau le fera peut-être un jour resurgir. C’est pour cela que l’époque des fascismes, où jaillirent des génies authentiques, fut captivante. Parmi des circonstances exceptionnelles surgissaient des transformateurs de peuple au rayonnement exceptionnel. Le monde allait, à cause d’eux, connaître un des plus extraordinaire virage de son histoire. - Tout a mal tourné ? Qu’en savons-nous ? A la chute de Napoléon, tout, aussi, avait, croyait-ton, mal tourné. Et pourtant, Napoléon a marqué l’humanité pour toujours. Sans Hitler, serions-nous même simplement au seuil de l’exploitation de l’atome ? Une seule fusée existerait-elle ? Or, le changement radical de notre époque part d’elles. La décharge de génie qu’Hitler, s’il a – et c’est tout un ensemble à analyser – provoqué des catastrophes, a certainement aussi apporté une transformation radicale à l’orientation de l’humanité. L’univers nouveau, jailli du drame hitlérien, a, en quelques années, provoqué un changement irréversible des conditions de vie, du comportement des individus et de la société, de la science et de l’économie, des méthodes et des techniques de pro[50]-duction, changements plus considérables que tous ceux qu’avaient apporté les cinq derniers siècles. Hitler n’a peut-être été que la cartouche de dynamite qui a déclenché l’explosion géante de notre temps et provoqué le bouleversement du monde contemporain. Mais le bouleversement a eu lieu. Sans Hitler, nous serions restés, peut-être encore pendant des centaines d’années, les mêmes petits bourgeois rassis que nous étions au premier quart du siècle. Dès 1935, la mise à feu du satellite Hitler était inévitable. Le génie, ça ne s’arrête pas. pendant le compte à rebours, chaque pays allait participer, à sa manière, et souvent inconsciemment, à ce bouleversement fantastique, certains se comportant comme des pôles négatifs – la France et l’Empire britannique, par exemple – d’autres constituant les pôles positifs, chacun d’eux accouplant des pièces de la machinerie d’où jaillirait le monde futur. Mais, en 1936, quel devin eût imaginé que le monde vieillot où il vivait allait connaître une si totale mutation ? Hitler, grondant des forces inconnues qui étaient sa véritable vie, se rendait-il même exactement compte du destin qui l’attendaient, et qui nous attendait tous ? Moi, comme les autres, je ne voyais encore que mon peuple à extraire des marais politiques, à sauver, moralement autant que matériellement. En 1936, le pays, la patrie étaient encore, partout, l’alpha et l’oméga de chaque citoyen. Un Premier ministre français comme Pierre Laval n’avait jamais passé un jour de sa vie en Belgique, [51] à deux cent kilomètres de Paris ! Mussolini n’avait jamais vu la mer du Nord. Salazar ignorait la couleur de la mer Baltique. Je m’étais rendu, oui, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. J’avais vécu au Canada et aux Etats-Unis. Mais je n’en parlais guère, car cela paraissait assez peu sérieux, relevant presque de la bougeotte. En fait, l’esprit international, et même l’esprit européen n’existaient pas. L’unique organisme mondial, la Société des Nations, à Genève, était une vieille dame bavarde, inutile, dont les gens de bon ton parlaient avec condescendance. Elle avait rassemblé, pendant près de vingt ans, les principaux hommes d’Etat européens. Un Briand y avait vaguement entrevu l’Europe. Et encore, sa conception en était-elle très floue. Mais son cas était à peu près unique. L’Europe, sans le phénomène Hitler, en fût resté là, sans doute longtemps encore, chaque pays s’agitant dans le pré de son territoire particulier. En moins de trois ans, le vieux continent allait subir une mutation totale. Il aurait à peine eu le temps de fermer les yeux que le champignon Hitler se serait déployé, grandiose, effrayant, par-dessus l’Europe. L’éparpillement envahirait chaque coin du ciel, jusqu’au ras des plus lointains des océans. Chapitre IV L’Europe éclate - [53] Si vous aviez pris à temps le pouvoir en Belgique, eussiez-vous pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale ? A première vue, la question paraît tout à fait saugrenue car la Belgique est un mouchoir de poche jeté au nord-ouest du continent. Ses 30 000 km2 représentent peu de choses. Et les intérêts en jeu, tant du côté germano-italien que du côté franco-anglais, étaient gigantesques. Alors ?… Eh bien, cet « alors » n’est pas aussi problématique qu’il puisse paraître au premier abord. Entre les deux blocs d’Europe occidentale qui allaient s’empoigner à bras-le-corps, le seul pays capable de constituer une barrière, ou un lieu de rencontre des grands rivaux, était, tout de même, la Belgique. Installé à la tête de l’Etat, disposant du seul moyen de propagande internationale qu’était, à l’époque, la radio, il eût été possible, accroché au micro chaque jour, de contrecarrer, dans la France du Front Populaire, les violentes campagnes bellicistes qui cherchaient à dresser définitivement Paris contre le Troisième Reich. Les bellicistes français n’étaient qu’une minorité. Une toute petite minorité. On le vit lors des accords de Munich [54] en septembre 1938, à la suite desquels le signataire français, le ministre Daladier, honnête pochard cultivé, qui s’attendait à être étoilé de tomates et d’oeufs peu frais en débarquant à l’aérodrome du Bourget, fut acclamé par le peuple parisien, avec une frénésie qui le laissa bégayant et pantois. On le vit encore lors de la guerre de Pologne. Le Français, malgré les grands coups de pinard de rigueur, partit aux armes en renâclant. Il combattit mal en 1940, non seulement parce que la stratégie j’Hitler surclassa ses états-majors, empotés et en retard d’un siècle, mais parce qu’il ne comprenait rien aux buts de cette guerre, et que le moral n’y était pas. Eclairé chaque jour, dès 1936, le peuple français eût, peut-être, compris le problème de la réunification d’un Reich morcelé peu intelligemment après 1918. Il est vif d’esprit. Politiquement, il saisit le raisonnable. Il eût pu se rendre compte que le mieux serait de proposer lui-même, à temps, un règlement total, sur des bases justes, du problème des frontières allemandes et notamment de Dantzig, ville séparée arbitrairement du Reich, qui votait à 99% pour Hitler, et à qui, au nom de la « démocratie », on interdisait de rejoindre la patrie de son histoire, de sa race, de sa langue, et de son choix. Alors, à quoi rimait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? D’autre part, Dantzig était le goulot par lequel passait la vie maritime de la nouvelle Pologne. Il était impensable, évidemment, qu’un grand pays [55] comme l’Allemagne restât à jamais coupé en deux, que ses habitants continuassent à ne pouvoir se rejoindre que dans des wagons plombés, à travers un territoire étranger. La Pologne, pour sa part, avait le droit de respirer, de pousser sa trachée artère jusqu’à la Baltique. Néanmoins, cet imbroglio du Corridor polonais n’était pas un remède. La solution d’un plébiscite amical, polono-allemand, était relativement simple, qui eût garanti à chacun des deux pays, qu’il fût vainqueur ou qu’il fût vaincu dans la compétition électorale, un accès libre au moyen d’une autoroute unifiant les deux parties du Reich, si les Allemands perdaient, joignant la Pologne à la mer Baltique, si les Allemands gagnaient. La recherche d’une solution pareille, ou assez semblable, ou même différente mais satisfaisant les parties en cause, était certainement plus facile à mettre en forme que les plans de cohabitation imposés en 1919 à des peuples très différents, rivaux parfois, ennemis souvent : à des millions de Tchèques, de Slovaques, de Ruthènes, de Hongrois, sur l’ancien glacis bohémien ; à des millions de Polonais, d’Ukrainiens, de Juifs et d’Allemands, au sein d’une Pologne hybride, sans majorité nationale. Ou à une Yougoslavie de Croates, de Serbes et de Bulgares qui se haïssaient et qui rêvaient plus de se dépecer que de s’embrasser. Mais, voilà, il ne fallait pas, pour envisager une solution valable au cas du couloir de Dantzig, attendre qu’on fût arrivé au 30 août 1939, alors que déjà les moteurs de quelques milliers de chars ronflaient tout le long de la Prusse orientale, de la Poméranie et de la Silésie ! La France a donné, de son habileté diplomatique, des [56] preuves éclatantes, avant 1914, en liquidant les inimitiés anglo-françaises, en nouant l’alliance franco-russe ; elle les renouvela sous de Gaulle en se dégageant de la politique des blocs. La même habileté eût pu, tout aussi bien, en 1936, aider à préparer une liquidation pacifique du casse-tête allemand. Et puis l’Hitler de 1936 n’était pas l’Hitler rugissant de 1939. Je l’ai rencontré longuement à l’époque, car l’intérêt de mon pays, terre d’entre-deux, était de nouer des relations intelligentes et précises avec les meneurs du jeu européen. C’est ainsi que je vis discrètement tous les principaux hommes d’Etat d’Europe, qu’ils fussent français, comme Tardieu et Laval, ou italiens comme Mussolini et Ciano, ou allemands comme Hitler, Ribbentrop et Goebbels, ou espagnols comme Franco et Serrano Suner, ou anglais comme Churchill et Samuel Hoare. En août 1936, j’avais donc du longuement Hitler. La rencontre avait été excellente. Il était calme et fort. Moi, j’avais vingt-neuf ans, et toutes les audaces. - « Jamais je n’ai vu de tels dons chez un garçon de cet âge », avait dit et répété Hitler à Ribbentrop et à Otto Abetz après notre entrevue. Je cite ce jugement, non pour me planter dans l’arrière-train des plumes de paon, mais pour que l’on voie que les atomes crochus avaient fonctionné, que la conversation que je lui avais tenue, pendant plusieurs heures, Ribbentrop présent, l’avait intéressé. Or, que lui avais-je proposé ? Ni plus ni moins qu’une [57] rencontre Léopold III-Hitler, à Eupen- Malmédy, autre terre séparée de l’Allemagne par le traité de Versailles, au profit de la Belgique cette fois, après un plébiscite truqué : ceux qui n’étaient pas d’accord avaient été obligés de faire connaître leur opposition par écrit, en apposant leur signature sur un registre public, répertoire redoutable de suspects futurs ! Dans ces conditions, qui eût signé ? Toutes les cloches de Belgique avaient eu beau sonner pour fêter ce soi-disant rattachement ! A longue échéance, de tels procédés étaient indéfendables. Il fallait, à mon avis, prévenir les réclamations et enterrer la hache de guerre là-même où existait une possibilité de la brandir. Hitler avait été immédiatement d’accord sur ma formule : un plébiscite dont la campagne préparatoire se limiterait à une assemblée des populations locales en face de deux chefs d’Etat qui viendraient ensemble sur les lieux, expliqueraient publiquement leur point de vie, en toute courtoisie ; une seconde assemblée, identique, se tiendrait après le plébiscite pour que, quel qu’en fût le résultat, les deux chefs d’Etat y scellassent la réconciliation de leurs deux peuples. Si Hitler se ralliait à une solution si pacifique – qui plus aussi d’ailleurs à Léopold III quand j’allai lui en faire part – il eût pu, à plus forte raison, accepter, en 1936, un débat concernant l’ensemble des frontières autrichiennes, tchèques, danoises, etc. et, notamment, un arrangement à l’amiable avec une Pologne, réconciliée de puis 1933 avec le Reich et amie, d’autre part, d’une France qui eût été, en cette occasion, l’agent rêvé d’un règlement définitif. Peu avant, le maréchal Pétain et le maréchal Goering [58] s’étaient rencontrés, en Pologne précisément. Rien de sensé n’était donc impossible. Il n’était pas d’hommes d’Etat qui n’avait déploré, dès 1920, l’inintelligence des décisions prises, à la suite de la Première Guerre mondiale, au sujet de Dantzig, du Corridor et de la Silésie. Les décisions imposées alors avaient été injustes, basées sur des dictats et sur des plébiscites faussés. Etudiée posément, une solution sage eût dû être présente bien avant même qu’il fût question de l’Anschluss et des Sudètes, d’autant plus que l’ambiance, en Pologne comme en Allemagne, était à la collaboration, à tel point que lorsque le président Hacha, répudié par les slovaques, eut confié, le 15 mars 1939, à Hitler, le sort de la Bohème, la Pologne du colonel Beck participa militairement à l’investissement, s’emparant de la ville et de la région de Teschen. Cette Pologne-là, bien conseillée, se fût difficilement refusée à un débat sérieux avec son allié de ce printemps même. Sans l’intervention provocatrice des Anglais à la fin d’avril 1939, promettant la lune au colonel Beck, homme taré physiquement et financièrement, cet accord eût été négociable. Des appels à l’esprit de compréhension des Français eussent pu être décisifs. Hitler avait renoncé publiquement et pour toujours à l’Alsace-Lorraine. Il ne désirait en aucune façon croiser le fer avec une France inassimilable, c’est-à-dire sans intérêt pour un conquérant. La France, de son côté, n’avait rien à gagner à une [59] telle bagarre. Autant les terres fécondes de l’Est pouvaient tenter Hitler – et on eût même dû l’orienter et l’encourager dans ce sens, débarrassant l’Ouest, pour cent ans, du danger allemand – autant une guerre, stérile à l’avance, avec la France, avait cessé d’éveiller en lui le moindre désir. Un chef de gouvernement belge, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Français, expliquant aux Français l’importance vitale de leur rôle de conciliateurs, comme je l’eusse fait sans relâche, planté devant les micros de la Radiodiffusion, eût pu frapper en France les esprits. En tous cas, j’eusse tenté l’impossible. Je m’en voudrai jusqu’à la mort de ne pas avoir conquis le pouvoir à temps, même s’il ne m’eût offert qu’une chance minime de sauver la paix. Je l’eusse utilisée au maximum. La passion d’y parvenir m’eût dicté les mots qu’il fallait. Le peuple français est sensible aux orchestrations de la parole. Et il était mûr pour le langage que je lui eusse tenu. Le plus étonnant est que, si je n’ai pas pu prendre à temps, dans des mains fortes, un pouvoir que je n’eusse plus jamais lâché, on peut m’en croire, la proie m’échappa à cause d’Hitler, précisément. Ce sont ses interventions brusquées en Autriche, chez les Sudètes, chez les Tchèques, puis le début de la bagarre polonaise qui effrayèrent le public belge et mirent à mal mon ascension finale. Ce qui n’empêche qu’on m’a dépeint mille fois, à l’époque, comme étant l’instrument d’Hitler, le jouet d’Hitler. Je n’ai jamais été le jouet de personne, pas plus d’Hitler [60] que d’un autre, pas même au cours de la guerre quand je luttais à côté des armées allemandes du front de l’Est. Les archives les plus secrètes du Troisième Reich l’établissent. Ni en 1936, ni plus tard, ni jamais, je n’ai reçu d’Hitler un pfennig, ni une consigne. Jamais, d’ailleurs, il n’a essayé de m’influencer en rien. Au contraire, par la suite, lorsque les incertitudes politiques de la guerre m’angoissaient, je lui en ai dit « des vertes et des pas mûres ». Son principal traducteur, le docteur Schmidt, qui assistait comme interprète à nos entrevues, a raconté lui-même, dans la presse, après la guerre, comment je parlais au Führer avec une vigueur et une crudité que nul autre n’osa jamais employer avec un tel interlocuteur. Il encaissait très bien, avec une bonne humeur cocasse. - Léon, me disait-il pendant la guerre, lorsque j’exigeais tout pour mon pays et refusais tout en son nom, finalement ce n’est pas vous qui collaborez avec moi, c’est moi qui collabore avec vous ! Et c’était assez vrai. Notre pays, parce que trop petit, risquait, dans une Europe mal définie, de perdre sa personnalité. Toujours j’ai exigé que le caractère propre de notre peuple soit respecté en tout : son unité, ses coutumes, sa foi, ses deux langues, son hymne national, ses drapeaux. Je n’ai jamais toléré, tout au long de la campagne de Russie, qu’un Allemand, si sympathique fût-il, exerçât un commandement parmi mes unités, ou simplement nous parlât en allemand. Nous devions d’abord nous affirmer. Après, on verrait. Même chez Hitler, je ne menais mes conversations qu’en français (qu’Hitler ignorait), ce qui me donnait, [61] entre nous, le temps de bien réfléchir pendant qu’on traduisait la répartie, déjà comprise. Hitler n’était pas entièrement dupe. - Fuchs ! (renard), me disait-il un jour en riant, après avoir décelé dans mon oeil un regard malicieux. Mais il ne se formalisait pas de mes subterfuges et me laissait soupeser à l’aise chacun de mes propos. En 1936, toutefois, on n’en était pas là. Hitler était encore pour nous un Allemand lointain. L’ère des grandes opérations de regroupement germanique n’était pas encore entamée. La réoccupation de la rive gauche du Rhin, logique, et qui eût dû être concédée aux Allemands longtemps auparavant, n’avait pas fait spécialement de malheurs. Elle avait été rapidement passée au compte des profits et pertes. Au moment de la victoire de REX (mai 1936), le baromètre de l’Europe était plutôt au beau temps. Au cours de notre campagne électorale, le nom d’Hitler n’avait pas été évoqué une seule fois par un contradicteur. On s’en était tenu, dans tous les partis belges au combat, à des problèmes de politique intérieure. Notre programme d’alors – les textes jaunis par les ans existent toujours – parle longuement et durement du balayage des vieux partis politiques, de la réforme de l’Etat (autorité, responsabilité, durée), du socialisme à édifier, de la haute finance à mater. Mais il n’y est même pas question d’une ébauche de programme international. Pendant de longs mois encore après notre victoire de 1936, notre position se limita à prôner une politique de [61] neutralité qui dégagerait notre pays de toute alliance dangereuse – de Gaulle a-t-il agi autrement, plus tard, face aux deux « blocs » de l’après-guerre ? – et maintiendrait notre patrie à l’écart des querelles qui commençaient à gronder entre les démocraties d’ancien style (France, Angleterre) et les démocraties d’ordre nouveau (Allemagne, Italie). Sous notre impulsion, cette politique de neutralité devint rapidement – et officiellement – celle de la Belgique. Dans tout cela, rien donc qui marquait une orientation internationale du rexisme dans un sens prohitlérien. Certaines grandes réformes du national-socialisme et du fascisme nous intéressaient vivement. Mais nous les examinions en observateurs, sans plus. A dire le vrai, mes affinités étaient françaises. Ma famille était de là-bas. Ma femme était de là-bas et avait conservé sa nationalité. Mes enfants pourraient opter un jour pour le pays de leur choix. Ils ont, depuis lors, tous opté pour la France. De 1936 à 1941, je me suis rendu une seule fois à Berlin mais cent fois à Paris ! Aussi, pas question de main de l’Allemagne, d’argent de l’Allemagne, de mots d’ordre de l’Allemagne ! Nous étions neutres. Ni avec l’Allemagne, ni avec la France : la neutralité la plus rigoureuse, face à une bagarre où notre pays n’avait rien à gagner et où, pris entre les deux battants agités avec violence, il ne pouvait que recevoir de mauvais coups, des uns comme des autres. Toutefois, au printemps de 1936, une telle empoignade [63] n’était pas encore inscrite nettement à l’ordre du jour européen. Nous connûmes quelques semaines de répit. Puis, au cours de l’été, l’avalanche dégringola. D’abord, en France. Le Front Populaire l’emporta électoralement. Le pouvoir passa au chef de la coalition des gauches. Léon Blum, ennemi par ses convictions marxistes et par judaïsme, de tout ce qui était hitlérien. Sa hargne – et l’aveuglement que donne la hargne – étaient tels qu’il avait prédit l’échec d’Hitler juste avant que celui-ci arrivât au pouvoir ! Une série de ministres de son équipe, hommes et femmes, étaient juifs également. On ne peut pas dire que leur passion de la France était exagérée : l’un d’eux, Méphisto à lunettes, nommé Jean Zay, avait même, précédemment, traité le drapeau français de « torche-cul ». Mais leur passion antihitlérienne était, elle, forcenée, sans limites. La tension monta aussitôt. Les campagnes de haine et de provocation antihitlériennes, sous de telles inspirations, s’épandirent vite et efficacement. Appuyé à fond par la propagande israélite, le Front Populaire se rua contre quiconque, à l’étranger aussi bien qu’en France, était de droite. Il me fit décrire, dans sa presse, uniquement parce que j’étais neutraliste, comme un suppôt d’Hitler. Il fit donner à fond contre moi les agents secrets du Deuxième Bureau français, extrêmement nombreux et actifs en Belgique, où ils déversaient abondamment, dans la presse et les milieux mon[64]-dains, déplumés et avides d’argent de poche, les millions de la corruption. Un mois plus tard, deuxième décharge électrique : l’Espagne nationale se dressait contre le Frente Popular, frère chéri du Front Populaire français. L’Espagne et la Belgique, n’étant pas voisins, n’avaient et ne pouvaient avoir, en rien, d’intérêts opposés. Le soulèvement était juste, sain, nécessaire, comme l’épiscopat espagnol puis le Vatican allaient le proclamer l’année même. La guerre civile est le dernier recours, mais les fureurs du Frente Popular avaient acculé l’Espagne nationale à ce dernier recours. La Phalange, d’inspiration catholique, était très près du rexisme, politiquement et spirituellement. Moimême avais été nommé, en 1934, par José Antonio Primo de Rivera, n° I de la Phalange de l’extérieur. L’armée espagnole, qui s’était soulevée, défendait les mêmes idéaux patriotiques et moraux que ceux du Rexisme. Et puis, quand même ! Si le Front populaire français, si les Soviets, si toute l’Internationale marxiste prenaient parti pour des incendiaires et des étrangleurs, s’ils les soutenaient frénétiquement, s’ils les comblaient d’avions français et de chars russes, s’ils leur envoyaient des milliers de recrues – des illuminés à la Malraux, des bouchers sanglants à la Marty, ou des fonds-de-tiroirs de prisons – pourquoi nous, patriotes et chrétiens, n’aurions-nous pas pu éprouver des sympathies pour des patriotes et des chrétiens, traqués et persécutés au long de [65] cinq années de terreur et réduits à se dresser en armes pour survivre ?… N’empêche, un premier foyer de guerre européenne s’était allumé. Nul pompier n’apparaissait qui eût pu arroser le brasier naissant. Au contraire, l’incendie s’élargissait. Allemands et Italiens, communistes russes et Français rouges passaient des échanges de mots aux échanges d’explosifs, prétendaient se servir du champ de bataille espagnol pour régler au couteau leur contentieux. Internationalement, 1936 se terminait mal. Les nerfs étaient à fleur de peau : 1937 allait marquer, en Europe, le virage fatal. A partir d’alors, Hitler, qui n’avait guère à se préoccuper des plans électoraux du rexisme, allait régulièrement nous ficher dedans chaque fois que nous eussions dû renforcer notre action en gagnant de nouveaux votes et, grâce à eux, nous hisser pacifiquement au pouvoir. C’était, chez moi, une position bien arrêtée : pas d’accès au pouvoir par la violence. Jamais, en temps de paix, je n’ai porté sur moi une arme quelconque. On pouvait me voir à Bruxelles, où que ce fut, sans protection d’aucun ordre. J’allais à la messe, au restaurant ou au cinéma avec ma femme : c’était mon unique rempart, tout de grâce et de gentillesse. Je faisais des kilomètres dans les bois avec mes enfants. J’ai toujours éprouvé une horreur physique pour tout ce qui était janissaires ou gardes de corps. J’ai toujours cru à mon étoile. Il ne m’arrivera jamais rien. Et, de [66] toute façon, un pistolet dans une poche de pantalon sortirait trop tard et n’empêcherait pas la casse. Le peuple a horreur de ces protections qui ont des airs de suspicion. Il faut se fier à lui, franchement. Je me rendais tout seul, en tramway, aux pires meetings rouges. Les incidents ne manquèrent point. Ils furent souvent cocasses. Mais ma méthode était la bonne. Le coeur du peuple est droit. C’est à ses sentiments d’hospitalité et d’amabilité qu’il faut faire appel, et non à une intimidation blessante. De même que je voulais gagner les masses par le coeur, sans recourir jamais à un étalage de forces, de même tout mon être s’opposait à un recours à la force armée pour me hisser au pouvoir dans mon pays. Cette force armée, je l’ai eu à ma disposition ; en octobre 1936, le chef le plus fameux et le plus populaire de l’armée belge, le général Chardonne, mit, par écrit, toutes ses troupes à ma disposition, m’offrit de les amener en trains spéciaux à Bruxelles. Le terrain eût été nettoyé en une heure par la division d’élite qu’étaient les Chasseurs ardennais. Le roi – son secrétaire l’expliqua à l’écrivain Pierre Daye, député rexiste – eût ordonné qu’on ne ripostât point. Je remerciai le général, mais me refusai à une telle opération. Sans aucun doute, si j’avais pu deviner comment les événements internationaux allaient me prendre de court, j’eusse accepté. Il y aurait eu très peu de résistance chez les nantis. Une fois ma décision prise, j’eusse, de toute [67] façon, brisé tout obstacle sans exagérer les ménagements : le salut de mon pays et la paix de l’Europe eussent eu plus de prix à mes yeux que les criailleries de quelques dirigeants marxistes, promptement bouclés. Mais j’étais, tout au fond de moi-même, sûr de réussir sans recourir à une solution de force. La solution de mon goût, c’était la conviction, l’adhésion et le don consentis librement, dans l’enthousiasme. A vingt-neuf ans, des foules immenses s’étaient données à ma cause. Quelques mois plus tard, les chefs nationalistes flamands s’étaient ralliés à ma conception de la Belgique fédérale. Leurs députés et sénateurs, presque aussi nombreux que les miens, avaient fait bloc avec le rexisme. Pourquoi cette progression pacifique ne serait-elle pas menée sans violence jusqu’à la victoire définitive ? Encore une élection, deux élections, quelques campagnes populaires puissantes, et j’arriverais au pouvoir sans un coup de fusil, m’appuyant sur l’adhésion et l’affection de la majorité absolue de mes compatriotes ! J’ai bien failli y parvenir. Si je n’y suis point parvenu, c’est avant tout, et, par-dessus tout, je le répète, à cause d’Hitler, passé de l’ère du redressement intérieur du Reich, à l’ère des revendications internationales, rabattant dans tous nos pays les électeurs affolés vers les parapluies des anciens régimes conservateurs. Au début de l’année 1937, la bagarre s’était redoutablement aggravée en Europe, attisée de plus en plus violemment par les bravades incessantes du Front Populaire français. Hitler répondait à ses ennemis [68] en jetant vers eux les imprécations les plus bruyantes, les sarcasmes les plus cruels, les menaces les plus directes. En six mois, l’Europe se trouva coupée en deux camps. Non qu’elle s’y fût rangée : on nous y rangea. Nous qui n’avions aucun lien , d’aucun ordre que ce soit, pas plus politique que financier, avec le Troisième Reich, on nous jeta, comme un ballot sur un quai de gare, dans le clan allemand où, pourtant, nous ne voulions atterrir à aucun prix. J’entends toujours, à la sortie d’un meeting de gauche, pendant l’hiver 1936-1937, l’apostrophe : A Berlin ! C’était de la calomnie intégrale. N’empêche, je me retournai, inquiet, vers mes amis présents. – Mauvais, ce cri-là. Le lendemain, toute la presse marxiste le répétait. Désormais, nous serions catalogués, malgré nos protestations incessantes, comme les hommes de Berlin ! Mais la catastrophe suprême fut qu’Hitler, furieux des campagnes menées partout contre lui, avait commencé à perdre patience, à faire la grosse voix, à foncer ! Et, chaque fois, son rush, que ce fût vers le Danube autrichien, ou vers les montagnes des Sudètes, ou vers les jolis ponts baroques de Prague, tomba, toujours, comme automatiquement, en plein milieu des campagnes électorales de REX qui eussent peu entraîner définitivement le public belge derrière nous. Le Belge – et c’est compréhensible – avait conservé de l’invasion de 1914, qui avait été aussi injuste que cruelle, un souvenir horrifié. Chaque irruption militaire [69] de la Nouvelle Allemagne dans un pays voisin, même si cette entrée avait été pacifique, même si elle avait été acceptée, voire accueillie dans l’enthousiasme comme en Autriche, mettait l’électorat belge en transes. A Berlin ! A Berlin ! nous lançaient en choeur, sûrs de l’effet du slogan, les propagandistes d’extrêmegauche ! Nous jeter lâchement cette calomnie à la face, c’était, en toute impunité, affoler le corps électoral, aussi bien wallon que flamand. A Berlin ! alors que ledit Berlin, par ses violences internationales, jetait invariablement la panique, au moment décisif, parmi le public que nous nous acharnions à conquérir. Lorsque je provoquai le Premier ministre belge, M. Van Zeeland, en 1937, à une véritable électionplébiscite à Bruxelles, le hurlement « A Berlin ! » déferla durant toute la campagne. Elle se clôtura par un formidable coup de crosse que m’assena l’archevêque de Malines, plus antihitlérien encore que Léon Blum et que tous les comités juifs réunis. Le cardinal Van Roey était un colosse, paysan flamand taillé à la hache de silex, « taiseux », buté, répandant, sous ses atours, d’épaisses odeurs tenaces. Certains de ses fidèles qui ne l’admiraient qu’à demi l’avaient baptisé Le Rhinocéros. Timide, la Ligue de Protection des Animaux, n’avait pas protesté. Son palais archiépiscopal, d’un ennui accablant, était hanté de bossus, de bigles, de boiteux, valetaille lugubre et silencieuse racolée au plus bas prix. Face à l’escalier d’honneur en bois ciré, caquetait une volaille disparate. [70] – Mes poules, murmurait lugubrement l’archevêque, visiblement sans penser à mal. Ce sont les seuls présentations auxquelles il se livrait. L’air éternellement renfrogné, il faisait preuve, en tout d’un fanatisme élémentaire, intégral, comme s’il eût dominé tribunaux de l’Inquisition et bûchers du XVIe siècle. Jamais il n’avait lu un seul exemplaire d’un journal non catholique. Rien que d’y penser le remplissait d’horreur, rendait plus maussade encore son visage embrouillé. Pour lui, un incroyant ne présentait pas le plus mince intérêt. Se poser des questions sur ce qu’un athée pouvait penser ne lui serait même jamais venu à l’esprit. L’incroyant était, dans son concept de l’univers, un être absolument insolite, un anormal. Il menait sa troupe archiépiscopale comme un sergent-major du Grand Frédéric eût conduit des recrues rétives à l’exercice. Il repoussait de sa godasse sacrée tout ce qui n’avait pas l’air confit, l’oeil mi-clos, le nez tombant en banane, du frère lai se jetant à genoux, les bras en croix, devant la table de son supérieur, au plus minime manquement à la discipline. Aujourd’hui, on le mettrai, empaillé et préalablement désodorisé, dans un musée postconciliaire. Mais, alors, il régnait. En-dehors du problème de son impassibilité marmoréenne vis-à-vis des incroyants qui, spirituellement, me paraissait caricaturale et monstrueuse, nous avions, lui et moi, un oeuf à peler, gros comme s’il avait été pondu par une autruche, une autruche aux oeufs d’or. Pour une [71] question de millions de francs chapardés à l’Etat belge, j’avais indisposé au plus haut point Son Eminence en démasquant – entre vingt autres – le scandale politique financier dans lequel s’était ébattu longtemps et parfaitement à l’aise, un ignoble petit requin de banque, nommé Philips, gnome cramoisi, au nez énorme surchargé d’une verrue violâtre et granulée comme une mûre. Ce Philips arrosait largement (six millions de francs en 1934) la hiérarchie ensoutanée qui constituait l’armature du réseau de propagande de sa banque. Il était d’autant plus généreux que, grâce à la corruption du parti catholique au pouvoir, il s’était fait accorder par les Etats (les collègues socialistes s’étaient fait adjuger, à la même époque, des subventions similaires en faveur de leur Banque du Travail en déconfiture) des « interventions » financières astronomiques. J’avais découvert le brigandage. J’avais traîné par les pieds les « banksters » au milieu de leurs immondices, les faisant tournoyer dans cette mélasse devant la Belgique entière. Philips n’avait pu faire autrement que de me poursuivre devant les tribunaux. J’avais gagné. A grands coups de balai, je l’avais vidé hors de la vie politique belge, le jetant littéralement à la porte du Sénat. Il s’était retrouvé sur le pavé avec son déshonneur, sa verrue violacée et la marque vigoureuse de mes bottes sur ses vieilles fesse tremblantes. - Excrément vivant ! lui avais-je crié, face à la foule, en lui signifiant son P.P.C. Or, ce vide-gousset était, très ostensiblement, le protégé et le protecteur du cardinal-primat de Belgique. Comme on dit, avec un certaine liberté de langage, hors des archevêchés, ils étaient comme cul et chemise. Le cardinal qui ne souriait à [72] personne, souriait à cette fripouille hideuse comme à une apparition angélique. Leur intimité était telle que l’archevêque, casanier comme une rampe d’escalier, avait découché en son honneur, passant un week-end au château somptueux que le banquier s’était offert dans un gracieux vallon brabançon. Je possédais des photos des deux compères se promenant pieusement sous la charmille, sans qu’on sût très bien s’ils récitaient ensemble des psaumes bibliques ou s’ils discutaient moins séraphiquement de pourcentages s’échelonnant d’évêchés en doyennés. Quelques années plus tôt, alors que ce banquier était, politiquement, un inconnu, le cardinal Van Roey avait donné l’ordre aux parlementaires catholiques de le coopter comme sénateur, en lieu et place d’un éminent intellectuel de droite, Firmin van den Bossche, déjà choisi. Après cela, empoigner ce Philips par le fond de son pantalon, le défenestrer, le catapulter dans les airs jusqu’à ce qu’il s’abattît, à plat ventre, parmi ses millions inutiles, tenait, évidemment de la profanation ! Mon crime n’avait pas de nom. Tous les feux du ciel ne suffiraient pas à me faire expier cette liquidation impie. Comble des outrecuidances, je ne m’en étais pas tenu à ce traitement irrespectueux des soubassements de l’élu, de l’oint de Son Eminence. J’avais traité à la botte, avec le même feu sacré, quelques douzaines de collègues dudit sénateur, tout aussi cagots, ayant toujours l’air de trans[73]-porter le Saint-Sacrement lorsqu’ils avançaient, pillards et paillards, parmi les coupe-gorge de la haute-finance. J’avais visé dans le peloton de tête, tirant à bout portant en plein dans la bobine du président du parti catholique, le ministre d’Etat Paul Segers, un petit sacristain vantard, toujours cocoricant, à la tête livide de cafard qui, entre deux oremus, avait abondamment puisé dans les caisses de l’Etat et, notamment, dans la caisse des petites gens, la Caisse d’Epargne. De la part du chef de ces grands bourgeois catholiques si satisfaits de leur haute moralité, une telle hypocrisie était particulièrement ignoble. Ils étaient les représentants typiques d’une élite pourrie qui jouait, le pouce au gilet, à la haute vertu. Je me ruai sur le Segers en question. Je fis irruption à la tribune où il présidait, l’Assemblée annuelle de son parti. C’était – les dieux, parfois, ont de l’humour – un 2 novembre, le Jour des Morts. J’avais amené avec moi trois cent gaillards décidés à tout. Le ministre Segers, entre ses quatre palmiers de la tribune officielle, fut traité par moi, durant une demi heure, comme un sous-produit d’engrais composé. Ce fut le plus grand scandale de la Belgique d’avant 1940. Comme Philips, et avec le même bonheur, Segers me cita devant les tribunaux, me réclamant trois millions de francs de dommage et intérêts, destinés à ravauder « son honneur ». Ravauder quoi ? Quel honneur ? A ces escrocs de la politico-finance, que restait-il qui, de loin ou de près, eût pu avoir encore un rapport quelconque avec l’honneur ? [74] Le procès eut lieu. Non seulement je fus acquitté triomphalement (et Dieu sait si j’ignorais tout, alors, des « arrangements » de la Justice !) mais Segers, tout ministre d’Etat qu’il était, fut condamné comme un vulgaire aigrefin. - Vous êtes le drapeau du parti catholique ! lui avait crié, à la veille du procès, un sénateur nommé Struye, au buste de coiffeur de faubourg, surmonté d’une tête de crapaud à lunettes. Ledit crapaud, après la Libération, touché par une vocation tardive de tueur d’abattoir, se vengerait de la condamnation de son « drapeau » en envoyant au poteau d’exécution plus de cent de nos camarades. Le cas de la démocratie belge d’avant 1940 était le cas de tous les régimes démocratiques d’alors, débiles, c’est-à-dire offerts à toutes les tentations. Chacun d’entre eux connut à l’époque ses scandales : Barmat en Allemagne, Stavisky en France (tous deux juifs, soit dit en passant). Mais les polices se chargeaient, à chaque fois, de liquider la sale affaire avec une remarquable célérité. Barmat avait été retrouvé, au petit matin, mort dans sa cellule, et Stavisky, par un autre petit matin, s’était fait trucider, à bout portant, par la flicaille qui avait cerné, la nuit, sa villa de Chamonix, débarrassant ainsi de tout souci majeur la horde de l’argent de la France et avaient, en contre-partie, vécu de ses rapines. En Belgique – et nul ne me le pardonna jamais – je n’avais pas sauvé les Stavisky, wallons ou flamands, [75] et n’avais pas toléré qu’on les sauvât. Au contraire, j’avais maintenu leur sales têtes pourries sous l’eau jusqu’à ce que la dernière bulle d’air eût fait surface. Mais à chaque fois que je liquidais un politicien véreux qui s’affublait du nom de « catholique » - ce qui me paraissait plus scandaleux que tout ! – mon nouveau crime était inscrit sur le calepin noir du cardinal. C’est pourtant lui, bon Dieu, qui eût dû les faire voler à travers les verrières de ses cathédrales ! Mais non, le coupable, c’était moi, qui, le balai au poing, traquais, en catholique sincère, les escrocs de la politico-finance, arc-boutés derrière les confessionnaux et les bénitiers ! Le cardinal était intervenu, en décembre 1936, au Vatican, pour décrocher une condamnation du Rexisme. Il avait échoué. Tapi derrière ses boiteux, ses bossus et ses bigles du palais de l’Archevêché, il me guettait. Il attendait l’heure. L’élection-plébiscite Van Zeeland-Degrelle du 11 avril 1937 allait lui offrir le virage au coin duquel, posé en silence, il me sonnerai au passage. En toute dernière minute de la campagne électorale, alors que toute riposte était techniquement impossible, il fit tout d’un coup tournoyer dans les airs sa crosse du Moyen Age. Avec une brutalité et surtout avec une intolérance que, bien sûr, nul public catholique n’admettrait plus aujourd’hui, il se jeta, mitre sur la tête, dans une bagarre strictement électorale, où le catholicisme n’avait strictement rien à voir, lançant urbi et orbi une déclaration [76] fulminant interdisant en conscience de voter pour moi ! Ce n’était pas tout. Il interdisait en outre, et toujours en conscience, c’est-à-dire, sous peine de péché, de s’abstenir de voter ou de voter « blanc », ce que se disposaient à faire de très nombreux catholiques belges qui, non ralliés à REX, ne voulaient pas, tout de même, donner leurs voix au candidat mis en avant par l’extrême gauche et dont, au surplus, on commençait à chuchoter qu’il était, lui aussi, compromis dans une très vilaine histoire de finance. Le scandale éclaterait l’été même de son élection. On apprendrait alors que le poulain du cardinal n’avait pas hésité auparavant de s’approprier clandestinement, avec quelques complices, les traitements de hauts fonctionnaires de la Banque Nationale, bel et bien morts sur les listes de l’état civil mais que Van Zeeland et sa clique maintenaient en parfaite santé sur la feuille des émoluments de la Banque officielle de l’Etat belge ! Van Zeeland et ses collègues de brigandage appelaient cette caisse noire « la cagnotte ». Ils la vidaient sans vergogne chaque mois, volant l’Etat et volant, au surplus, par ricochet, le fisc à qui, on l’imagine, ils ne déclaraient pas ces revenus-détournements ! Les moeurs politico-financières des démocraties d’avant 1940 étaient telles qu’on pouvait parfaitement devenir Premier ministre après avoir utilisé des cadavres de fonctionnaires pour s’emplir les poches aux dépens de l’Etat ! La main sur le coeur, la bouche en cul de poule, le Van Zeeland en question s’offrait aux électeurs benoîts, pour représenter en leur nom la Patrie et la Vertu, mises en danger par le Rexisme ! Il fallait entendre le faux [77] apôtre, plus rasoir que les millions d’appareils fabriqués par M. Gillette, compassé, pleurnichard, jouer au martyr démocratique : « Je m’avance calme et serein sur un chemin semé d’embûches ! » Essayez un peu de répéter dix fois à toute vitesse ce charabia caillouteux : « Je m’avance calme et serein sur un chemin semé d’embûches ! » Puis, il jetait des yeux attendris vers le ciel des Purs et des archevêques ! N’importe ! Ce détrousseur de macchabées bancaire fut, bel et bien, le champion européen numéro un de la lutte contre le « fascisme » avant la Deuxième Guerre mondiale ! Et, pour le sauver de la défaite électorale que les sondages du ministère de l’Intérieur laissaient clairement prévoir trois jours avant l’échéance, un cardinal n’hésita pas, à quelques heures de l’élection, à faire tournoyer sa crosse dans tous les sens, comme une massue de troglodyte. Il obligea sous peine de péché cent mille catholiques bruxellois à voter pour un pickpocket qui, l’année même, en octobre 1967 [sic, vrais. 1937], déraperait de tout son long dans le scandale de sa « cagnotte », devrait démissionner – pour toujours ! – de la présidence du gouvernement belge, cependant que plusieurs de ses collègues nécrophores de la Banque Nationale – un ministre d’Etat à leur tête – se suicideraient, à quelques jours d’intervalle, véritable ruban de saucisses bourrées de dynamite, sautant dans l’air, à Bruxelles et à Anvers ! Mais le 11 avril 1937, le « cagnottard » Van Zeeland, ruisselant de bénédictions, était monté vainqueur sur les [78] autels de l’antinazisme. Il est clair que le fait d’être catholique fut, dans ma vie politique, un handicap considérable. Incroyant, je n’eusse pas été soumis à ces pressions abominables, à ce chantage aux consciences d’un haut clergé qui maniait la crosse comme un gourdin. Ou j’eusse envoyé ledit prélat politique voltiger dans les airs avec sa mitre, ses mules et sa matraque dorée ! J’eusse été moins fagoté, moins bourré de complexes, moins isolé, car le catholicisme de ces temps-là était étroit, vindicatif, incompréhensif, et même, souvent, provocant. Il dressait des barrières dans tous les sens. Il nous avait déformés. Il nous coupait de millions d’honnêtes gens. Et il nous exposait à des violences inouïes, comme celles de cet énergumène à crosse et à glands, tapant dans le tas, qui se croyait, de droit divin, maître omnipotent de tout, y compris de la liberté des électeurs. La Croix a vaincu la Croix Gammée proclama, le lendemain de l’élection de Van Zeeland, sur toute la largeur de sa première page, l’Intransigeant de Paris ! Un tel titre d’un journal franc-maçon en disait long ! Il répondait au Vive le Cardinal, nom de Dieu ! des marxistes belges, hurlé à Bruxelles le soir de leur victoire ! Léon Blum convia à Paris le triomphateur. Il fut reçu comme le Bayard belge dressé contre Hitler. Or – et cela aussi fut drôle, mais on ne l’apprit que plus tard – le principal bailleur de fonds de cet antihitlérien épiscopal avait été – exactement pour la même somme : six millions de francs – et au même [79] moment, le bailleurs de fonds d’organisations hitlériennes en Allemagne. Il s’agissait du magnat de la soude, Solvay, qui, en hypercapitaliste accompli, finançait ce qu’il croyait être deux clans rivaux, pour avoir barre sur l’un comme sur l’autre, et se dédouaner de toute manière ! C’est sous ces millions de la duplicité et sous ces barils d’eau bénite coupée de fiel, sous ce déferlement de la calomnie A Berlin ! répétée sans fin par les bellicistes de Londres et de Paris, que je connus, lors de ce plébiscite Van Zeeland, et malgré que j’eusse obtenu 40 % de voix de plus que l’année précédente, mon premier échec électoral. Je culbuterais le même Van Zeeland six mois plus tard, après avoir révélé au public belge, dans toute son ampleur, le scandale de la fameuse « cagnotte ». Mais le mal était fait, la calomnie A Berlin ! m’avait coupé les jarrets, fauchant ma course. Sentant comment ce slogan frappait le public, la horde des marxistes belges lancée à mes trousses s’empressa de pavoiser la Belgique d’affiches où j’apparaissais coiffé d’un casque à pointe, comme les Allemands les portaient en 1914, à une époque où je n’étais qu’un garçonnet ! D’élection en élection, ce casque à pointe allait pavoiser de plus en plus les murailles de la Belgique, s’installer sur mon crâne à des centaines de milliers d’exemplaires. La presse marxiste n’hésita plus devant rien, pas même à recourir aux faux les plus grossiers. Elle publia des photos truqués où le chef de mes députés apparaissait [80] sur le grand escalier d’honneur des concentrations nazies de Nuremberg, entre deux haies de drapeaux à croix gammée ! Nous retrouvâmes, dans les archives d’agences, la photo originale où se trouvai Hitler, au lieu de notre député ! Puis la photo de celui-ci, que l’on avait superposée à la précédente et qui avait été, elle, prise devant le parlement à Bruxelles ! Mais il ne servait vraiment plus à rien de s’indigner, ni même de protester. Les tribunaux faisaient la sourde oreille ou enterraient les dossiers. Plus rien d’autre n’existait que la haine des Allemands ! L’avant-garde des Allemands, pour le jour, tout proche, où la Belgique serait dévorée par eux, avec notre complicité ! La Deuxième guerre mondiale a eu lieu. Toutes les archives du Troisième Reich ont été saisies, épluchées. Nulle part on n’a découvert la plus infime trace d’un lien quelconque, ou même d’un contact quelconque de REX ou de moi, avant l’invasion allemande du 10 mai 1940, avec qui que ce fût qui appartînt à la diplomatie du Troisième Reich ou à la propagande du Troisième Reich. Depuis 1937, nous nous tenions à carreau, veillant – et c’était lamentable, car des contacts utiles dans tous les pays eussent été plus que jamais utiles – à ne jamais rencontrer, où que ce fût, un Italien ou un Allemand. Rien n’y fit. Au lieu d’avancer électoralement, il nous fallut reculer, tout en constatant, avec une inquiétude sans cesse accrue, que la Belgique était, comme toute l’Europe, prise désormais, par la folie antihitlérienne et qu’à l’heure de la prudence, de la réserve, elle se jetterait tête baissée vers le précipice. [81] On put encore croire, en septembre 1939, lorsque la Pologne eut été envahie et que les Anglo- Français eurent déclaré la guerre au Reich, que la Belgique, s’en tenant officiellement à la neutralité, conserverait certaines chances de demeurer hors du conflit. Mais ces chances furent gâchées quelques semaines plus tard. Au début de novembre 1939, un accord avait été conclu entre le chef de l’armée française, le général Gamelin, et l’attaché militaire belge à Paris, le général Delvoie, accord clandestin, on l’imagine ! Un lieutenant-colonel français, nommé Hautecoeur, avait aussitôt été détaché en mission secrète en Belgique, près des plus hautes autorités, comme homme lige des chefs militaires alliés. Gamelin, depuis toujours, était un partisan résolu de l’entrée de l’armée française en Belgique, « voie unique », écrivait-il au Premier ministre Daladier, le 1er septembre 1949, en vue d’une action offensive, qui, ajoutait-il, écarterait la guerre des frontières françaises, particulièrement de nos riches frontières de l’Est. - « Il était, a expliqué par la suite Gamelin, pour se justifier (Servir, t.III, p. 243) du plus haut intérêt de chercher à souder au dispositif allié les vingt divisions belges dont l’équivalent ne pourrait être obtenu sur notre propres sol en raison de notre dénatalité croissante. » « Bien sûr, poursuivait-il, je tenais au courant de ces conversations officieuses et secrètes le président Daladier et les Autorités britanniques. » « Les Belges, écrivait-il en conclusion, m’ont toujours [82] fait connaître leur assentiment à mes propositions. » (Servir, t.I, p.89) De la part du généralissime Gamelin, la manoeuvre était licite. Il était le chef de la coalition alliée et cherchait à gagner la guerre le plus sûrement possible et aux moindres frais. Il avait agi conformément à ces impératifs. « Le 20 septembre, nous avions décidé d’entrer en relation avec le gouvernement belge » (Servir, t. I, pp. 83 et 84). Nous, c’était Daladier, le ministre anglais de la production, Lord Hankey, et le ministre de la Guerre, Hore Belisha, juif comme par hasard. Cette décision avait été effective. « Au début de novembre, ajoute Gamelin, fort ingénu dans ses révélations, nous étions arrivés à un accord avec l’état-major belge. » (Servir, t.I p. 84) Nul ne pourrait se risquer à nier ces affirmations, si peu diplomatiques. « Le général Gamelin négociant secrètement avec les Belges », a précisé Churchill (L’Orage approche, p.89). « Il fut pourvu à la désignation d’officiers belges de liaison pour prêter leur concours aux Franco-Britanniques dès qu’ils auraient pénétré en territoire belge », a reconnu, tout crûment, mais huit ans plus tard, Pierlot, dans le journal Le Soir, du 9 juillet 1947, ajoutant : « quand les armées alliées entrèrent en Belgique, ce fut suivant les dispositions arrêtées d’avance et d’un commun accord. » En politique, presque tout est valable. Mais encore, ne fallait-il pas alors jouer officiellement aux champions de la neutralité, comme le faisaient avec tant d’éclat et [83] d’hypocrisie le gouvernement belge ! Et surtout, celui-ci devait-il veiller à ce que des manoeuvres à ce point tortueuses ne fussent pas découvertes ! On peut encore, en politique, se payer le luxe d’être fourbe, à condition, toutefois de ne pas se faire pincer ! Or, dès le début de novembre 1939, Hitler avait été exactement informé de tout : « Nos secrets, a reconnu mélancoliquement Gamelin, se trouvaient de bien des côtés perméables à l’espionnage des Allemands. » (Servir, t.I, pp. 96 et 97) Ce fut le cas, tout particulièrement en ce qui concernait son accord de collaboration secrète avec le gouvernement belge. Dès le 23 novembre 1939, Hitler en informa ses généraux, commandants d’Armée, au cours d’une réunion à la Chancellerie : « La neutralité belge en fait n’existe pas. J’ai la preuve qu’ils ont un accord secret avec les Français. » (Document 789 P.S. des archives de Nuremberg.) Il en avait même eu doublement la preuve. « Je l’ai su de deux côtés différents, la semaine même », me dit Hitler durant la guerre, un soir de confidences. Il avait reçu deux comptes rendus complets des décisions prises chez le généralissime Gamelin, le premier fourni par un informateur du Grand Quartier général allié, l’autre, par un confident qu’Hitler possédait au sein même du gouvernement français ! Hitler eût envahi sans doute la Belgique, de toute façon. Un petit pays n’allait pas faire dévier sa grande machine de guerre à l’heure décisive de la marche en avant. Mais si des scrupules l’eussent encore habité, il pouvait, dès novembre 1939, s’en débarrasser sans trop [84] de remords, puisque la neutralité belge n’avait été qu’un mensonge et un leurre. Nous, Rexistes, ignorant tout de ces menées souterraines, peu reluisantes à dire la vérité, nous continuions à mener, en troupe sacrifiée, le combat national pour une neutralité qui restait, à nos yeux, l’une des ultimes possibilités de sauver la paix, possibilité non négligeable, même alors, comme le prouvèrent les échecs du gouvernement Reynaud qui, en pleine « drôle de guerre », ne se sauva de justesse qu’à une voix près (« et encore, elle était fausse », fit remarquer, par la suite, le président Herriot). Laval, son remplaçant presque certain, était disposé à négocier. Le soir, j’allais parfois retrouver le roi Léopold III à son palais de Laeken. Le général Jacques de Dixmude me guidait. Le souverain me recevait détendu, en culotte de cheval. Nous jetions ensemble les bases des campagnes de la presse rexiste, tendant à maintenir l’opinion belge dans une neutralité exemplaire. Je ne me doutais guère, toutefois, que dans le même fauteuil, s’asseyait, d’autres soirs, amené sur la pointe des pieds comme moi, le représentant secret en Belgique du haut commandement français ! Qu’eussent dit les Belges si, à la place de cet agent de Gamelin, un colonel de la Wehrmacht, en tant que délégué secret d’Hitler près du gouvernement dit de la neutralité, était venu s’asseoir ? Le double jeu était patent. Double jeu ou, plus exactement, triple jeu, car, en mars 1940, se rendant compte que l’affaire sentait le roussi, le roi Léopold III, se livrant à une nouvelle volte-face secrète, avait envoyé à Berlin chez le ministre Goebbels son homme de confiance, l’ex-ministre socialiste de [85] Man. Celui-ci me raconta luimême, en août 1940, comment sa mission près du ministre nazi consista à faire comprendre aux Allemands l’intérêt qu’il y aurait pour eux à se glisser sur le côté sud de la Belgique et à foncer sur Sedan, la Somme et Abbeville. Hitler y avait pensé un peu avant lui ! Mais cela explique certaines choses. Et notamment pourquoi il eût il été difficile à Léopold III de filer à Londres le 28 mai 1940, sûr d’entendre, quelques heures plus tard, Goebbels déballer le paquet devant les micros ! Bref, tout était fichu ! Les dés étaient jetés. A force de provocations et d’incompréhension délibérée, les bellicistes d’Occident étaient arrivés à leurs fins, à faire sortir de sa tanière un Hitler mis à bout. Lorsqu’il s’agit des Soviets en 1954 (Budapest) et en 1968 (Prague), on eut d’autres ménagements ! La guerre « inutile et imbécile » (dixit Spaak) allait donc déferler. Le 10 mai 1940, les palettes puissantes des blindés d’Hitler enfoncèrent les portes de l’Occident, écrasant sous elles, durant plus de mille kilomètres, des régimes démocratiques discrédités, tarés, irrémédiablement vermoulus. Chapitre V Hitler, pour mille ans [87] Jamais peuples ne connurent une surprise, une panique, un sauve-qui-peut aussi éperdus que les Français, les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois, lorsque les envahirent les armées du Troisième Reich, le 10 mai 1940. Pourtant, normalement, tous eussent dû savoir à quoi s’en tenir. En septembre 1939, déjà, la débâcle des Polonais avait été significative. Dans cinq jours, notre cavalerie sera à Berlin, avaient proclamé ceux-ci, la moustache à la Dali, l’oeil en escarboucle, une semaine avant le premier acte du conflit. Les Polonais eussent pu temporiser, calmer quelque peu leurs va-t-en-guerre, prendre Hitler au mot et entamer, ne fût-ce même que pour biaiser, des négociations qu’il leur avait fait proposer l’avant-dernier jour. Les boues de l’automnes polonais étaient proches : le raz de marée qui allait submerger leur pays en trois semaines eût été, pour le moins, reporté. En diplomatie, le temps est roi. Le bon diplomate est celui qui a sa serviette pleine d’excuses à retardement. La Pologne se complut à braver, jusqu’à la catastrophe, un Hitler dont elle avait été la complice au jour encore [88] tout proche où elle s’était taillé, à Teschen, un bon bifteck dans les dépouilles de la Tchécoslovaquie. Mais les Anglais, qui voyaient leurs pions s’éclipser partout dans les Balkans, avaient, aussitôt, tourneboulé les Polonais à coups de promesses folles, au lieu de leur témoigner du dégoût pour leur participation au dépècement des territoires tchécoslovaques. L’intérêt britannique l’avait largement emporté sur le souci de la moralité. Mais en septembre 1939, lorsque les Polonais, chauffés à blanc par Londres, se retrouvèrent envahis, l’enjôleur anglais n’apparut ni à Dantzig ni à Varsovie, et la Pologne sauta dans un formidable faillite. Cette faillite, le monde entier en avait été le témoin. Mais les réactions des états-majors alliés avaient été strictement nulles. Le généralissime Gamelin, dès qu’il avait fallu, le 1er septembre 1939, tenir ses engagements, s’était empressé d’annoncer solennellement qu’il interviendrait, mais en ajoutant qu’il lui faudrait vingt-trois jours pleins pour faire mijoter dans les casseroles de ses bureaux le ragoût d’une offensive française de secours. Quant aux Anglais, il se passerait des semaines avant qu’ils n’eussent été débarqués sur les quais de Calais les premières fardes de cigarettes blondes de leurs futures troupes d’intervention… en France. Nous irons sécher notre linge sur la ligne Siegfried, lançaient-ils, alors que ledit linge anglais attendait encore, dans les dépôts londoniens, qu’on le débarrassât de sa naphtaline ! En tout cas, ni alors, ni jamais, un combattant britannique n’apparaîtrait sur la Vistule. [89] Ce sont les Soviets et non les Anglais qui, six ans plus tard, bougeraient les Allemands hors de la Pologne et se l’adjureraient ! En attendant, le caporal Hitler avait possédé les prétentieux chefs militaires de l’Occident, y compris ceux de son propre pays. Tous ces brillants spécialistes, galonnés, étoilés, couverts de ferblanteries sonnaillantes, avaient cru qu’il leur suffirait, comme toujours, de faire sortir des tiroirs des dossiers épais où tout, de longue date, avait été méticuleusement prévu. Le caporal « bohémien » avait laissé de côté, sans plus d’affaire, ces paperasseries mirobolantes.. Ses stratèges conservateurs n’envisageaient en 1939 que des opérations partielles dans le nord du territoire polonais. Ils savaient tout, bien entendu. Mais le caporal, lui, tout caporal qu’il fût, avait créé, de toutes pièces, dans son cerveau, la tactique de la Blitzkrieg : artillerie des divisions de chars de rupture accouplée massivement à l’artillerie aérienne. Les Polonais avaient à peine eu le temps de remplir les stylos qui leur permettraient, dès leur entrée à Berlin, d’envoyer des cartes postales victorieuses aux petites copines émerveillées, que les Stukas, ouvrant violemment la voie à plusieurs milliers de chars groupés, dégringolaient du ciel sur tous les points vitaux, les débitaient en tranches, les malaxaient comme un bifteck américain. Dès le premier jour de la guerre, tout contact à l’intérieur du territoire polonais était mort, ou condamné à mort. Dès la première semaine, sous le toit protecteur de l’aviation, [90] les énormes tenailles des troupes blindées d’Hitler rejoignaient leurs pinces de toutes parts à l’Est, formant des nasses au fond desquelles s’agitaient désespérément, les écailles du ventre sèches déjà, le million de poissons polonais pris au piège. A la fin du mois de septembre de 1939, le colonel Beck, qui eût dû, à ce moment-là, être en train de faire boire son cheval dans la Sprée ou de vider les caves de Horcher, s’était enfui en Roumanie, laissant en plan son peuple entièrement envahi et anéanti. C’était une révolution complète des méthodes de guerre qui venait d’être réalisée, sous le nez de centaines de millions de spectateurs des deux mondes. Mais allons donc ! Pourquoi se fût-on laissé impressionner ! Un général est un général, et il sait tout ! Un caporal est un caporal, et il ne sait rien ! Militairement, toutes les données prévues depuis des siècles par des spécialistes des états-majors venaient d’être liquidées. Pourtant, eux n’avaient rien à apprendre de personne, surtout d’un bas subalterne, bohémien par-dessus le marché ! C’est ainsi que le 10 mai 1940 allait trouver le généralissime Gamelin lissant plumes de ses pigeons voyageurs à son quartier général de Vincennes, en face de téléphones démodés et inutiles, tandis que, dans un accouplement prodigieux des forces de terre et des forces de l’air, toutes d’une efficacité et d’une promptitude terrifiantes, les armées du caporal ignare, appliquant, une deuxième fois, une stratégie révolutionnaire que les as de la bureaucratie militaire du continent avaient repous[91]-sée avec un mépris flagellant, rééditaient le coup de l’invasion de la Pologne. Elles allaient, en onze jours, couper en deux, de Sedan à Dunkerque, un continent que, quatre ans d’assaut classiques, d’août 1914 à juillet 1918, n’avaient pu écarteler, même en y sacrifiant plusieurs millions de morts. Cent mille jeunes Allemands – les seuls qui, en fait, furent directement au contact au cours de la campagne de France de 1940 – appliquant les plans stratégiques du caporal-chef, boucleraient deux mille généraux français, la veille encore pétant de suffisance, et deux millions de leurs soldats, déconfits, dépenaillés, qu’un science nouvelle de la guerre venait d’écrabouiller. Il n’y avait pas eu seulement, pour prévenir les esprits, l’investissement polonais de septembre 1939. il y avait eu, aussi, l’investissement norvégien d’avril 1940. là encore, tout avait été nouveau. On avait vu, à la Chancellerie de Berlin, le caporal Hitler tenir en haleine, durant huit heures, devant une immense carte murale de la Scandinavie, tous les chefs d’unités, commandants de bataillons compris, qui allaient avoir à jouer un rôle dans le débarquement d’une audace sans précédent qu’Hitler avait préparé dans le secret le plus rigoureusement absolu. Vous imaginez cela ! Alors qu’avant, seuls, trois ou quatre généraux massifs, et monoclés de préférence, recevaient, pour exécution, des ordres dactylographiés en douze exemplaires, un chef de guerre sans épaulettes [92] d’or expliquait lui-même, à chaque officier intéressé à l’action, le rôle exact qu’il aurait à remplir, le lui indiquait sur la carte, lui faisait répéter à voix haute les consignes ainsi que l’exposé de la manoeuvre précise qu’il aurait à effectuer. Le comble ! Un buffet solide était dressé dans la salle, où chacun, sans façon, piquait à sa guise un sandwich quant l’appétit lui venait et le mangeait à pleines dents à deux pas du Führer ! Hitler lui-même avait été, auparavant, rôder secrètement en bateau tout le long de la côte à investir. Il connaissait chaque crique du débarquement. L’agent 007 n’eût pas fait mieux ! Le jeune officier qui quittait la Chancellerie sortait ébloui d’avoir été reçu avec une telle simplicité par le chef suprême de son armée. Il était gonflé à bloc. Il avait vu que l’affaire était préparée avec soin par un connaisseur, doublé d’un as. En quelques jours, l’opération fut bouclée, cependant que, le corps expéditionnaire franco-anglais, mis en branle pourtant avant celui d’Hitler, s’empêtrait dans ses impedimenta, se faisait geler les pieds dans les neiges et casser la tête par les bombes des Stukas. Tous les glorieux plans et pronostics des superspécialistes des états-majors occidentaux avaient été volatilisés. Les généraux de Gamelin, sept mois après la chute de Varsovie, avaient été ridiculisés une deuxième fois, étouffés sous le fatras de leur science, monumentale et morte comme les Pyramides. N’empêche ! Ils continuaient à ironiser sec dans les salons de Vincennes sur ce grotesque caporal qui prétendait en savoir plus que les professionnels de la science militaire, théorique et appliquée ! Lesdits professionnels, au bout d’un mois de campagne de France, se retrou[93]-veraient, comme le général Giraud, fourbus, col ouvert, sur l’herbette d’un camp de prisonniers, ou bien, ayant couru ventre à terre pendant mille kilomètres, trempés, haletant, dégraferaient leur ceinturon et reprendraient péniblement leur souffle dans les derniers châteaux des derniers contreforts du massif pyrénéens. Des millions de fuyards, pris de folie, avaient fait, en huit jours, ce que le Tour de France fait, avec beaucoup de peine, en un mois. Hagards, éreintés, ils avaient laissé les talus de l’exil remplis de valises, de manteaux d’astrakan et de grands-mères mortes d’épuisement, dont les cadavres abandonnés pourrissaient au soleil parmi les quartiers noircis de chevaux et de vaches. Ils avaient été l’image vivante – ou, plus exactement, agonisante – d’un vieux monde ankylosé, que submergeaient un monde nouveau, des corps neufs et des esprits neufs. Ce n’était pas une défaite, c’était un enterrement, l’enterrement de l’Europe de papa, c’était l’irruption d’une génération qui regardait l’univers avec des yeux du début de la Création. Les jeunes Allemands pourraient un jour être broyés à leur tour – et ils le furent. Mais ils avaient crée de l’irréparable, liquidé une époque, belle peut-être pour les nantis à la Boni de Castellane ou les pédérastes à la Proust, sinistre pour les autres, époque cadavérique que des milliers de mouches à viande entouraient déjà de leurs tourbillons lorsque le vieux maréchal Pérain, mâ[94]-chonnant ses moustaches, hissa son drapeau blanc, à la suprême semaine de l’aventure, à la fin de juin 1940. Hitler, pour la première fois de sa vie, avait levé le nez vers la coupole de l’Opéra de Paris et baissé le nez vers le tombeau de porphyre de Napoléon, barque rose à l’arrêt dans une cuvette de marbre gris. La croix gammée déployait ses longues traînées écarlates de l’océan Arctique à la Bidassoa. L’Occident tout entier était assommé, hébété, n’ayant encore rien compris, sinon que tout était perdu, que la machinerie rouillée des vieux pays – les partis, les régimes, les journaux – gisait dans les fossés comme de la ferraille du matériel de guerre défoncée et carbonisée par les panzers. Il semblait à tous que nul pays ne remonterait jamais d’un tel gouffre. Seul, un de Gaulle inconnu se penchait de son balcon londonien, vers la vieille dame France dégringolée, jupons en l’air, chignon mâchuré, au fond du trou noir de l’hexagone. A part les velléités salvatrices de ce pompier sans échelle de secours, il n’était plus un Français, un Belge, un Luxembourgeois, un Hollandais qui crût à la résurrection du monde démocratique réduit en cendres en quelques semaines. - « On croyait l’Allemagne maîtresse de l’Europe pour mille ans », répétait le ministre belge Spaak, cramoisi, le crâne luisant, le linge trempé, qui trimbalait tristement, en juillet 1940, ses rotondités spongieuses, d’auberge en auberge, dans les vallons auvergnats. Chacun, à sa manière, avait vécu une aventure. Une des moins drôles avait été la nôtre, à nous, rexistes bel[95]-ges. Puisque, en France autant qu’à Bruxelles, la grande presse avait répété à satiété que nous étions des hitlériens, la police française nous avait sauté dessus dès la première heure des hostilités. Elle nous avait fait rafler à douze mille et nous avait embarqués vers ses geôles et vers ses camps de concentration. Nous avions été traînés de prison en prison, traités avec une fureur barbare dans des chambres à torture, rossés cent fois, la mâchoire démolie à coups de trousseaux de clefs, la bouche maintenue ouverte pour que nos geôliers puissent y déverser leur urine. Je parle de ce que j’ai subi personnellement. J’avais été condamné à mort à Lille, dès la première semaine. Mes vingt et uns compagnons de souffrances, dans notre camion cellulaire, furent tous assassinés comme des chiens près du kiosque à musique d’Abbeville, le 20 mai 1940. nul de leurs bourreaux – des militaires français, hélas ! – ne connaissaient même leurs noms. Parmi eux se trouvaient des femmes : une jeune fille, sa mère, sa grand-mère. Celle-ci eut, avant d’expirer, la poitrine crevée une trentaine de fois à la baïonnette ! Un jeune prêtre qui, durant les deux derniers jours, avait contenu contre sa pommette un oeil qu’un gardien sadique lui avait fait jaillir de l’orbite, d’un coup de poing forcené, fut abattu comme les autres. Nul, de tout notre lot de prisonniers, n’échappa à cette épouvantable tuerie sinon moi, uniquement parce que mes bourreaux s’imaginaient qu’à force de me martyriser – dix dents fracassées en une seule nuit – je leur dévoilerais les plans d’offensive d’Hitler, dont j’ignorais tout, on l’imagine bien ! Ma survie temporaire importait donc aux Services de Renseignements. La rapidité du dénouement militaire fit qu’elle se transforma en une survie [96] prolongée dont je bénéficie encore à ce jour. Mais enfin, ressortant des bagnes français, je me retrouvais les bras ballants, comme tous les autres. Qu’allait-il se passer ? Le vieux système politique, social, économique, de l’Occident était jeté au sol comme un jeu de cartes piétinées, inutilisables à jamais. Alors, quoi ? Les armées du Reich campaient partout. Le système allemand s’installait partout. La France de Vichy de l’été 1940 n’était plus qu’un pauvre congrès d’ex-politiciens châtrés et de généraux ignares, redondants, attablés dans de médiocres salles d’hôtels d’une ville d’eau vraiment symbolique car la France était à l’eau. Au Nord, les Hollandais avaient vu leur reine, retroussant ses nombreux jupons, filer dare-dare vers Londres, puis vers le Canada. La grande-duchesse de Luxembourg, sortie d’un collection de modes d’institutrices du XIXe siècle, avait pris aussi le vert dans la prude campagne britannique. Entre ces deux pays, le roi des Belges, Léopold III, neurasthénique dont les nerfs usés payaient la rançon d’une syphilis ancestrale, était confiné dans son château de la banlieue bruxelloise. L’unique ancien ministre qui était resté à ses côtés, Henri de Man, président, la veille encore, du parti socialiste belge, s’était rallié tapageusement à Hitler, sans résultat quelconque d’ailleurs. Comme seuls les fleuves étaient, en 1940, resté à leur place, de Man se contentait d’aller pêcher des goujons, non politiques. L’armature des Etats, le statut social, l’économie, les possibilités même les plus élémentaires de gagner sa [97] croûte avaient été culbutées. On avait vu jusqu’aux condamnés de droit commun, le poil court sous leur calot, les pieds nus dans de gros sabots, jetés sur les grand-routes, à la fête d’ailleurs, pillant, hilares, les épiceries. Des centaines d’ambulances, des hôpitaux , bourrés de civils en fuite, avaient échoué, avec leurs matelas et leurs canaris, dans les préaux des écoles du Languedoc ou du Roussillon. Il n’y avait plus de flics, plus de pompiers, plus de croque-morts entre la Frise et la Marne. Ils s’épongeaient le front sur les bancs des jardins publics de Nîmes ou de Carcassonne. Des millions de réfugiés tourneboulés déboulaient de toutes parts. Et surtout, la question revenait, lancinante : que vont devenir nos pays ? que pense, que veut Hitler ? va-til nous annexer ? va-t-il nous imposer des gauleiters ? En fait, les gens eussent accepté n’importe quoi, pourvu qu’on leur rendît leur gagne-pain, leur pernod, leur plumard et leurs pantoufles. Mais pour ceux qui avaient fait du salut de leur patrie la raison de leur existence, la question de la survie de leur pays, de son destin futur, était plantée comme un dard dans leu coeur et le déchirait à chacun de ses frémissements. Le sort de tout pays occupé en 1940, qu’il fût grand et riche comme la France, ou minuscule comme le Grand-Duché de Luxembourg avec ses trois burgs et ses quatre rochers de schiste, était dans les mains d’Hitler, et de nul autre. Ce qui restait de territoire libre en France pouvait être submergé en quarante-huit heures. Le maréchal Pétain, trottinant dans sa chambre d’hôtel à l’ascen[97]-seur, avait moins de pouvoir garanti qu’un conducteur de métro ou un garde-barrière lampant son calvados. Quant à la Belgique, réapparaîtrait-elle un jour ? Serait-elle rattachée au Reich, plus ou moins ouvertement ? En deux, en trois tronçons différents, rivaux déjà ? Allemands d’Eupen et de Malmédy ? Flamands, encouragés par l’occupant et qui s’ébroueraient avec fièvre dans un nationalisme étroit ? Wallons qui ne savaient même plus ce qu’ils étaient, ni surtout ce qu’ils seraient : anciens Belges ? futurs Français ? Germains de seconde classe ? terre de colonisation que les nationalistes flamands obtiendraient comme espace vital ? Lorsque je rentrai à Bruxelles, sorti enfin de mes prisons françaises, barbu, amaigri, anéanti, je me sentis, malgré que tout fût alors politiquement pensable, happé par un profond désespoir. Pour le grand public, assailli pendant les deux dernières années de l’avant-guerre par des flots de mensonges, j’étais l’homme d’Hitler. Or, j’ignorais le premier mot de ce que celui-ci pouvait combiner à propos de mon pays. Je ne savais même plus où camper. Ma belle propriété de la forêt de Soignes était occupée par les Allemands. J’étais soi-disant leur homme. Or, ma maison avait été envahie par eux sans explication quelconque. Cinquante aviateurs y bivouaquaient. Montant par surprise à ma chambre, j’avais trouvé, tout nu en travers de mon lit, un énorme colonel de la Luftwaffe, cramoisi comme un gigantesque homard fabriqué pour un filme de science-fiction. Je n’eus d’autre ressource, les premiers jours, que de dormir sur un lit de camp, chez l’une de mes soeurs. Je l’ai dit cent fois : nous n’avions rien à voir avec les Allemands. Et cet énorme militaire installé sur mon [99] plumard, le poil luisant de sueur, disait assez l’instabilité de mon sort et l’inexistence des plans que le Grand Reich aurait pu tisser autour de ma personne. Nous étions des nationalistes, mais des nationalistes belges. Et la Belgique avait, à ce moment-là, coulé à pic. Son avenir était complètement bouché, obscur comme un tunnel dont on ne savait même pas si la sortie finale n’était pas murée, et s’il redeviendrait un jour plus ou moins praticable. Tel fut mon drame de chef nationaliste rentrant dans mon pays, occupé par les forces d’un homme d’Etat étranger, auquel on me disait entièrement lié et dont j’allais longtemps ignorer quel genre d’édification politique et quelle base d’accord il imaginait pour chacune de nos patries, au sein de l’Europe que ses mains de fer forgeaient. Quelle survivance réserverait-il à mon peuple ? Le mystère était total. Chapitre VI A côté des Allemands [101] Les mois de la fin de 1940 et du début de 1941 ne furent drôles pour personne en Europe, en Belgique pas plus qu’ailleurs. Des Hollandais, nul ne parlait. Eux allaient sans doute être inclus dans le complexe géographique grand-allemand. Le Grand-Duché de Luxembourg également, de toute évidence. Quant aux Français, ils étaient déjà parvenus, sous l’oeil narquois des occupants, à se manger le nez entre eux, avec un acharnement qui eût nettement fait plus d’effet derrière un canon antichar en juin 1940. Un mois après avoir jeté les bases de la collaboration avec Hitler, le maréchal Pétain avait vidé par-dessus bord son Premier ministre Pierre Laval que les Allemands n’aimaient pas, dont les ongles sales, les dents jaunes, le poil de corbeau déplaisaient à Hitler, mais dont l’ambassadeur Abetz, alors très en cour à Berchtesgaden, appréciait l’habileté, la bonhomie, le sens très auvergnat du maquignonnage et de l’adaptation. Laval, sarcastique, chiquotant ses cigarettes sous ses moustaches brûlées, avait répondu du tac au tac et traité le Maréchal comme un vieil uniforme de troupier désaffecté. Bref, c’était la pleine pagaille. Elle durerait jusqu’au [102] dernier jour, en France et même hors de France, au château d’exil de Sigmaringen, où les « collaborateurs » français se fuyaient dans les sombres couloirs du faux burg féodal, peuplés d’armures énormes et sinistres. Restait notre cas à nous, Belges, le cas le plus compliqué. J’avais pu renouer des contacts avec le roi Léopold, prisonnier, enchaîné par Hitler et déchaîné par la nurse de la famille, dont il ferait sa femme, promue brusquement princesse de Rethy. Son secrétaire, le baron Capelle, nous servait d’estafette. Il m’avait conseillé vivement, de la part du souverain – et j’avais pris grand soin de noter aussitôt ses propos par écrit – de tenter quelque chose pour jeter un pont dans la direction du vainqueur. L’ambassadeur Abetz, ami pittoresque avec qui j’avais passé, en 1936, un semaine de vacances dans l’Allemagne du Sud et dont la femme avait été, en même temps que la mienne, élève d’un pensionnat français du Sacré-Coeur, était un esprit très curieux. Les non-conformistes lui plaisaient tout spécialement. Après mon odyssée de prisonnier, il m’avait invité, à plusieurs reprises, à déjeuner ou à dîner à son ambassade de Paris, dans le ravissant palais de la Reine Hortense, rue de Lille. Il collait une fanfare entière de le Wehrmarcht dans le jardin, au bas de notre petite table, pour le plaisir de faire retentir d’un immense tapage musical la rive gauche de la Seine, à l’usage exclusif de deux jeunes garçons. Nous avions étudié ensemble toutes les possibilités d’avenir de la Belgique. Il s’était rendu à Berchtesgaden pour parler de ce problème avec le Führer. Il lui [103] avait rappelé notre entrevue de 1936, lui avait redit l’impression qu’elle lui avait faite alors. Il décida Hitler à m’inviter. Il me prévint qu’une auto viendrait incessamment me chercher à Bruxelles, me demandant de me tenir prêt à partir pour Berchtesgaden à n’importe quel moment. J’attendis. J’allais attendre trois ans avant de rencontrer enfin Hitler, sous des sapins sombres de la forêt lithuanienne, une nuit, où, blessé quatre fois au cours de dix-sept corps à corps, ayant rompu, la veille, l’encerclement de Tcherchassy en Ukraine, j’avais été ramené dans l’avion personnel d’Hitler, afin qu’il me passât au cou le collier de la Ritterkreuz. Mais trois années avaient été perdues. Tout échoua en octobre 1940, je l’appris par la suite, parce que des dirigeants flamands, à l’instigation de services de Sécurité allemands qui rêvaient de casser la Belgique en deux, avaient fait savoir qu’un accord d’Hitler avec un Wallon se heurtait à l’opposition de la partie flamande de la Belgique. C’était imbécile et absolument contraire à la vérité. J’avais, en 1936, obtenu aux élections à peu près autant de vois en Flandre qu’en Wallonie. Et un accord avec les chefs nationalistes flamands eux-mêmes avait, en 1937, coordonnés nos conceptions politiques et notre plan d’action. Mais, puisque des services d’espionnage allemands affirmaient qu’un arrangement avec moi aboutiraient à déclencher des oppositions linguistiques très violentes dans une zone de combat, base principale de la lutte aérienne de l’Allemagne contre l’Angleterre, Hitler remit les négociations à plus tard. C’était l’impasse, la nuit absolue. [104] Après l’annulation de mon entrevue, le roi Léopold lui-même tenta, envers et contre tout, de rencontrer Hitler. Sa soeur, la princesse héritière d’Italie, la femme d’Humberto, alors allié privilégié du Reich, jeune femme puissamment carrossée, la jambe haute, l’oeil clair et dur, était allée à Berchtesgaden relancer le Führer, avec l’acharnement que savent déployer les femmes, parfois à contretemps. Hitler avait reçu finalement Léopold III, mais froidement. Il ne lui avait rien dévoilé. L’entrevue s’était limitée à cette distribution de liquide tiède, moins révélateur encore que du marc de café. L’échec avait été complet. Tout ce que nous fîmes durant l’hiver 1940-1941 pour dégeler l’iceberg allemand échoué sur nos rivages, ne nous conduisit guère plus loin. Nos avances – notamment au cours d’un grand meeting que je donnai au Palais des Sports après le Nouvel An – n’eurent d’autre résultat que quelques lignes de compte rendu banal dans le Volkischer Beobachter. Au fond, Hitler savait-il lui-même alors ce qu’il voulait ? Comme dirait, en mai 1968, le général de Gaulle, lorsque la révolution des étudiants de la Sorbonne faillit le submerger, « la situation était insaisissable ». La guerre contre les Anglais allait-elle se prolonger ? Ou, comme le croyait et le disait le général Weygand, le Royaume-Uni allait-il tomber sur les genoux, tout d’un coup, écrasé sous le fer et le feu ? [105] Et les Soviets ? Molotov, fouinard sous ses besicles, était venu en octobre 1940 à Berlin, apporter à Hitler, outre le spectacle de sa dégaine de voyageur de commerce au pantalon ondoyant comme un pneu, la liste des plats copieux que Staline prétendait se voir offrir à brève échéance. Les armées du Troisième Reich venaient à peine de balayer la moitié de l’Europe que les Soviets prétendaient se faire allouer, sans frais et sans risques, l’autre moitié du continent ! Déjà, profitant de la campagne de Pologne en 1939, Staline avait englouti les trois pays baltes, en un coup de dents vigoureux de goinfre insatiable. Il avait récidivé en juin 1940, dévorant la Bessarabie. Maintenant, ce qu’il exigeait, c’était, ni plus ni moins, le contrôle complet des Balkans. Hitler avait été l’ennemi numéro un des Soviets. Bien à contrecoeur , afin de ne pas être amené à devoir combattre sur deux fronts dès le début de la guerre, il avait marqué un temps d’arrêt, en août 1939, dans sa lutte contre le communisme. Mais il était impossible qu’il permît l’installation des Soviets à la lisière même du continent qu’il achevait à peine de rassembler. La menace était nette. Le danger, non seulement était grand, mais il était évident,.. Hitler ne pouvait pas se laisser acculer à une ruée des Russes vers le Reich si un gros revers à l’Ouest ts le frappait un jour. Il devait être prêt à devancer un mauvais coup, sur les possibilités duquel les menaces sorties de la petite bouche de belette jaune de Molotov ne laissaient guère de doute. Prenant prudemment les devants, Hitler avait mis en route, secrètement, la préparation de l’Opération Barbe[106]-rousse, dont l’élaboration des plans avait été confiée au général Paulus, le futur vaincu de Stalingrad. Entre-temps, tout, en Europe, restait indécis. Les divisions internes des Français et la liquidation rapide d’une politique de rapprochement avec Pétain avaient conseillé à Hitler de laisser le temps passer et les affaires de l’Occident se tasser. Le moral des différents peuples de l’Ouest se liquéfiait. Des oppositions de races, de langues, de clans, d’ambitions les rongeaient, sans qu’une grande action ou, au moins, une grande espérance les soulevât. Pour moi, c’était clair : deux ans, trois ans d’une telle stagnation, et la Belgique serait mûre pour la liquidation, l’absorption, plus ou moins directe des Flamands dans une Germanie unifiée, la mise au rancart des Wallons, Européens asexués, ni Français ni Allemands ; et l’élimination silencieuse d’un roi Léopold devenu totalement invisible, séparé de son peuple, naviguant entre sa bibliothèque vide et une nursery moins solitaire mais qui, tout de même, politiquement, ne conduisait pas bien loin. Espérer revoir Hitler ? Il n’était même plus question d’une rencontre. Discuter avec des sous-fifres à Bruxelles ? Ils n’avaient aucun pouvoir de discussion. Ils étaient, en outre, gorgés de la suffisance des militaires vainqueurs traitant de haut des civils vaincus. Nous nous détestions avec une égale vigueur. Il fallait arriver à pouvoir discuter un jour d’égal à égal avec Hitler et avec le Reich victorieux. Mais comment ? L’horizon politique restait désespérément impénétrable. [107] C’est alors que, brusquement, le 22 juin 1941, se déclencha la guerre préventive contre les Soviets, accompagnée de l’appel d’Hitler aux volontaires de toute l’Europe, pour un combat qui ne serait plus le combat des Allemands seuls mais des Européens solidaires. Pour la première fois depuis 1940, un plan européen apparaissait. Courir au front de l’Est ? De toute évidence, ce ne seraient pas les modestes contingents belges que nous pourrions rassembler au départ qui feraient que Staline mordrait la poussière ! Parmi des millions de combattants, nous ne serions qu’une poignée. Mais le courage pouvait suppléer au petit nombre. Rien ne nous empêcherait de lutter comme des lions, de nous comporter avec une vaillance exceptionnelle, d’amener l’ennemi d’hier à constater que les camarades de combats d’aujourd’hui étaient forts, que leur peuple n’avait pas démérité, qu’ils pourraient, un jour, dans l’Europe nouvelle, être une élément vigoureux, digne d’action. Et puis, il n’y avait pas d’autre solution. Certes les Alliés pouvaient gagner, eux aussi, Mais, à cette victoire des Alliés, franchement, combien d’Européens envahis croyaient-ils, à l’automne de 1940 et au début de 1941 ? dix pour cent ? cinq pour cent ? Ces cinq pour cent étaient-ils plus lucides que nous ? Qui le prouve ? Les Américains, sans lesquels un effondrement du Troisième Reich n’était même pas imagina[108]-ble en 1941, s’en tenaient toujours à une politique « chèvre-choutiste ». Leur opinion restait, dans sa majorité, nettement isolationniste. Tous les sondages et de l’opinion publique aux Etats- Unis l’établisssaient et le rappelaient à chaque nouveau test. Quant aux Soviets, qui eût imaginé en 1941 que leur résistance serait coriace comme elle le fut ? Churchill lui-même déclarait à ses intimes que la liquidation de la Russie par l’Allemagne serait une affaire de quelques semaines. Le probable, pour une Européen de 1941, c’était donc qu’Hitler l’emporterait, qu’il deviendrait vraiment « le maître de l’Europe pour mille ans » que nous avait annoncé Spaak. Dans ce cas, ce n’était pas en pataugeant dans les marais troubles et stériles de l’attentisme, à Bruxelles, à Paris et à Vichy, que des titres pourraient être acquis, assurant aux vaincus de 1940, dans l’Europe de demain, une participation correspondant à l’Histoire, aux vertus et aux possibilités de leurs patries. Cela compris, il s’agissait de donner l’exemple. Je n’allais tout de même pas encourager mes fidèles a courir au casse-pipe entre Mourmansk et Odessa sans être mêlé à eux, sans partager avec eux les souffrances et les dangers des combats ! Je m’engageais donc, bien que je fusse père de cinq enfants. Et je m’engageais comme simple soldat, pour que le plus défavorisé de nos camarades me vît partager avec lui ses peines et ses infortunes. Je n’avais même pas prévenu les Allemands de ma décision. Deux jours après que je l’eusse rendue publique, un télégramme d’Hitler m’annonça qu’il me nommait offi[109]-cier. Je refusai à l’instant. J’allais en Russie pour conquérir des droits qui me permettraient de discuter honorablement, un jour, des conditions de survie de mon pays, et non pour recevoir, avant le premier coup de feu, des galons qui ne seraient que des galons d’opérette. Je deviendrais par la suite (au long de quatre années harassantes de combats) caporal, puis sergent, puis officier, puis officier supérieur, mais chaque fois ce serait « pour acte de valeur au combat », après avoir, au cours de soixante-quinze corps-à-corps, trempé préalablement mes épaulettes dans le sang de sept blessures. – « Je ne verrai Hitler, déclarai-je à mes intimes au moment du départ, que lorsqu’il me passera au cou la Cravate de la Ritterkreuz. » Ainsi, exactement, se passèrent les choses, trois ans plus tard. A ce moment-là, je pouvais parler net, blessé à maintes reprises, maintes fois décoré, achevant d’effectuer une rupture du front soviétique qui avait sauté onze divisions de l’encerclement. Et j’allais obtenir d’Hitler – la preuve écrite en existe – un statut reconnaissant à mon pays, au sein de l’Europe nouvelle, un espace et des possibilités supérieures à tout ce qu’il avait connu, même au temps les plus glorieux de son histoire, sous les ducs de Bourgogne et sous Charles Quint. De l’existence de ces accords, nul ne peut plus douter. L’ambassadeur français François-Poncet, qui ne m’aime guère, les a publiés dans le Figaro, carte à l’appui. Hitler a été vaincu. Donc, notre accord, obtenu au prix de tant de souffrances, de tant de sang et malgré [110] tant de crocs-en-jambe, est resté sans suites. Mais le contraire eût pu se passer. Eisenhower écrit dans ses Mémoires que, même au début de 1945, il restait à Hitler des possibilités de gagner. A la guerre, tant que le dernier fusil n’est pas tombé, tout reste possible. D’ailleurs, nous n’empêchions pas les Belges qui croyaient à la solution de Londres de se sacrifier de la même manière, pour assurer, eux aussi, en cas de victoire de l’autre « bloc », le renouveau et la résurrection de notre pays. Ils n’ont pas dût, plus que nous, avoir la vie facile, en butte, certainement, à des pièges et à des intrigues de tous genres. L’exemple de De Gaulle, les persécutions sournoises dont il fut l’objet de la part des Anglais et surtout des Américains, les humiliations qu’il dut encaisser, ont dût être du même ordre que les déboires qu’il nous fallut subir maintes fois, du côté allemand, avant d’obtenir que notre cause fût assurée de la réussite. A Londres comme dans notre camp, il fallait tenir bon, ne pas se laisser intimider, faire corps, toujours, avec l’intérêt de son peuple. Malgré les aléas, il était utile, j’allais dire indispensable, que, des deux côtés, des nationalistes tentassent les deux chances, afin que nos patries survécussent, quel que fût le chapitre final du conflit. Ce n’était pas un motif, toutefois, pour que ceux qui se retrouvèrent du côté des gagnants, en 1945, égorgeassent les autres. Des mobiles très divers animèrent donc nos esprits et nos coeurs lorsque nous partîmes, sac au dos, pour [111] le front de l’Est. Nous allions – premier objectif, objectif officiel – y combattre le communisme. Mais la lutte contre le communisme eût pu parfaitement se passer de nous. Nous partions aussi – second objectif, et en fait, objectif essentiel à nos yeux – non pas, exactement, pour combattre les Allemands, mais pour nous imposer aux Allemands qui, grisés par l’orgueil d’innombrables victoires eussent pu nous traiter par-dessus la jambe dans chacun de nos pays occupés. Certains ne s’en étaient pas fait faute déjà et leur duplicité prolongée ne fut pas sans nous scandaliser à maintes reprises. Après l’épopée du front russe, il leur deviendrait difficile de saboter encore les représentants de peuples qui auraient lutté courageusement à côté de leurs armées, dans un combat qui nous rendait tous solidaires. Ce fut là le grand motif de notre départ : forcer le sort, forcer l’attention et l’adhésion des Allemands vainqueurs, en édifiant avec eux une Europe que notre sang, à nous aussi, aurait cimentée. Nous allions vivre en Russie des années horribles, connaître physiquement, moralement, un calvaire qui n’a pas de nom. Dans l’Histoire des hommes, il n’y a jamais eu de guerre à ce point atroce, dans des neiges sans fin, dans des boues sans fin. Affamés souvent, sans repos jamais, nous étions accablés de misère, de blessures, de souffrances de tous ordres. Pour arriver finalement à un désastre qui engloutit nos jeunesses et anéantit no vies… Mais, dans la vie, qu’est-ce qui compte ? Le monde nouveau ne se fera que dans la purification du don. Nous nous sommes donnés. Même le don apparemment inutile ne l’est jamais complètement. Il trouve un jour une signification. L’immense martyre de millions de soldats, [112] le long râle d’une jeunesse qui se sacrifia totalement au front russe, ont fourni à l’avance à l’Europe la compensation spirituelle indispensable à son renouveau. Une Europe de boutiquiers n’eût pas été suffisante. Il fallait aussi une Europe de héros. Celle-ci allait se créer avant l’autre, au cours de quatre années de luttes effroyables. Chapitre VII Les tramways de Moscou [113] La guerre d’Hitler en U.R.S.S., déclenchée le 22 juin 1941, commença bien et commença mal. Elle commença bien. L’immense machinerie de l’armée allemande se mit en marche avec une précision parfaite. Il y eut, de-ci de-là, des accrocs, des colonnes fourvoyées, des ponts défoncés sous le poids des chars. Mais ce ne furent que des détails. Dès la première heure, la Luftwaffe avait réduit à l’impuissance, pour des mois, l’aviation soviétique et rendu impossibles les concentrations de l’ennemi. Au bout de dix jours, la Wehrmacht avait triomphé partout, s’était élancée très loin partout. Un effondrement total du front russe et du régime soviétique pouvaient se produire à brève échéance. Winston Churchill plus que tout autre les redoutait et, dans ses dépêches secrètes, les annonçait. Pourtant, la guerre avait, aussi, mal commencé. Et elle finirait mal, précisément, parce qu’elle avait mal commencé. Tout d’abord – et ce fut un élément décisif – elle avait commencé tard, très tard, trop tard, cinq semaines après la date fixée par Hitler, parce que la folle aventure de [114] Mussolini à la frontière grecque, en octobre 1940, avait torpillé les plans hitlériens à l’Est. C’est dans les monts boueux qui séparent la Grèce de l’Albanie que le sort de la Deuxième Guerre mondiale s’est bel et bien joué, plus qu’à Stalingrad, plus qu’à El-Alamein, plus qu’aux plages de Normandie, plus qu’au pont rhénan de Remagen, pris intact, en mars 1945, par le général américain Patton. Mussolini était hanté par les victoires d’Hitler. Lui, le père du fascisme, avait été relégué à un rôle de second plan par la série de campagnes foudroyantes – et toujours triomphales – que le Führer avait menées, tambour battant, de Dantzig à Lemberg, de Narwik à Rotterdam, d’Anvers à Biarritz. Chaque fois, les aigles allemandes avaient été hissées sur des pays, parfois immenses, conquis en un tournemain, cependant que plusieurs millions de prisonniers avaient avancé, comme d’interminables files de chenilles, vers les camps d’hébergement d’un Reich de plus en plus sûr de ses succès. Mussolini, lui, militairement, avait tout raté. Son invasion, in extremis, dans les Alpes françaises, s’était soldée par un échec humiliant. Le maréchal Badoglio, pion très intéressé qui avait ramené chez lui, d’Addis-Abéba, des trésors en or massifs volés dans le palais du Négus en fuite, avait, dès juin 1940, révélé son incapacité tactique, digne de son émule Gamelin. Alors que la France était au sol, que les chars de Guderian et de Rommel se déployaient presque sans combat jusqu’à la Provence et qu’une descente à Nice n’eut dû être, pour les Italiens, qu’une brève excursion militaire parmi des verges aux fruits mûrs, Badoglio, qui, pourtant, avait eu à sa disposition de longs mois [115] pour se préparer, avait réclamé à Mussolini vingt et un jours supplémentaires pour astiquer les derniers boulons de ses guerriers. L’opération avait vite tourné en cacade. Les Français avaient sonné durement les agresseurs de la dernière minute, leur infligeant des pertes considérables et les clouant au sol, dans le déploiement piteux de leurs plumets mordorés. En Afrique, le démarrage en Libye n’avait guère été plus brillant : un général italien avait été fait prisonnier dès le premier jour. Lorsque l’artillerie italienne s’était payé le luxe d’abattre un avion qui miroitait en plein soleil, il se trouva que ce fut celui du maréchal Balbo. Il fut descendu comme une perdrix. Ainsi, le plus fameux aviateur tué par les Italiens en 1940 avait été leur plus glorieux chef ! Le temps n’avait rien arrangé. L’armement italien, vanté tapageusement pendant vingt ans, était déficient. La Marine manquait de zèle. Le troupier ne se sentait pas guidé. Le maréchal Graziani, esprit brouillon, piètre entraîneur, préférait donner ses ordres à quinze mètres sous terre plutôt qu’à quinze mètres en avant de ses troupes comme le ferait plus tard sur le front italien le général Rommel, le lansquenet intrépide. Mussolini rageait. Il était furieux de tous ces échecs. Il imagina de redorer son blason militaire au cours d’une conquête facile de la Grèce, qui serait préparée à coups de millions départis discrètement parmi le personnel politique d’Athènes. Ainsi, la victoire serait acquise sans grand heurt, sur un ennemi d’accord d’avance pour céder et qui ne résisterait que pour la forme. – « J’avais acheté tout le monde ! Ces salauds de Grecs ont empoché mes millions et m’ont roulé ! » Cette confidence [116] surprenante, c’est le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d’Italie, vif d’esprit et assez fripouillard sur les bords, qui me la fit personnellement, en juin 1942, lorsque, passant en avion par Rome, en coup de vent, je le vis pour la dernière fois et l’interrogeai sur cette guerre de Grèce, ratée de façon si extraordinaire. Sur ces affirmations de Ciano (son gendre), Mussolini, en octobre 1940, brusqua les événements. Il ne souffla mot à Hitler de ce plan d’invasion. Lorsque le chancelier allemand qui se trouvait à Hendaye, où il venait de rencontrer le général Franco, eut vent d’un tel projet, il fit aussitôt lancer son train spécial vers l’Italie, où il se vit accueillir, le surlendemain, sur les quais de Florence, par un Mussolini triomphant :- « Mes troupes viennent de débarquer en Grèce ce matin ! » Hitler était arrivé trop tard ! Il ne put que souhaiter bonne chance à son collègue. Mais il tremblait. Et avec raison. Au bout de quelques jours, les troupes italiennes qui s’étaient engouffrées en Grèce, dans la chaîne des monts du Pinde, se faisaient bousculer, écharper, refouler de l’Epire, dans une débâcle de plus en plus tragique. Les chefs italiens, vantards le premier jour, paniquards le second, s’étaient comportés lamentablement. Les soldats étaient anéantis. On vit le moment où le corps expéditionnaire italien allait se faire jeter au grand complet dans l’Adriatique et où l’Albanie entière serait submergée par les jupons blancs des Grecs. Il fallut, comble de l’humiliation, faire appel à Hitler qui dépêcha en toute hâte vers Tirana des forces allemandes de secours. La situation fut rétablie, mais l’essentiel ne résidait même pas en cela. Que les grecs se fussent adjugé l’Alba[117]-nie, excroissance assez vaine de l’empire italien, n’eût pas été spécialement tragique. Le roi Victor-Emmanuel eût porté sur la tête une couronne de moins. Il se fût trouvé raccourci d’une vingtaine de centimètres lors des cérémonies d’Etat, ce qui n’eût absolument rien eu d’affolant. L’affolant, c’est que l’entrée des Grecs dans la guerre avait provoqué le débarquement en Grèce des Anglais, devenus des alliés par ricochet. Or, les Anglais installés en bas des Balkans, c’était la possibilité, la presque certitude de les voir couper les lignes de l’Est lorsque Hitler se serait enfoncé très profondément dans l’immense espace soviétique. S’y ajoutait la hantise des raids de l’aviation britannique, installée en force dans ses nouvelles bases grecques. Elle pouvait, sous des bombardements massifs, incendier les puits de pétrole roumains, indispensables au ravitaillement des vingt divisions de Panzers qu’Hitler se préparait à lancer à travers deux mille kilomètres de frontières soviétiques. Les risques étaient devenus immenses. Ils devinrent absolument redoutables lorsque, le même hiver, la Yougoslavie du roi Pierre, à l’instigation d’agents anglais, se dressa contre les Allemands. Il n’y avait plus, dès lors, de ruée possible, à la date prévue, en U.R.S.S., d’autant plus que Molotov venait d’envoyer au roi yougoslave des félicitations particulièrement insolentes de Staline et l’assurance de son appui moral. A la suite de cette sotte aventure mussolinienne, Hitler, avant de reprendre l’Est à son grand projet, se voyait condamné à nettoyer préalablement les Balkans, à dévaler avec ses chars à travers toute la Yougoslavie, toute la Grèce et même à s’emparer du porte-avions [118] anglais qu’était devenue l’île de Crète. Ce fut un rush sensationnel. En dix jours, la Yougoslavie fut vaincue et entièrement occupée. Puis ce fut la descente à tombeau ouvert jusqu’à Athènes et jusqu’à Sparte. La croix gammée brillait au-dessus des marbres dorés de l’Acropole. Les parachutistes de Goering descendaient, avec un héroïsme triomphant, sur l’île de Crète où la déroute des Anglais fut consacrée en quarante-huit heures. Les navires alliés en fuite vers l’Egypte se firent descendre comme des canards sur les étangs landais. Parfait. La menace avait été liquidée. Mais cinq semaines avaient été perdues, cinq semaines qu’Hitler ne rattraperait plus jamais. Soldat, j’ai connu pas à pas – car nous traversâmes la Russie entière à pied – chaque détail de cette tragédie. C’est parce qu’un mois manqua à Hitler que la guerre ne se termina pas en 1941, au front russe, ce mois-là que, précisément, l’amour-propre blessé de Mussolini avait fait perdre à l’Axe par sa lamentable équipée de la frontière grecque. Le temps avait été perdu. Et un matériel de la plus haute importance avait aussi été perdu. Non point que les chars allemands aient été détruits en grand nombre au cours des combats échelonnés de Belgrade au canal de Corinthe. Mais le matériel lourd des Panzer Divisionen avait été sérieusement mis à mal au cours de trois mille kilomètres de courses par monts et par vaux, souvent très caillouteux. Des centaines de chars devaient être révisés. Ils ne purent pas être mis en ligne, le 22 juin 1941, lors du grand démarrage. Je dis ce que j’ai vu, de mes yeux vu : [119] les divisions blindées de Von Kleist, du groupe d’armées du Sud aux ordres du maréchal Von Rundstedt, qui se ruèrent à travers l’Ukraine, ne comportaient, chiffre à peine croyable, que six cent chars ! Six cent chars pour mettre en pièces des millions de soldats soviétiques, des milliers de chars soviétiques, et arriver, tout de même, à Rostov, au fin fond de la mer Noire et de la mer d’Azov, avant que ne surgît l’hiver, non sans avoir dû encore détourner l’essentiel de cette force blindée pour se jeter à la rencontre du général Guderian descendant du nord, et réaliser avec lui le plus grand encerclement de l’histoire militaire du monde à deux cent kilomètres à l’est de Kiev. Avec cinq cent chars de plus, le groupe d’armées allemandes d’invasion au Sud de l’U.R.S.S. eût atteint, avant les froids, Stalingrad et Bakou. Ces chars qui manquaient, c’est Mussolini qui les avait fait perdre. Si catastrophique qu’ait été ce décalage de cinq semaines dans l’horaire, un matériel allemand plus abondant eût pu compenser, très probablement, le déséquilibre dans les temps. Mais, là aussi, la guerre commença mal. Les renseignements fournis sur la force de l’U.R.S.S. s’étaient rapidement révélés faux. Les Soviets possédaient non point trois mille chars, comme les Services secrets allemands l’avaient prétendu à Hitler, mais dix mille, c’est-à-dire trois fois plus de char que l’Allemagne n’en alignait. Et certains types de chars russes, tels que le T. 34 et le KV. 2, de cinquante deux tonnes, étaient normalement invulnérables, d’une solidité extraordinaire, construits tout spécialement pour dominer les boues et les neiges de là-bas. En outre, la documentation sur les voies d’accès à [120] travers l’espace russe était erronée : de grandes artères prévues pour les chars n’existaient même pas ; d’autres, sablonneuses, étaient tout juste bonnes pour supporter le passage de troïkas légères. La moindre auto s’y engloutissait. Néanmoins, grâce à des miracles d’énergie, la ruée s’accomplit. En vingt-cinq jours, sept cent kilomètres avaient été franchis et conquis. Dès le 16 juillet 1941, Smolensk, la dernière grande ville sur l’autoroute qui conduisait à Moscou, était tombée. Du point extrême de l’avancée allemande, la boucle d’Elyna, il ne restait plus que 298 kilomètres avant d’atteindre la capitale de l’U.R.S.S. ! En deux semaines d’offensive à la cadence en cours, celle-ci eût été atteinte. Staline préparait déjà le transfert du corps diplomatique jusqu’au-delà de la Volga. La panique régnait. Des manifestants huaient le communisme. On vit même brandir, dans une rue de Moscou, un drapeau à la croix gammée, fabriqué à la hâte. Mais se précipiter vers Moscou, d’un intérêt stratégique relativement maigre, c’était renoncer à détruire l’immense cohue de plus d’un million de soldats soviétiques, qui, au Sud, refluaient en désordre vers le Dniepr et vers le Dniester. On ne mène pas une guerre pour occuper des villes mais pour anéantir la force combattante de l’adversaire. Ce million de Russes en déroute, laissé en paix, se fût reconstitué à l’arrière. Hitler avait donc raison. Il fallait les prendre sans retard, avec tout leur matériel lourd, dans la nasse d’immenses encercle[12]-ments, près desquels les encerclements de Belgique et de France de 1940 seraient presque des jeux d’enfants. C’était aussi s’assurer, économiquement, les énormes richesses minières du Donetz. Malheureusement, Guderian ne disposait pas de forces suffisantes pour mener, à la fois, la course vers Moscou et l’anéantissement de l’ennemi à l’autre extrémité de la Russie. Quel que fût le choix, la deuxième opération serait presque certainement engagée trop tard. Si, au lieu de devoir arrêter ses blindés sur l’autoroute de Smolensk et abandonner provisoirement la conquête de Moscou, à portée de sa main, Hitler avait disposé de deux ou trois mille chars de plus, les deux opérations géantes, la conquête de Moscou à l’Est et l’encerclement de la Masse soviétique au Sud, eussent pu être réussies à temps et simultanément. Et même la troisième opération, la conquête, dès avant l’hiver 1941, de la Volga inférieure et du Caucase. Longtemps on s’est demandé comment Hitler avait pu commettre une telle erreur d’évaluation et s’élancer à travers l’empire gigantesque des Soviets avec, seulement, 3254 chars, à peu de choses près ce qu’il possédait en entrant en France au mois de mai 1940. Avait-il été victime, lui aussi, des illusions qui égarèrent tant de stratèges à la suite de la piteuse campagne militaire des Soviets en Finlande au cours de l’hivers 1939-1940 ? Pas même ! - « Quand j’ai donné l’ordre à mes troupes d’entrer en Russie, me dit-il un jour, j’ai eu la sensation d’enfoncer à coups d’épaule une porte derrière laquelle se trouvait un local obscur dont j’ignorais tout ! » Alors ? … Alors il a fallu attendre le dépouillement [122] des archives de la Heereswaffenamt pour connaître la vérité. Ces documents révèlent qu’aussitôt après la campagne de France de 1940, Hitler, voyant l’écrasante menace soviétique s’affirmer, exigea une production mensuelle de 800 à 1000 chars. Le chiffre n’avait rien de fou, et il serait largement dépassé un an plus tard. Les usines du Reich n’eussent-elles même sorti que la moitié des chars réclamés alors par le Führer que le rush des blindés hitlériens à travers l’U.R.S.S. eût été impossible à arrêter. Mais, dès alors, le sabotage qui aboutirait à l’attentat contre Hitler, du 20 juillet 1944, était mené sournoisement par d’importants généraux d’Administration, à qui étaient confiés les services de production de l’arrière. Sous prétexte que ces chars coûteraient deux milliards de marks (quelle importance !), et réclameraient cent mille travailleurs qualifiés (l’Allemagne en regorgeait, la Wehrmacht étant alors inactive) le Heereswaffenamt étouffa les ordres de fabrication. Les saboteurs allèrent même plus loin. Hitler avait exigé que les chars III, pourvus jusqu’alors de canons de 37 calibres, fussent dotés de canons de 50 mm L 60, capables de venir à bout des blindés les plus puissants. Ce n’est qu’à la fin de l’hiver, c’est-à-dire trop tard, qu’Hitler apprit que les canons prévus par lui, à 60 calibres de longueur, n’en possédaient que 42. cette faiblesse se révéla fatale devant Moscou. - « Lorsque, raconte Guderian, Hitler remarqua, en février 1942, que ses instructions n’avaient pas été exécutées, bien que les possibilités techniques existassent, il fut pris d’une violente colère et ne pardonna jamais [123] aux officiers responsables d’avoir agi de leur propre autorité » Mais le mal était fait. L’effort de création d’un nouvel armement fut presque insignifiant. Pendant ces mois, le Troisième Reich, s’il l’avait réellement voulu, eût pu facilement fabriquer cinq mille, six mille nouveaux chars, plus puissamment calibrés, adaptés exactement au climat et aux extraordinaires difficultés du terrain qu’ils devraient affronter dans leurs futurs combats. Alors, oui, la ruée à travers l’U.R.S.S. eût été irrésistible. Il n’en fut rien. Vingt Panzer Divisionen pénétrèrent le 22 juin 1942 en Russie, au lieu des dix qui avaient conquis la Belgique, la Hollande et la France en mai de l’année précédente. Mais le passage de dix à vingt divisions était théorique. Il y avait deux fois plus de Panzer Divisionen mais deux fois moins de chars dans chacune d’elles. Malgré tout, ce qui se passa tint du prodige. Guderian descendit à marches forcées vers le Donetz, menant des combats d’une audace inouïes. Deux fabuleuses razzias, près de Kiev, à Ouman, où Guderian n’était pas intervenu, puis près de Poltava, anéantirent les forces soviétiques du Dnieper. C’est seulement après ce dernier encerclement, le plus colossal de la guerre (665 000 prisonniers, 884 blindés et 3718 canons conquis) qu’Hitler donna l’ordre à Guderian de regrimper vers le nord, pour essayer, non seulement de prendre Moscou à revers, [124] c’est-à-dire par le sud-est, mais même de foncer jusqu’à Nijni-Novgorod (actuellement Gorki) à quatre cent kilomètres plus à l’est, sur la Volga même ! L’opération, si elle eût réussi, eût été la plus prodigieuse chevauchée blindée de tous les temps : de Pologne à Smolensk, puis de Smolensk au Donetz, puis du Donetz, de nouveau, vers Moscou, et à 80 lieues au-delà, vers la Volga ! Plusieurs milliers de kilomètres à franchir en cinq mois, en combattant ! Avec du matériel usé, des servants rendus ! Guderian repartit à travers tout, franchissant des étapes qui atteignirent jusqu’à cent vingt-cinq kilomètres en un jour. En même temps que lui, toutes les forces blindées allemandes du Nord couraient de Smolensk droit devant elles, vers la capitale soviétique. Moscou allait être pris au bout d’une manoeuvre d’une précision stratégique parfaite. La guerre eût été terminée quand même ! Les cinq semaines perdues avant le commencement de la campagne et le manque de deux ou trois mille chars qui eussent permis le dédoublement de colonnes d’assaut, allaient faire échouer cet immense effort final, à quelques kilomètres de la réussite. Dès la fin d’octobre 1941, des boues effroyables avaient enlisé les formations de chars du Reich. Plus un blindé n’avançait. Plus un canon ne pouvait être déplacé. Les approvisionnements restaient englués sur les routes : non seulement le ravitaillement des soldats, mais les munitions de l’artillerie et l’essence des chars. Le gel allait faire le reste. Il allait, en novembre et au début de décembre 1941, s’aggraver de façon de plus en plus catastrophique, passant de 15° sous zéro, à 20° sous zéro, à 35° sous [125] zéro, pour atteindre même 50° sous zéro ! Depuis cent cinquante ans, la Russie n’avait pas connue un hiver plus féroce ! Impossible aux chars de se déplacer. Quarante pour cent des soldats avaient les pieds gelés, privés de l’équipement d’hiver auxquels l’Intendance n’avait guère pensé, elle non plus, entre 1940 et 1941. Vêtus toujours de leurs uniformes légers de l’été, sans manteau souvent et sans gants, à peine nourris, ils courraient inexorablement à l’effondrement physique. En face d’eux, les Soviets disposaient de chars capables de braver la boue, le gel et le froid. Le premier matériel anglais venait d’atteindre les faubourgs de Moscou. Des troupes fraîches avaient été amenées, en très grand nombre, de Sibérie, qu’une intervention japonaise – qui, elle aussi, fit défaut – eût retenu en Asie très utilement. Chaque jour le combat devenait plus atroce. Pourtant, les assaillants allemands poursuivaient leur effort, quelle qu’en fût la rigueur. Des flèches avancées avaient même dépassé Moscou au nord, à Krasnaia Poliana. D’autres avaient atteint les faubourgs de Moscou et occupé le dépôt des tramways. Devant eux, dans le gel dévorant, les coupoles de la capitale des Soviets brillaient, tentaculaires. C’est là, à quelques kilomètres du Kremlin même, que l’assaut fut enrayé à jamais. Les unités étaient devenues squelettiques. La plupart ne possédaient même plus le cinquième de leurs effectifs. Les soldats s’abattaient sur la neige, incapable encore du moindre sursaut. Les armes, gelées, s’enrayaient, se refusaient à tout service. Les Soviets, par contre, arc-boutés à quelques kilo[126]-mètres à peine de leurs bases, recevaient en abondance vivres, munitions et l’appui de nouveaux chars qui sortaient par centaines des usines même de Moscou. Ils s’élancèrent à la contre-offensive. Les survivants allemands de cette terrible épopée furent dépassés par la vague. La bataille de Moscou était perdue. En plus d’elle, Staline avait gagné la semitranquillité de six mois d’hiver, six mois qui seraient un rempart immédiat, et son salut par la suite. Chapitre VIII L’enfer russe [127] Où qu’on fût, le drame serait identiquement atroce, de décembre 1941 à avril 1942, sur les trois mille kilomètres d’étendue du front russe, de Petsamo à la mer d’Azov. Nous, volontaires étrangers, perdus comme les Allemands dans ces steppes affreuses, en étions réduits aux mêmes extrémités : mourir de froid, mourir de faim, lutter quand même. Mes camarades belges et moi, nous débattions alors dans les neiges du Donetz. Partout, la bise hurlante. Partout, des ennemis hurlant. Les positions étaient taillées à même des blocs de glace. Les ordres étaient formels : ne pas reculer. Les souffrances étaient indicibles. Indescriptibles. Les petits chevaux qui nous apportaient des oeufs gelés, tout gris, et des munitions tellement froides qu’elles brûlaient nos doigts, étoilaient la neige d’un sang qui leur tombait des naseaux, goutte à goutte. Les blessés étaient gelés, aussitôt tombés. Les membres atteints devenaient, en deux minutes, livides comme du parchemin. Nul ne se fût risquer à uriner au dehors. Parfois le jet lui-même était converti en une baguette jaune recourbée. Des milliers de soldats eurent les organes sexuels ou l’anus atrophiés pour toujours. Notre nez, nos oreilles étaient boursouflés comme [128] de gros abricots, d’où un pus rougeâtre et gluant s’écoulait. C’était horrible, horrible. Rien que dans notre secteur des crêtes centrales du Donetz plus de onze mille blessés périrent en quelques mois dans la misérable école où, coupés de tout par des neiges qui atteignaient jusqu’à quatre mètres de hauteur, des médecins militaires, titubant de fatigue, amputaient des centaines de pieds et de bras, recousaient les ventres crevés, contenus dans des blocs de sang et d’excréments gelés, carapaces luisantes de matières rougeâtres et verdâtres, pareilles à des plantes emmêlées au ras d’un aquarium pétrifié. L’évacuation, depuis nos postes de combat jusqu’à cette clinique atroce, de ces blessés étendus à tous vents, se faisaient sur de petites charrettes de paysans russes. Les corps étaient à peine protégés par un peu de chaume arraché aux toits des dernières isbas. Le transfert durait parfois plusieurs jours. Les morts ne s’enterraient plus depuis longtemps. On les recouvrait de neige comme on pouvait. Ils attendraient les dégels pour recevoir une sépulture. Une vermine déchaînée nous dévorait vivants. Dans nos uniformes crasseux, ces poux gris, aux petits oeufs brillants comme des perles, étaient encastrés les uns derrière les autres, comme des grains de maïs. Un matin, à bout d’exaspération,, je me déshabillai malgré le froid : j’en tuai sur moi plus de sept cent. Mais nos vêtements eux-mêmes n’étaient plus que des loques. Notre linge de corps, devenu brunâtre, s’était effiloché de semaine en semaine. Il avait fini en pansements d’urgence de blessés. Des soldats devenaient fous, couraient en criant droit devant eux, dans les neiges sans [129] fin. A chaque corps à corps de bataillon, quatre, cinq, six hommes s’enfuyaient ainsi. La steppe les engloutissait vite. Jamais, je crois, nulle part au monde, tant d’hommes n’ont souffert autant. Ils tinrent bon, malgré tout. Une retraite générale à travers ces interminables déserts blancs et dévorants eût été un suicide. Le refus d’Hitler, envoyant au diable ses généraux paniqués qui réclamaient un repli de cent, deux cent kilomètres, sauva l’armée, on ne le répétera jamais assez. Dans des froids de 40° et 50° sous zéro, et sous des tornades de neige qui culbutaient tout, à quoi une marche en arrière eût-elle pu bien conduire ? La plupart des hommes eussent péri en route, comme périt l’armée de Napoléon qui, elle, n’avait pas fait marche en plein hiver, mais en octobre et en novembre, c’est-à-dire en automne. Et Napoléon se retirait le long d’un seul axe routier et non en arrière de trois mille kilomètres de front, à travers des steppes noyées dans un gigantesque mystère glacial. Pourtant, des centaines de milliers d’hommes que Napoléon avait entraîné avec lui dans sa retraite, quelques milliers seulement survécurent. Alors, que fût-il advenu des troupes allemandes englouties dans des immensités de neige, en janvier et en février 1942, au moment les plus terribles des gels ? … Pour une simple opération de liaison, un jour de janvier 1942, nous dûmes employer dix-sept heures à franchir quatre kilomètres, en nous taillant dans la neige, à la pelle et à la hache, un couloir profond. L’unique chasse-neige fourni à notre secteur avait été stoppé par des murailles de glace. Il n’était jamais parvenu à les rompre, malgré des efforts furieux. [130] Et même, eussions-nous pu, au prix des plus terribles souffrances, opérer, en deux ou trois semaines, un repli de cent ou deux cent kilomètres, qu’y aurait-il eu de changé ? Y aurait-il eu cinq centimètres de neige de moins ? Un degré de froid de moins ? Une grande partie de l’armée eût péri en se retirant. Le reste se fût retrouvé dans une situation encore plus effroyable, vidé de ses dernières forces physiques et morales par un tel effort, avec, en moins, son matériel défensif laissé sur place ou abandonné en route. Contre ses généraux, Hitler avait raison. Il fallait s’enterrer n’importe comment, se protéger n’importe comment. Encaisser tout, supporter tout, souffrir tout, mais survivre ! Et même foncer vers l’ennemi si, coupés des arrières, on devait absolument trouver un peu de nourriture ou un vaste gîte. Car eux, les Russes, gens des neiges, non seulement étaient, physiquement, plus rudes que nous et avaient l’habitude des froids affreux de ces climats, mais ils savaient, depuis des siècles, comment y résister. Ils possédaient l’art de fabriquer des abris contre le froid, autrement protecteurs que nos pauvres refuges maladroitement improvisés. Certains de leurs camps de neige étaient des hameaux semi-souterrains pour tribus mongoles. Les petits chevaux nerveux gîtaient parmi ces moujiks militarisés, costauds, trapus, les yeux bridés à force de fixer les neiges, les pommettes jaunes de graisse grossière dont ils se barbouillaient, et qui les réchauffait. Leurs pieds, dans leurs bottes de feutre, étaient enroulés dans de grosses bandes de molleton. Leurs uniformes, doubles ou triples, étaient boudinés de toutes parts, comme des [131] beignets soufflés. La bise n’y pénétrait pas. ils vivaient ainsi depuis toujours. Et cet hiver particulièrement atroce ne les surprenait pas exagérément. Défendus de la sorte contre l’hostilité de la nature, ils purent même se livrer à des opérations offensives violentes, au sud comme au nord. Il nous fallait alors contre-attaquer, reprendre les steppes perdues. Nous reconquérions des villages détruits. Nous taillions, devant les murs noircis des isbas, des parapets de blocs de glace. Des kilomètres de neige séparaient nos noeuds de résistance. L’ennemi s’infiltrait partout. Les corps à corps étaient effrayants. Dans la seule journée du 28 février 1942, dans une bourgade détruite nommée Gromowaja- Balka (Vallée du Tonnerre !), et où notre bataillon résistait depuis huit jours à l’assaut de quatre mille Russes, nous perdîmes dans une empoignade effroyable qui dura de six heures du matin jusqu’à la nuit, la moitié de nos camarades. Nous nous défendions désespérément parmi les cadavres des chevaux sur lesquels les balles résonnaient comme sur du cristal. Les Russes avançaient en rangs serrés, drapés dans leurs longs manteaux violâtres. Sans cesse, des vagues nouvelles surgissaient, que nous fauchions sur les étangs gelés. L’hiver russe fut ainsi. Pendant sept mois, tout ne fut que blancheur aveuglante. Le froid rongeait les corps. Les combats limaient les dernières forces. Puis, un matin, le soleil apparut, tout rouge, au-dessus des coteaux blancs. Les neiges descendirent petit à petit le long des hauts poteaux, coiffés de bottes de paille, qui avaient signalé les pistes jusqu’au jour où ces sommets touffus avaient été submergés. Des eaux brunâtres dévalèrent [132] avec impétuosité de toutes les collines, s’amassèrent dans la vallons. Un moulin se remit à tourner dans le ciel bleu. Le calvaire de centaines de millions de soldats allemands et non allemands du front russe avait pris fini. La tragédie de l’hiver était terminée. Mais c’est la conquête de la Russie qu’il fallait reprendre. Or la tactique de guerre d’Hitler était basé non seulement sur une stratégie nouvelle – blindés et aviation de rupture fonçant en commun et en masse – mais sur l’effet de surprise. En 1942, il ne serait plus possible de compter sur cet effet de surprise. Staline connaissait désormais cette méthode. La supériorité d’initiative était donc perdue. L’intervention stratégique d’Hitler avait été géniale : la Blitzkrieg, c’est-à-dire la guerre-éclair, l’irruption foudroyante dans les arrières de l’ennemi, la rupture massive de ses lignes en des points précis où était jeté, sans crier gare, l’essentiel des forces. Le bélier était constitué par la masse énorme des chars, devant lesquels l’artillerie des Stukas, semant l’effroi, mettait tout en pièces, ouvrait des voies de passage. En Pologne, en Hollande, dans le Nord de la France, en Yougoslavie, cette formule nouvelle de guerre l’avait emporté parce que, dans chacun de ces pays, c’était la première fois qu’elle était employée, permettant aux pinces géantes, de fer et de feu, de s’engouffrer et de se refermer dans le dos de l’adversaire, coincé, démoralisé, anéanti en un tournemain. En quelques jours, cent mille, deux cent mille hommes étaient pris. C’est cette même formule qu’Hitler avait rééditée en 1941 en faisant irruption à travers la Russie, réussissant les mêmes percées, les mêmes coups de filet, mais à une [133] échelle fabuleuse, notamment en Ukraine et au Donetz. En quatre mois, plusieurs millions de prisonniers, des milliers de canons et de chars avaient été dénombrés. Mais l’Oural était plus loin que les Pyrénées ! Il eût fallut s’y précipiter plus tôt. Ou bien pouvoir, grâce à une force très supérieure de blindés, mener deux ou trois fois plus d’opérations d’encerclement au lieu de devoir courir avec les mêmes forces, limitées, du nord au sud et du sud au nord. Le gel avait devancé Hitler, lui était tombé dessus avec ses quarante et ses cinquante degrés sous zéro, plus fort que l’acier de ses divisions blindées et que la volonté de ses audacieux chefs de Corps. En 1942, il fallait donc remettre ça, sans plus compter que l’on pourrait surprendre encore un adversaire désormais averti. Au surplus, Staline qui, lui aussi, était un génie à sa manière, un génie élémentaire, qui plongeait chaque jour sa volonté dans le sang des autres pour la revivifier, Staline avait eu le temps, non seulement de déceler les secrets de la stratégie hitlérienne qui avait failli le briser, mais de lui trouver une parade. Elle était simple : gagner du temps ; gagner les mois, les années, pendant lesquels il pourrait former des armées nouvelles, puiser, sans pitié quelconque, dans le réservoir de deux cent millions d’habitants de l’U.R.S.S., forger à son tour des dizaines de divisions de chars qui, un jour, surclasseraient de façon écrasante – vingt mille chars contre quelques milliers – les forces blindées qui avaient assuré les triomphes foudroyants d’Hitler, de l’automne 1939 à l’automne de 1942. Hitler, à l’été de 1942, récolterait encore des victoires très spectaculaires entre le Don, la Volga et le Caucase. [134] Mais les tentatives de grands encerclements n’aboutiraient plus. Comme le taureau qu’on ne peut surprendre deux fois, le Russe avait décelé les pièges et il leur échapperait chaque fois à temps. La dernière erreur soviétique fut commise en mai 1942. Et elle acheva de mettre Staline en garde. Ses troupes s’étaient payé le luxe de prendre, prématurément, l’initiative. Peut-être cherchaient-elles à désorganiser la masse offensive allemande qui était en train d’opérer ses préparatifs pour prendre, au sud, son élan ? En tout cas, nous fûmes, aux premiers jours de mai 1942, sur le point d’être submergés, dans le Donetz, par l’avalanche énorme de troupes soviétiques s’élançant de la région de Kharkov vers le Dniepr et Dniepropetrovsk. Elles enfoncèrent le front allemand, se ruèrent devant elles. Mais elle couraient sans plus. Courir ne suffit pas pour détruire. Les Russes n’avaient pas encore saisi exactement le mécanisme des pinces d’encerclement. Nous les laissâmes se perdre dans le vide. Les divisions allemandes et les volontaires étrangers, belges, hongrois, roumains, croates, italiens, ne s’affolèrent pas. tous resteraient exactement collés aux flancs de la percée ennemie. Ils se refermèrent dans ses arrières lorsqu’elle se fut enfoncé beaucoup trop loin, et de façon primitive. De nouveau, comme en 1941, des centaines de milliers de Russes furent faits prisonniers. Aucune de leurs unités ne put s’échapper. Nous étions massés sur les deux côtés et dans le dos de la masse soviétique prise dans nos rêts. Ce fut pour les Russes un grand désastre, que compléta Hitler en mettant à profit cette terrible saignée des [135] Soviets pour se jeter sur Orel, ouvrant ainsi à ses troupes la route des plaines du Don, de Stalingrad et du Caucase. Staline s’était définitivement rendu compte qu’il était loin d’égaler tactiquement son vainqueur. Il ne se risquerait plus à l’attaquer à fond avant que ses forces ne fussent devenues très supérieures à celles du Reich. Alors, seulement, elles pourraient compenser, par le nombre, la supériorité tactique des armées blindées d’Hitler, encore écrasante au printemps de 1942, mais qui s’amenuiserait au fur et à mesure que les jeunes chefs de l’Armée rouge, dégagés de l’ignorance routinière de leurs aînés, s’assimileraient, à force de temps, d’acharnement et aussi de revers analysés avec intelligence, la stratégie qui avait fait Hitler vainqueur et qui finirait par le convertir en vaincu. On put croire, à l’été 1942, qu’Hitler, se lançant vers l’extrémité sud de la Russie soviétique, allait, cette fois, achever pour de bon le colosse russe. Les trouées de juillet et août 1942 avaient été absolument impressionnantes. Nous-mêmes, qui y participions, étions grisés. Nous chevauchions à travers les plaines magnifiques du Don, où des millions de plants de maïs et de tournesols, hauts de trois mètres, s’étendaient jusqu’au bout du ciel doré. Nous franchissions à la nage, mitraillette au cou, les fleuves verts, larges d’un kilomètre au pied de collines surmontées d’antiques tombeaux tartares et festonnés des pampres des raisins mûrissants. Nous progressions de trente, de quarante kilomètres chaque jour. En quelques semaines, l’aile gauche de l’offensive était arrivée à proximité de Stalingrad. A l’aile droite, nous avions, nous, franchi le Don, [136] atteint les grands lacs du Manich, étoilés, la nuit, des millions de marguerites irréelles jetées par la lune sur les flots. Des chameaux dessinaient leurs bosses pelées, râpées comme du vieux cuir. Un tourbillon de poussière, long de dizaines de kilomètres, signalait les colonnes de chars que suivaient des milliers de jeunes fantassins au col ouvert, chantant à tue-tête dans l’été brûlant. Au début d’août, au-delà des eaux bondissantes du fleuve Kouban, se dressèrent devant nos regards éblouis les pics géants du Caucase, aux sommets blancs, brillants comme des vitres. Dans les clairières des premières forêts, devant des huttes de bois perchées sur pilotis – pour se protéger des loups, l’hiver – des Arméniennes trayaient des bufflonnes gigantesques, au cou pendant comme un boa gris. Nous avions avancé durant plus de mille kilomètres ! Nous étions arrivés aux frontières de l’Asie ! Qui nous arrêterait encore ? Pourtant, en réalité, nous n’étions arrivés nulle part car, si nous avions conquis le sol, nous n’avions pas saisi au collet l’adversaire. Celui-ci avait fui avant d’être pris dans nos encerclements. Partout, il s’était évanoui. Nous croyons même qu’il n’existait plus. Il ne s’arc-bouterai au sol que lorsque nous serions arrivés presque à la fin de notre course, terriblement loin de nos bases, réduits numériquement : blessés, éclopés, malades atteints de dysenterie avaient été laissés en cours de route, très nombreux. L’été allait finir. C’est alors seulement que les Russes firent face, au moment où les premières pluies de l’automne s’abattirent par énormes paquets. Une deuxième fois, l’hiver russe allait-il tout stopper ? Nous faire tout rater ? Lucide, ayant enfin compris qu’une saignée pareille [137] à celle de 1941 compléterait sa perte, Staline avait veillé avec un soin extrême à ne plus laisser ses troupes se faire coincer nulle part. mieux valait pour lui perdre mille kilomètres que cinq millions d’hommes, comme l’année précédente. L’espace, à la guerre, est un accordéon. Il va, il revient. Nous n’étions parvenus à conquérir que l’air doré de l’été et un sol nu. Les rails des lignes de chemins de fer avaient été sectionnées tous les dix mètres. Les usines avaient été vidées de leur matériel, jusqu’au dernier établi et jusqu’au dernier boulon. Les charbonnages brûlaient partout, fabuleuses masses orangées qui rendaient fous nos chevaux. Il ne restait, dans les villages, que des vieux paysans tout courbés, des paysannes pieuses et bonasses, de beaux petits gosses blonds jouant près des puits de bois. Sur les places publiques, seules nous attendaient les statues horribles, toujours les mêmes, en ciment vulgaire, d’un Lénine en veston de petit bourgeois et aux yeux d’Asiate, ou d’une sportive mamelue, aux cuisses massives comme des bûches de béton. La seule résistance sérieuse, nous ne la rencontrâmes que trop tard, tout à la fin, juste au moment où il eût fallu clôturer la conquête en enlevant les puits de pétrole devant la frontière de Perse – objectif réel de notre offensive vers le sud -, tandis que Paulus eût dû rejeter définitivement les Russes de l’autre côté de la Volga, devenue frontière de l’Europe. Mais là aussi les Soviets s’étaient soudain arc-boutés. J’ai connu, comme tant d’autre, l’effort désespéré de ces dernières semaines, ces semaines où nous sentîmes, pour la première fois, que, peut-être, la victoire, c’est-à-dire la Russie, nous échappait. Nous avions atteint, à [138] cent kilomètres de l’Asie turque, des monts élevés et sauvages, aux forêts de chênes inexploitées, où on n’avançait plus qu’à coups de hachette, criblées d’obstacles, noyées par les pluies d’automne. Les chars ne passaient plus. Les bêtes ne passaient plus, ou elles crevaient de faim, flagellées par les rafales. Nous nous faufilions à grand-peine dans ces bois spongieux, à la végétation éternelle, barrés de buissons épais et piquants de milliers de prunelliers sauvages. Là, les Russes étaient rois, ayant préparé leurs repaires bien à temps, aux aguets dans les épaisses broussailles, ou installés à califourchon dans les ramures de l’énorme forêt. Ils nous tendaient mille traquenards, nous canardaient, invisibles, partout présents. Les pluies, mêlées des premières neiges, s’abattirent en ouragan. Elles coupèrent, derrière notre dos, les ponts de madriers que nous avions jetés sur les torrents lors de notre avancée. C’est par eux, par eux seuls, qu’eussent peu encore nous parvenir un ravitaillement de fortune et quelques munitions. Réduits à nousmêmes, nous vivions de la viande crue des chevaux crevés depuis une ou deux semaines et que les eaux bouillonnantes rejetaient dans les courbes des torrents. Avec nos couteaux, nous les réduisions en une espèce de pâtée noirâtre. La jaunisse transformait en spectres les soldats : rien que dans notre secteur, face à Adler et à Tuapse, douze mille ictériques furent évacués en une semaine. Notre Légion, comme nombre d’autres unités, n’était plus que l’ombre d’elle-même, réduite au septième de ses effectifs ! Décharnés, nous étions juchés à plus de mille mètres de hauteur sur des pics balayés par les [139] tempêtes, sous les arbres tordus par les tornades automnales. Les Russes grimpaient la nuit, de souche d’arbre en souche d’arbre, jusqu’à nos repaires gorgés d’eau, qui jalonnaient notre ligne de crête. Nous les laissions approcher jusqu’à deux ou trois mètres. Dans l’ombre, nous nous livrions à des combats atroces. Les tirs de barrage, le jour, étaient tels que les cadavres de la nuit devaient rester accrochés dans le vide à des racines, jusqu’à ce que la tête se détachât, au bout de deux ou trois semaines, et qu’il ne restât plus, sous nos yeux hagards, que des vertèbres grises jaillissant de la veste, superposées comme des colliers de négresses. Peu d’entre nous n’avaient pas été blessés. J’avais eu l’estomac crevé et le foie perforé. Qu’eussé-je pu faire d’autre que de rester parmi mes hommes au bord de la dépression ? Nous n’étions plus, affamés, hirsutes, que des épaves humaines. Comment, dans cet état, passerions-nous un deuxième hiver lorsque les neiges auraient recouvert la chaîne entière des monts et tout l’arrière-pays ? C’est alors, le 19 novembre 1942m à cinq heures du matin, à l’autre extrémité du front du Sud, au nordouest de Stalingrad, à la tête de pont de Kremenskaja, sur le Don, que des milliers de canons soviétiques rugirent, que des milliers de chars s’élancèrent à travers les positions de la Troisième et de la Quatrième Armées roumaines. Une semaine plus tard, deux cent trente mille soldats allemands auraient été rejetés vers Stalingrad, dans un encerclement qui n’était pas plus grave, [140] en réalité, que vingt encerclements où les Russes s’étaient fait prendre précédemment, qui eût même pu être rompu, mais que l’impéritie et l’apathie du fonctionnaire tatillon qu’était le général Paulus, convertirait, en quelques semaines, en désastre. La Deuxième Guerre mondiale arrivait à sa grande cassure. L’Allemagne invincible d’Hitler avait été vaincue pour la première fois. Elle venait de basculer sur la pente de la défaite. La chute se prolongerait pendant près de mille jours, avant que le dernier cadavre, celui d’Hitler, ne grillât à Berlin, sous deux cent litres d’essence, dans le jardin noirci de la Chancellerie. Chapitre IX Hitler, qui était-ce ? [141] Cet Hitler, dont nul ne sait au juste, des dizaines d’années plus tard, si ses restes calcinés existent encore, et où ils peuvent avoir échoué, qui était-ce ? Qu’était cet homme qui a bouleversé le monde et en a changé le sort à jamais ? Quel était son caractère ? Quelles étaient ses passions ? Que pensait-il ? Que se passait-il dans son coeur ? En avait-il même un ? Et quel fut son cheminement intérieur jusqu’au jour où, à cent mètres des Russes triomphants, il se fit sauter la cervelle ? Moi, je l’ai connu, connu au long de dix années, connu de tout près au moment de sa gloire, comme au moment où, autour de lui, l’univers de ses oeuvres et de ses rêves basculait. Je sais. Je sais qui il était : le chef politique, le chef de guerre, l’homme, l’homme tout cru, l’homme tout court. Il est vraiment trop simple de se contenter de couvrir d’outrages la dépouille d’un vaincu mort, de dire, d’écrire, d’inventer sur lui n’importe quoi, certain que le public acceptera n’importe quoi pourvu que ça complète l’idée qu’il s’est faire d’Hitler – celle d’un monstre ! -, certain aussi de ce que les rare témoins qui pourraient expliquer qu’il n’en fut pas ainsi se [142] tiendront cois, pour ne pas être enfermés aussitôt dans le même sac ignominieux qu’Hitler mort. Tout ce que le public peut raconter, ou tout ce qu’on peut lui raconter, me laisse parfaitement indifférent. Ce qui importe, c’est la vérité, c’est ce que je sais. D’ailleurs, il faut l’imbécillité des foules pour croire qu’un homme qui entraîna cent millions d’Allemands derrière lui, pour lequel moururent des millions de jeunes hommes, n’était qu’une sorte de Sardanapale, ou de Néron, buvant du sang, du matin au soir, au robinet de sa folie. Je le vois encore à Berlin, le 1er mai 1943, perché au sommet d’une tribune grandiose, au champ d’aviation de Tempelhof. Des centaines de milliers d’auditeurs grondaient de ferveur sous son regard. Pourtant, j’avais été déçu. Son éloquence était peu nuancée, violente, élémentaire, assez monocorde. Un public latin eût été plus exigeant. Même l’ironie était rugueuse. C’était une éloquence-force, plus qu’une éloquence-art. De même, l’éclat de ses yeux ne m’impressionna jamais spécialement. Ils ne fouillaient pas, comme on l’a dit, le regard de l’interlocuteur. Leur feu n’avait rien d’insoutenable. Bleu, vif, l’oeil était beau, son jaillissement puissant, certes, mais qui ne cherchait ni à intimider, ni même à séduire, ni surtout à enjôler. On pouvait le regarder bien en face, avec intensité, sans sentir qu’il vous envahissait ou qu’on le dérangeait. De même pour les fameux fluides. De vieilles folles comme la princesse Hélène de Roumanie ont écrit que lorsque Hitler vous serrait la main, ses doigts lançaient des décharges électriques, évidemment diaboliques ! La [143] main d’Hitler ne serrait pas trop, elle était plutôt molle. Généralement même, surtout avec de vrais amis, Hitler ne donnait pas la main, mais il vous serrait la main dans ses deux mains. Jamais je ne me suis senti transpercé par cet attouchement, comme la vieille folle de princesse roumaine. Jamais je n’ai sauté en l’air sous la déflagration ! C’était un poignée de main tout ordinaire, comme celle d’un garde forestier ardennais. Hitler était simple, très soigné. Ses oreilles m’ont toujours étonné, luisantes comme des coquillages. Il ne jouait pas au play-boy, croyez-moi. Ses vêtements étaient repassés avec soin, il est difficile d’en dire davantage. Ses vestes militaires étaient toutes les mêmes, sans grâce quelconque. Il chaussait du 43 : une nuit où j’avais débarqué chez lui chaussé de bottes de feutre russes, il alla à son armoire, me rapporta une paire de ses propres bottes et fourra dans la pointe un morceau de journal pour que je n’y flottasse point, car je chaussais du 42. ce détail vous dit comme l’homme était sans complication. Il n’avait besoin de rien, sauf de beauté. Il se paya, avec les droits d’auteur de son Mein Kampf, un merveilleux Botticelli qu’il accrocha juste au-dessus de son lit. Il est mort sans laisser un pfennig. Pour lui, ce problème des biens personnels, de l’argent personnel n’existait même pas. je suis sûr que pendant les dernières années de sa vie il n’y pensa pas une seule fois. Il mangeait en dix minutes. Et même son repas était un spectacle plutôt ahurissant. Car cet homme qui se couchait à cinq ou six heures du matin chaque jour, et qui était déjà debout à onze heures, lunettes à [144] la main, devant ses dossiers, mangeait à peine. Et encore, était-ce des mets, qui, pour le grand public, « ne donnent pas de force ». Il mena tout l’effort terrible de la guerre sans avoir avalé une seule fois cent grammes de viande. Il ne mangeait pas d’oeufs. Il ne mangeait pas de poisson. Une assiette de pâtes ou une assiette de légumes. Quelques gâteaux. De l’eau. Toujours de l’eau. Et les festivités culinaires hitlériennes étaient terminées ! Il avait la passion de la musique. A un point même stupéfiant. Il avait une mémoire auditive digne de la mémoire parlée d’un de Gaulle. Un motif musical, entendu une fois par p lui, était absorbé à jamais. Il le sifflotait sans un accroc, si long fût-il. Wagner était son dieu. Il n’en ignorait pas une nuance. Il confondait, dans l’Histoire d’Espagne, Isabelle la Catholique (XVe siècle) et Isabelle II (XIXe siècle), mais il n’eût pas confondu deux notes de tout le répertoire musicale de tout l’univers. Il aimait son chien. On lui avait volé un chien au cours de la Première Guerre mondiale. Ce fut un des plus grands chagrins de sa jeunesse. Oui, c’est ainsi. J’ai connu Blondie, son chien des dernières années. La brave bête arpentait à côté de lui son baraquement de planches, comme si elle soupesait, elle aussi, les aléas tragiques du front russe. Hitler lui préparait lui-même sa pâtée vers minuit, lâchant les visiteurs présents pour aller nourrir son compagnon. Et des compagnes ? Là vraiment, on a dépassé toutes les limites de l’imagination en folie, voire du sadisme. S’il y a bien un homme pour qui la femme-amour a peu compté, c’est Hitler. Il ne parlait jamais de femmes. Il avait horreur des [145] plaisanteries de corps de garde dont tant d’hommes – les petites natures surtout – sont friands. Je dirai plus : c’était un prude. Prude surtout dans sa tenue. Prude dans ses sentiments. Il admirait la beauté féminine. Un jour, il s’emporta parce que son officier n’avait pas demandé son adresse à une jeune fille, extraordinairement belle et radieuse, qui s’était jetée jusqu’à son automobile pour l’acclamer. Non qu’il eût voulu fixer un rendez-vous, comme cent hommes l’eussent fait, mais il eût aimé lui envoyer une gerbe de fleurs. La compagnie féminine lui plaisait. J’ai très bien connu Siegried von Weldseck, la plus jolie jeune femme du Reich, haute, les yeux clairs, la peau merveilleusement douce, les seins menus. N’importe qui eût été fou d’elle. J’ai passé avec elle les dernières belles heures de la guerre, précisément, lorsque, dans mon secteur du front de l’Oder, elle vint rechercher la liasse de lettres que lui avait écrites son ami, le Führer. Eh bien ! l’essentiel de leurs relation consistait, elle-même me le raconta, à aller chez lui tous les mardis – et elle ne s’y rendait même pas seule – afin de s’enchanter de musique ! Hitler n’abondait pas en confidences sur ses succès féminins. Des millions de femmes allemandes – et non allemandes ! – ont été amoureuses de lui. Une armoire entière renfermait des lettres de femmes qui l’avaient supplié de leur faire un enfant ! Il ne leur faisait même pas la cour. J’ajouterai que l’amour ne lui valait rien. Une fatalité effrayante marqua ses divers élans sentimentaux. [146] Il avait débuté par un amour innocent. L’héroïne s’appelait Stéfanie. Lui avait seize ans. Tous les soirs il s’installait au pont de Linz pour la voir passer. Eh bien ! jamais, pendant les mois que dura ce manège, il n’osa lui dire un mot. Hitler – cela paraît impensable – était un timide. Mais timide comme une communiante. Il se consuma pendant deux ans à aimer de loin ladite Stéfanie. Il dessinait le palais, wagnérien bien sûr, où ils vivraient leur bonheur. Il lui écrivait, de Vienne, des lettre éperdues, en caractères nerveux, hachurés. Mais la signature était illisible, et l’adresse n’était pas indiquée. « C’est vrai, je me souviens. Mais c’est vieux tout cela ! Cinquante ans ! Oui, je recevais bien les lettres que vous dites. Alors, à vous entendre, c’étaient des lettres d’Hitler ? » C’est Stéfanie qui parle ainsi. Jamais son amoureux d’alors n’osa se présenter. Elle se maria. Elle vit à Vienne, toute vieille dame, veuve d’un lieutenant-colonel. Ce fut le premier amour d’Hitler. A vingt ans, entièrement absorbé par cet amour muet, Hitler était encore un homme vierge. C’est ainsi. C’est vrai, rigoureusement vrai. On a, évidemment, raconté cent histoires imbéciles sur des amours d’Hitler, avec des prostituées viennoises, avec des Juives, évidemment, et, même, sur la syphilis dont ces dames lui auraient fait cadeau. Ce sont des mensonges. Dans toute la jeunesse d’Hitler, il n’y eut qu’un amour, celui de Stéfanie. Et il ne lui adressa jamais la parole. [147] Si l’amour de Stéfanie n’avait abouti à rien, toutes les autres amours d’Hitler n’aboutirent, elles, qu’à des catastrophes. Pas une seule des femmes qu’étreignit dans ses bras l’homme qui fut certainement le plus aimé d’Europe ne termina son roman sans un drame horrifiant. La première se pendit dans une chambre d’hôtel. La deuxième, sa nièce Géli, se tua dans son appartement de Munich, au moyen de son propre revolver. Hitler en fut comme fou. Pendant trois jours, il arpenta son petit appartement bavarois, prêt à se suicider. Jamais plus le souvenir de Géli ne quitterait sa vie. Géli était partout. Son buste était sans cesse fleuri. La troisième fut Eva Braun, Eva Braun autour de laquelle on a tissé des légendes fabuleuses, souvent insensées, parfois grotesque. Là encore, je suis témoin. J’ai tout su d’elle. Elle était une petite employée du meilleur ami d’Hitler, le photographe munichois Hoffman, très bon ami à moi, également. Elle était folle du bel Adolf, pourtant bien mal attifé alors, dans son épouvantable gabardine claire, toujours froissée, la mèche tombante comme une queue d’oiseau mort, le nez assez gros, appuyé sur la petite brosse à dents de ses moustaches. Mais la belle Eva, grassouillette et rose, l’aimait éperdument. Elle essaya de le prendre au piège d’un baiser. Une nuit de réveillon, elle décida Hoffman, son patron, à lui téléphoner pour qu’il les rejoignît à leur fête. Il sortait peu. Même une nuit de réveillon, il la passait seul dans son deux-pièces. Il finit par se laisser convaincre et arriva. Juste au moment où il passait, sans s’en rendre compte, sous le gui, la belle Eva, qui guettait le moment, lui sauta au cou, suivant la vieille coutume. Hitler s’arrêta net, rou[148]-git comme un conscrit, tourna sur ses talons, arracha au portemanteau sa gabardine et se rejeta à la rue, sans avoir desserré les dents. Je vous le dit : vis-à-vis des femmes, il était incroyablement timide. Un seul baiser avait mis en fuite celui qui mettrait en fuite, dix ans plus tard, l’Europe entière ! Mais l’affaire n’allait pas en rester là. La pauvre Eva était plus amoureuse que jamais. Alors, le drame, à nouveau, pénétra. Quand elle eut bien conscience que le cher Adolf était radicalement inaccessible, elle prit, elle aussi, un petit revolver et se le déchargea en plein coeur. On ignore, généralement, ce suicide-là. Mais, dix ans avant de se suicider à Berlin, près d’Hitler, Eva Braun avait voulu déjà, par amour d’Hitler, se suicider une première fois, à Munich. Après les deux cadavres précédents, il y avait de quoi s’effrayer. Eva n’était pas morte. Hitler voulu savoir si vraiment il y avait eu suicide pour mourir ou, simplement, pour l’impressionner par une petite comédie. Le rapport du professeur de l’université de Munich qui, sur sa demande, l’examina, fut catégorique : Eva n’avait raté sa mort qu’à quelques millimètres. Elle avait bien été l’amoureuse intégrale, celle qui avait préféré mourir plutôt que de ne pas pouvoir projeter vers son bien-aimé tout l’élan de sa vie. C’est d’alors que date l’entrée d’Eva Braun dans la vie d’Hitler. Oh ! entrée discrète. On ne les voyait jamais seuls. Elle était invitée à Berchtesgaden, mais toujours en compagnie d’autres jeunes femmes de collaborateurs du Führer. On s’asseyait au soleil, à la terrasse, face aux Alpes grises, bleues et blanches, il n’y eut jamais – d’amitié – car ce fut, avant tout, une amitié [149] – plus réservée que cet amour-là. Toutes les histoires d’enfants nés d’eux relève de la fantaisie totale. Hitler adorait les enfants, les recevait à sa terrasse, les cajolait. Mais il n’en eut jamais d’Eva, ni d’aucune autre. Dans sa vie, la femme ne fut jamais qu’un éclair de beauté, parmi les travaux de sa vie politique qui était tout pour lui. Et encore, les ombres de la mort enténébrèrent-elles toujours les fugitives lumières des visages féminins sur lesquels son regard s’était posé. Car on n’en avait pas fini avec les balles de revolver. Une autre pétarade féminine allait éclater sous le balcon d’Hitler, le premier jour de la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, c’est une Anglaise qui se suicidait. C’était une fille merveilleuse. Je l’ai bien connue et admirée, elle, comme ses soeurs, dont l’une était la femme d’Oswald Mosley, le chef des fascistes anglais. Toutes étaient belles, mais Unity – Unity Mitford – était pareille à une déesse grecque, élancée, blonde, le type germanique parfait. Elle s’était imaginée qu’Hitler et elle pourraient incarner l’alliance germano-britannique dont Hitler rêva toujours, qu’il évoquait encore quelques jours avant de mourir. Unity suivait Hitler partout. Lorsque celui-ci traversait les foules avant d’atteindre la tribune, elle était là, rayonnante, transfigurée. Chaque fois, un sourire tendre illuminait le rude visage d’Hitler, un bref instant. Car, si Hitler admirait, lissait du regard avec un certain émoi l’admirable visage et le corps parfait d’Unity, notamment dans la maison de Wagner à Bayreuth, l’idylle était toujours limitée à cela. Hitler était alors à la veille de la guerre, et la [150] chevelure dorée de la belle Unity pouvait difficilement être sa préoccupation exclusive. Mais, pour Unity, Hitler c’était tout. Lorsque, le 3 septembre 1939, la guerre avec l’Angleterre éclata et qu’Unity comprit que son amour se brisait, elle passa par-dessus les massifs de rose qui fleurissaient sous les fenêtres du bureau du Führer et sortit son revolver de son sac à main. La balle la blessa grièvement à la tête mais ne la tua pas. il se passa alors une chose absolument extraordinaire. Après qu’Hitler eut confié Unity aux plus grands chirurgiens du Reich qui la sauvèrent (chaque jour il lui faisait, en pleine guerre de Pologne, envoyer des roses), il organisa son retour en Grande-Bretagne. Or, on était à l’hiver de 1939- 1940, et déjà les principaux pays du continent étaient entrés dans le conflit. Pourtant Hitler obtint qu’un train spécial transportât la blessée, non seulement à travers la Suisse mais à travers tout le territoire français, jusqu’à Dunkerque, d’où un bateau, survolé, protégé par la Luftwaffe, la ramena aux rivages de sa patrie. Rien n’y fit. Unity vivota encore pendant les hostilités, ravagée par sa peine. Puis elle se laissa mourir après que le corps d’Hitler eut disparu dans la gerbe de feu du jardin de la Chancellerie, le 30 avril 1945. Il ne resta donc plus qu’Eva à partir de 1939. son rôle demeura jusqu’à la fin tout à fait modeste. Je le dis car j’ai passé jusqu’à une semaine entière près d’Hitler, pendant ces années-là, à son Grand Quartier général. Eva Braun n’y apparut jamais. Jamais d’ailleurs une seule femme, quelle qu’elle fût, ne partagea l’intimité d’Hitler pendant les quatre années que celui-ci passa, cloîtré, dans ses bâtiments de l’arrièrefront. Eva [151] écrivait. Elle téléphonait le soir, vers dix heures. A cela se limitait cet amour au ralenti, aussi discret que romantique. Seule la fin de la guerre lui donna un conclusion, grandiose. Lorsque Eva se rendit compte que tout s’écroulait, que l’homme qu’elle aimait plus que tout allait succomber, elle se jeta en avion dans la fournaise de Berlin, pour pouvoir mourir à son côté. C’est alors, au tout dernier jour de son existence, pour honorer en elle le courage de la femme allemande et le sacrifice de l’amante qui préférait mourir plutôt que de survivre à celui qu’elle aimait, qu’Hitler l’épousa. Avant, il ne se fût pas marié, parce que sa femme, sa seule femme, c’était l’Allemagne. Ce jourlà, il quittait l’Allemagne pour toujours. Il épousa donc Eva. Ce fut vraiment un hommage. Sa dernière nuit, il ne la passa même pas avec elle. Il était le héros sage. Il le resta jusqu’au seuil même de la mort. Tout fut tragique jusqu’à la fin. Lorsque, à côté du corps d’Hitler baigné d’essence en feu, le corps d’Eva se mit à grésiller, son buste, brusquement, se redressa. Il y eut une seconde d’épouvante. Puis il se rabattit dans les flammes. Ainsi se consuma le dernier amour d’Adolf Hitler. Si hallucinante que fut la vie sentimentale – si peu continue – du chef du Troisième Reich, elle occupa, en réalité, une part assez insignifiante dans son existence. Ce qui compta pour lui, vraiment, exclusivement, ce fut son combat public. Politiquement, jamais un homme, sur la terre, ne souleva un peuple comme Hitler le fit. Pourtant, bien malin serait celui qu découvrirait maintenant parmi le gros public allemand un ex-hitlérien s’affichant sans crainte ! La vérité, tout de même, c’est qu’à peu près tous les [152] Allemands furent hitlériens, dès le début, ou par la suite. Chaque élection, chaque plébiscite apportèrent à Hitler une adhésion frémissante et, finalement, presque unanime. Les gens votaient pour lui parce qu’ils désiraient voter pour lui. Personne ne les y forçait. Personne ne les contrôlait. Que ce fût sur le territoire même du Reich, ou dans les régions soumises encore à des autorités étrangères (Sarre, Dantzig, Memel), les résultats étaient identiques. Dire le contraire est faux. A chaque élection, le peuple allemand prouva qu’il était à fond avec son Führer. Et pourquoi ne l’eût-il pas été ? Hitler l’avait sorti de la stagnation économique. Il avait remis au travail des millions de chômeurs désespérés. Cent lois sociales nouvelles avaient garanti le travail, la santé, les loisirs, l’honneur des ouvriers. Hitler avait inventé pour eux l’auto populaire, la Volkswagen, payable à un prix insignifiant au long de plusieurs années. Ses navires de vacances promenaient, des fjords de la Norvège au Canaries, des milliers de travailleurs. Il avait revivifié l’industrie du Reich, devenue la plus moderne et la plus efficace du continent. Il avait doté l’Allemagne – un quart de siècle avant que la France n’essayât de l’imiter – d’autoroutes splendides. Il avait réunifié la nation, rendu une armée à un pays qui n’avait plus le droit de posséder que des tanks en carton. D’un pays vaincu, saigné à blanc (trois millions de morts !) par la Première Guerre mondiale, il avait refait le pays le plus fort de l’Europe. Mais surtout – et cela on l’a bien oublié, or ce fut la réalisation capitale d’Hitler, celle qui changea politiquement l’Europe – il avait réconcilié la masse ouvrière avec la patrie. Le marxisme international – et diverses [153] influences cosmopolites – avaient, en cinquante ans, séparé partout le peuple de la nation. L’ouvrier rouge était contre la patrie, non sans raison toujours, car la patrie des nantis avait souvent été une marâtre pour lui. En Belgique, il défilait derrière des drapeaux rouges au fusil brisé. En France, les rébellions militaires à la Marty avaient été son oeuvre. En Allemagne, les communistes arrachaient les épaulettes des officiers. La patrie, c’étaient les bourgeois. Le marxisme, c’était l’anti-patrie. Hitler, grâce à son programme révolutionnaire de justice sociale et grâce aux améliorations immense qu’il apporta à la vie des travailleurs, ramena à l’idée nationale des millions de prolétaires, notamment six millions de communistes allemands, qui semblaient perdus à jamais pour leur patrie, qui en étaient même les saboteurs, et eussent pu en devenir les fossoyeurs. La vraie victoire – victoire durable et de portée définitive – qu’Hitler remporta sur le marxisme fut cellelà : la réconciliation du nationalisme et du socialisme, d’où le nom de national-socialisme, en fait le plus beau nom qu’eût jamais porté, au monde, un parti. A l’amour de la terre natale, normal, mas qui, laissé à lui seul, serait trop étroit, il unissait l’esprit universel du socialisme, apportant, non en paroles mais dans la vie réelle, la justice sociale et le respect aux travailleurs. Le nationalisme était trop souvent, avant Hitler, le fief exclusif des bourgeois et des classes moyennes. A l’opposé, le socialisme était le domaine presque toujours exclusif de la seule classe ouvrière. Hitler fit la syn[154]-thèse des deux. Un de Gaulle vieillissant tente-t-il autre chose ? Où l’action d’Hitler est le plus méconnue, c’est dans le domaine de la stratégie guerrière. A part un Cartier qui, dans son livre Les Secrets de la guerre dévoilés à Nuremberg, a établi, documents à l’appui, l’ampleur du génie militaire du Führer, il reste de bon ton, parmi les esprits qui se croient distingués, de parler avec une condescendance ironique des interventions d’Hitler dans les opérations de guerre de son temps. Pourtant c’est Raymond Cartier qui a raison. Le plus sensationnel chez Hitler, fut – et l’histoire devra bien le reconnaître un jour – son génie militaire. Génie éminemment créateur. Génie foudroyant. L’invention de la stratégie moderne fut son oeuvre. Ses généraux appliquèrent, avec plus ou moins de conviction, ses enseignements. Mais, laissés à eux-mêmes, il n’eussent pas valu mieux que les généraux français et italiens de leur génération. Ils étaient, comme eux, d’une guerre en retard, ayant à peine décelé, avant 1939, l’importance de l’action combinée de l’aviation et des chars, qu’Hitler les obligea à pratiquer. Même de Gaulle, qui fait figure de précurseur dans ce domaine, ne le fut que partiellement. Il comprit que les ruptures de front ne s’obtiendraient jamais en éparpillant les chars de combat, de bataillon en bataillon, comme de vulgaires canons portés, d’un appui limité. En cela, il bousculait les théories périmées de l’Etat-major français. Par contre, ce que ne saisit pas de Gaulle et ce que saisit Hitler avec une vivacité d’esprit géniale, c’est la combinaison indispensable de l’assaut terrestre – au moyen de la masse des blindés surgissant en un [155] point précis – et de l’assaut aérien, simultané, des escadres d’avions attaquant en vagues accablantes le point de ruptures fixé, broyant tout, ouvrant la percée. Sans les Stukas, la rupture des Panzer-Divisionen à Sedan, le 13 mai 1940, n’eût pas été possible. C’est la dégringolade massive de mille Stukas sur la rive gauche de la Meuse qui ouvrit et qui força la voie. Quelques militaires allemands saisirent remarquablement, dès le début, dès 1934, l’importance de la nouvelle stratégie que leur expliquait Hitler, les Guderian, par exemple, les Rommel, les Manstein. Mais, à dire le vrai, il s’agissait d’officiers peu connus, au grade peu important. Ils furent, eux aussi, découverts par Hitler qui, les sentant réceptifs, les poussa en avant, leur fournit des commandements et l’instrument. Ils ne furent qu’une poignée. La masse des généraux allemands, rétifs, ou peu convaincus devant ces nouveautés, demeurèrent jusqu’en 1940 des spécialistes hautement qualifiés d’une stratégie surannée qui n’eût, en aucune façon, permis la conquête en trois semaines de l’intégralité de la Pologne, ni surtout la fabuleuse chevauchée motorisée de Sedan à Nantes et à Lyon, en mai et en juin 1940. Hitler était, militairement, un inventeur. On parle toujours des erreurs qu’il a pu commettre. L’extraordinaire eût été qu’obligé à inventer sans cesse, il n’en commît point. Mais il inventa, outre la stratégie du regroupement motorisé des forces de terre et des forces de l’air – qu’on enseignera dans les Ecoles militaires jusqu’à la fin du monde – des opérations aussi totalement différentes que le débarquement en Norvège, la conquête de la Crète, l’adaptation de la guerre blindée aux sables d’Afrique – à laquelle nul n’avait pensé [156] jusqu’alors – et, même, aussi, les ponts aériens. Celui de Stalingrad fut autrement difficile, compliqué et périlleux, que celui des Américains à Berlin, dix ans plus tard. Hitler connaissait chaque détail des moteurs, chaque avantage ou chaque inconvénient des pièces d’artillerie, chaque type de sous-marin ou de bateau, et la composition de la flotte de chaque pays. Ses connaissances et sa mémoire sur tous ces chapitres étaient prodigieuses. Nul ne le prit en défaut une seule fois. Il en savait mille fois plus que ses meilleurs spécialistes. Encore fallait-il, en plus, posséder la force de la volonté. Il l’eut toujours, à un degré suprême. Politiquement, seule sa volonté d’acier brisa tous les obstacles, lui fit vaincre des difficultés fantastiques sur lesquelles tout autre se fût brisé. Elle l’amena au pouvoir dans un respect absolu des lois, reconnu légitimement par le Reichstag, où son parti, le plus nombreux du Reich, était encore, toutefois, minoritaire le jour où le maréchal Hindenburg le désigna comme chancelier. Force et ruse. Hitler était habile, madré. Et, aussi, enjoué. On l’a dépeint comme une brute sauvage, se roulant de fureur sur les planchers, mordant à pleines canines dans les tapis. Je ne vois pas très bien, entre nous, comment cet exploit mandibulaire eût été réalisable ! J’ai passé bien des jours et bien des nuits près d’Hitler. Jamais je n’ai assisté à une de ces colères, tant de fois décrites. Qu’il en ait eu, parfois, cela n’a rien d’impossible. Quel est l’homme qui, portant sur ses épaules mille fois moins de soucis qu’Hitler, n’est jamais sorti de ses gonds ? Quel est le mari qui n’a pas fait à sa femme [157] des scènes bruyantes, qui n’a pas claquée les portes, qui n’a pas cassé un plat ou l’autre ?… Qu’Hitler soit parfois monté sur ses grands chevaux n’aurait rien d’invraisemblable. D’autant plus que les sujets d’irritation ne manquaient pas : généraux imbéciles qui ne comprenaient rien, qui reculaient, qui n’obéissaient point, qui sabotaient les ordres ; collaborateurs qui mentaient ; rythme de production qui n’était pas tenu ; revers qui déboulaient de toutes parts ; trahisons fatales dans son entourage immédiat. Mais, même alors, Hitler était capable de rester parfaitement calme. Je me souviens d’un cas tout à fait typique. Un après-midi d’automne de 1944, j’étais chez Hitler où je venais d’arriver avec Himmler, dans sa longue voiture verte. Nous prenions le thé lorsque, tout d’un coup, tomba au milieu de nous une nouvelle stupéfiante : des divisions aéroportées britanniques venaient d’être parachutées avec plein succès en Hollande, dans le dos des Allemands, à Arnheim, près de Nimègue. C’était tout le système de défense occidentale d’Hitler pris à revers, et l’accès de la Ruhr menacé de façon immédiate et directe ! On a, par la suite, raconté complaisamment qu’un traître hollandais de la Résistance avait, à l’avance, informé les Allemands de ce plan. Ce qui aurait permis l’anéantissement en quelques jours de ces divisions britanniques. C'est un mensonge, un mensonge de plus, comme on en a lancé tant d’autres après 1945. Je puis le dire puisque j’étais là quand on annonça la nouvelle à Hitler et à Himmler. Elle les frappa de stupeur. Mais j’ai vu aussi la suite : Hitler se ressaisissant en deux minutes, convoquant son état-major, analysant pendant deux heures la situation, en pensant les données, [158] puis, dans le silence général, dictant ses ordres, lentement, sans un éclat de voix. C’était impeccable et magnifique. Il s’arrêta. Il demanda que l’on rapportât du thé chaud. Et, jusqu’à la nuit, ayant refermé le tiroir de la guerre, il me parla du libéralisme. Je vous assure qu’il n’avait pas, cet après-midi-là, mangé à pleines dents les tapis ! Il eut même des mots drôles, puis il partir, calme, légèrement voûté, se promener sous les pins, avec Blondie, sa chienne. Non seulement ces histoires de fureur extrêmes d’Hitler tiennent de la légende, mais il était un homme délicat, plein d’attentions. Je l’ai vu préparer lui-même des sandwiches pour un de ses collaborateurs qui partait en mission. Une nuit où je discutais avec le maréchal Keitel dans un baraquement, il apparut, lui, l’abstème, nous apportant une bouteille de champagne pour égayer notre conversation. Contrairement à tout ce que l'on a dit, il était un modéré. Au point de vue religieux, il avait des positions bien à lui. Il ne pouvait pas supporter les intromissions politiques du clergé, ce qui n’était pas répréhensible en soi. Ce qui était impressionnant, par contre, c’était son idée sur l’avenir des religions. A ses yeux, il était devenu inutile de les combattre, de les persécuter ; les découvertes de la science, dissipant les mystères, - essentiels à l’influence des Eglises -, la progression du confort. – chassant une misère qui, durant deux mille ans, rapprocha de l’Eglise tant [159] d’êtres malheureux -, réduiraient, de plus en plus, à son avis, l’influence des religions. - « Au bout de deux siècles, de trois siècles, me disait-il, elles seront arrivées, les unes à l’extinction, les autres à un amenuisement presque total. » Il faut dire que la crise, au cours des dernières années, de toutes les religions et plus spécialement de la religion catholique, son recul, ou son élimination parmi les peuples de couleur, son repliement forcé sur l’Europe blanche, ses « adaptations » doctrinales, ses reculades devant le judaïsme traité jusqu’alors en ennemi millénaire et qu’elle envoyait jadis si allègrement au bûchers, sa démagogie à retardement, ses dévaluations disciplinaires, ses poussées d’anarchie et de douteuses fantaisies, n’ont pas donné spécialement tort à Hitler. Sa vue sur cette évolution, inimaginable alors, avait, elle aussi, si l’on peut dire, été prophétique. La pratique de la religion ne le gênait pas. J’avais obtenu de lui que nos aumôniers catholiques puissent poursuivre leur apostolat parmi nos soldats après que nous fûmes devenus une brigade puis une division de la Waffen S.S. Notre exemple fit tache d’huile. La figure la plus originale de la division française de Waffen S.S., la Charlemagne, était un prélât catholique, Mgr Mayol de Lupé, colosse coloré, commandeur de la Légio d’honneur et Croix de Fer de première classe. Ce prélat de Sa Sainteté (doublement S.S. !) ne gênait Hitler en aucune façon, ni non plus notre façon de pratiquer notre religion. Un matin où, chez Hitler même, je sortais, plus pieux qu’aujourd’hui, pour me rendre à la messe, je tombai sur lui dans une allée de sapins. Il allait se coucher, [160] terminant, au petit matin, sa journée. Moi, je la commençais. Nous nous souhaitâmes bonne nuit et bonjour. Puis, tout d’un coup, il releva vers moi son nez qu’il avait assez épais : - Mais, Léon, à cette heure, où allez-vous ? – Je vais communier, lui répondis-je tout de go. Une lueur de surprise jaillit de ses yeux. Puis il me dit, affectueux : - Eh bien ! au fond, si ma mère vivait encore, elle vous aurait accompagné. Jamais je ne me sentis, chez lui, l’objet du moindre discrédit, de la moindre suspicion parce que j’étais catholique. Maintes fois je répétai même à Hitler qu’après la guerre, dès que j’aurais remis sur pied mon pays, je lâcherais la politique pour aider à l’épanouissement moral et spirituel du nouveau complexe européen. – « La politique c’est un secteur. Il n’est pas le seul. Les âmes aussi doivent avoir leur vie propre et s’épanouir. Il faut que l’Europe nouvelle rende cet épanouissement possible, facile et libre. » En tout cas, c’était aux chrétiens à hisser fermement leur idéal dans le monde nouveau qui s’annonçait. Même si certains des principaux dirigeants du Troisième Reich étaient hostiles à leurs convictions religieuses, ils devaient occuper le terrain, exactement comme l’avaient fait les croyants sous Bismarck aussi bien que sous la République française de Combes. Ils n’avaient pas déserté leurs responsabilités politiques sous des régimes qui, pourtant, avaient expulsé les religieux des couvents, ou imposé l’école laïque. En tout, on ne combat qu’en étant présent, en se jetant au plus fort de la mêlée, au lieu de geindre au loin stérilement. Hitler était comme il était. Le génie a ses démesures. Mais il a aussi des possibilités extraordinaires de créa[161]-tions et de divination. Hitler vainqueur eût pu apporter à l’Europe, unifiée par ses armes, des possibilités considérables. Mais, aussi, indiscutablement, des périls considérables. Pour exploiter les unes et pour conjurer les autres, le mieux était encore d’être installé solidement dans la place. Ce fut, en tout cas, mon choix. Boudant en tout le Troisième Reich vainqueur (et vainqueur, il eût pu l’être ; la grande majorité des Européens crurent bien, en 1940 et en 1941, qu’il l’était !), nous nous fussions éliminés de l’avenir. Nous distinguant sur le terrain des armes, le seul qui nous fût alors offert, nous pouvions planter vigoureusement nos bottes dans les plates-bandes du Reich, prêts à participer très activement à l’édification des temps futurs. Hitler, soldat, était sensible au courage du soldat. Nombre de dirigeants des pays occupés me jalousaient un peu, parce que Hitler me témoignait, très ostensiblement, une affection presque paternelle. On a répété partout la phrase qu’il me décocha en me remettant, en 1944, les Feuilles de Chêne : « Si j’avais un fils, je voudrais qu’il soit comme vous. » Mais, au lieu de moisir dans l’inaction politique de leur pays, ces leaders – nul ne les empêchait – eussent peu, tout aussi bien que moi, aller conquérir au front de l’Est, les droits et le respect qu’assurèrent des années de combats, deux douzaines de décorations gagnées durement, et une bonne liste de blessures inscrites dans sa peau et sur son carnet militaire. De toute façon, l’Europe des soldats était créée. C’est elle qui eût dominé de sa force le continent, qui l’eût unifié par sa solidarité, qui l’eût modelé par son idéal. [162] les volontaires du front de l’Est étaient, on le sait un demi-million. Tous étaient venus au front russe bourrés de suspicions et de complexes. Les allemands avaient envahi nos pays. Nous n’avions donc aucune raison de les chérir. Certains d’entre eux, à Berlin et dans les pays occupés, nous exaspéraient par leur orgueil de dominateurs. L’Europe que nous voulions ne se ferait pas comme eux le prétendaient, en collant le doigt à la couture du pantalon, en face d’un quelconque General-Oberst, ou d’un Gauleiter. Elle se ferait dans l’égalité, sans qu’un Etat omnipotent imposât une discipline de Feldwebel à des étrangers de seconde zone. Ou Européens égaux, ou pas d’Europe ! Même en pleine guerre, même quand nous risquions notre peau à chaque heure au front à côté des Allemands, et – ceux-ci manquaient d’hommes, tout de même ! – à la place des Allemands, des agents du S.D., le fameux Sieckerein Dienst, [sic] n’hésitaient pas à nous faire moucharder en plein combat ! J’en découvris plusieurs. Je les démasquai devant la troupe, exigeai des autorités allemandes des excuses officielles, les fis passer en conseil de guerre, me chargeant moi-même des fonctions d’accusateur. J’obtins leur condamnation à plusieurs années d’emprisonnement dans une forteresse. Dans la gigantesque machinerie administrative du Troisième Reich, les faux chiens et les mouchards ne manquaient pas. tout en nous comblant hypocritement de salamalecs, des Allemands de Bruxelles, importants, ne nous trouvant pas malléables à leur gré, bombardaient Berlin de rapports « geheim » (secret !), visant à déblatérer contre nous. Je surveillais leurs manèges [163] de près. Ils avaient été jusqu’à faire photocopier, à sept exemplaires, ma correspondance familiale du front ! Lorsque je revins en Belgique, cravaté de la Ritterkreuz, après la rupture de l’encerclement de Tcherkassy, toutes les « grosses légumes » allemandes de Bruxelles, qui avaient vu les photos d’Hitler me recevant avec une affection indéniable, et qui avaient flairé le vent, s’amenèrent à ma propriété de la Drève de Lorraine pour m’y saluer. Le chef du S.D. se trouvait dans le lot, un colonel nommé Canaris – comme l’amiral, le chef et traître du contre-espionnage allemand, qui termina sa carrière, en avril 1945, dans une situation assez élevée, qu’il n’avait pas prévue pourtant, suspendu à un croc de boucher. Lorsque, son tour venu, mon Canaris bruxellois s’approcha, mielleux, je lançai, d’une voix de stentor, désignant à l’assistance les lettres S.D. brodées sur sa manche : - Colonel, savez-vous ce que ces lettres signifient ? L’autre était devenu cramoisi. Il ne comprenait pas. pour lui, S.D. signifiait, évidemment, Sicherein Dienst [sic] Une telle question, devant tous les généraux allemands, le laissait interdit. Qu’est-ce que je voulais bien dire ?… - Vous ne le savez pas ? Eh bien, moi, je vais vous l’expliquer, colonel : S.D., cela signifie Surveillance Degrelle ! Le pauvre type eût disparu par les canalisations des W.C., s’il eût pu. Chacun comprit qu’il valait mieux ne plus essayer de me marcher sur les pieds, que j’avais la botte dure. Avec les comploteurs allemands, ces réactions vigoureuses étaient payantes. Les tempéraments, non plus, ne correspondaient pas [164] toujours. Les Allemands sont souvent solennels, guindés, vite susceptibles. Nous n’avions pas des têtes en pots de fleurs. Et la blague nous amusait plus que les propos compassés. Pourtant, au bout de deux ans de combats communs, de souffrances communes, de victoires communes, nos préjugés étaient tombés, les amitiés s’étaient nouées, les affinités politiques s’étaient affirmées. Des jeunes qui eussent, après la guerre, imposé leur unité de l’Europe du Front aux vieux rétrogrades, bien décidés à les écarter, généraux ou non, sans ménagement exagéré, chaque fois que leur élimination eût été nécessaire, ou simplement utile. Vraiment, au front de l’Est, l’Europe exista. Non pas une Europe de boutiquiers, anxieux d’accroître, en s’unifiant, le rendement de leur boutique. Non pas une Europe de militaires conservateurs, qui avaient, avec tant d’intolérance, régenté leurs fiefs occidentaux sous l’occupation. Mais une Europe de soldats, une Europe d’idéalistes, qui, soudés par l’épreuve supportée en commun, en étaient arrivés à ne plus former qu’une seule jeunesse, à ne posséder qu’une seule foi politique, à ne plus avoir qu’une même conception de l’avenir. Camarades dans l’Europe des jeunes soldats vainqueurs, nous eussions été, comme au front, égaux et solidaires, vidant par-dessus bord les décatis omnipotents, fagotés dans le corset de leur passé démodé. Les Waffen S.S. tant décriés, si imbécilement et si injustement, ce fut cela : les aristocrates de l’Héroïsme, s’imposant à tous parce qu’ils étaient les plus braves, les [165] plus audacieux, ceux qui avaient un idéal, passé au fer et au feu, et qui fonçaient pour le faire vaincre. On a fait d’eux les fourriers des camps de concentration. Le soldat de la Waffen S.S., tout à son combat guerrier, à mille ou deux mille kilomètres de son pays, ignorait le premier mot sur les camps de concentration. Les lettres de nos familles mettaient parfois un mois à nous parvenir. L’arrivée d’un journal était un événement. Le combattant n’avait pas la plus mince idée sur ce que faisaient les Juifs ou sur ce qu’on faisait d’eux dans l’Europe d’alors. Quand nous partîmes pour la Russie, pas un seul Juif, à notre connaissance, n’avait encore été arrêté, en tant que Juif, dans un seul pays de l’Occident. Les gros pontes israélites avaient eu tout loisir de déguerpir, et ne s’en firent pas faute. La Waffen S.S. ne connut rien, au front, du sort des Juifs après 1942, qui renouvelait d’antiques tragédies : car saint Louis qui les chassa de France, Isabelle la Catholique qui les chassa d’Espagne n’étaient pas hitlériens, que je sache. La Waffen S.S. rassemblait en une cohorte formidable, comme Rome et comme l’empire napoléonien n’en connurent jamais, les plus remarquables des soldats, non seulement de l’Allemagne mais de l’Europe entière. Les non-Allemands fraternisaient dans une égalité complète avec les Allemands. C’état même parfois anormal. Nous étions presque mieux traités que nos camarades du Reich ! Peu d’Allemands ont été l’objet de l’affection et de la considération d’Hitler comme je l’ai été, moi, chef étranger d’une division de Waffen S.S. étrangers. [166] Alors, pourquoi eussions-nous eu peur de l’avenir, voyant l’unité européenne que nous formions, à un million de jeunes garçons de vingt-huit pays différents, les plus intrépides, les plus durs et les mieux armés de toute l’Europe ? Qui eût osé nous braver ? et qui nous eût résisté ? L’avenir n’était plus à des vieillards intrigants, promis à des hospices futurs, il était à nous, les jeunes loups. Je connaissais Hitler à fond. Je ne craignais plus le risque de faire une équipe, dans une Europe commune, avec un génie qui avait dépassé, politiquement, les étapes des régions et des nations. - Après la guerre, me disait-il, je changerai le nom de Berlin pour qu’il n’apparaisse plus comme la capitale des Allemands seuls, mais la capitale de tous. » Lui pourrait créer, forger, unir. A cette création, risquée certes, - mais au front nous connaissions d’autres risques ! -, exaltante, à la hauteur des plus grands rêves, comment eussions-nous préféré le retour à un concubinage sordide avec des régimes petits-bourgeois, sans grands vices, sans grandes vertus, sous lesquels l’Europe désunie eût pu, tout au plus, continuer à patauger, comme avant la guerre, dans la plus molle médiocrité ?… Avec Hitler nous risquions gros. Mais, aussi, nous risquions grand. C’est alors, au moment où nous avions conjuré les plus graves doutes et préparé les plus hauts desseins, que l’adversité s’abattit sur nous comme s’écroule une énorme muraille, le jour où, sous les cieux blancs et glacés de la Volga, retentit le craquement sinistre de la capitulation de Paulus à Stalingrad. Chapitre X De Stalingrad à San Sebastian [167] Que penser de Paulus, le maréchal allemand qui, sombrant à Stalingrad à la fin de janvier 1943, entraîna dans sa noyade Hitler et le Troisième Reich ? Ce fut la déveine, ou plus exactement l’erreur d’Hitler – car c’est lui qui l’y nomma – d’avoir eu comme chef du Sixième Corps d’Armée, au point crucial de front russe et au moment où la guerre se joua, un homme qui n’avait aucune des qualités indispensables pour recevoir un tel choc, ou, tout au moins, pour mitiger le désastre. Ce désastre fut total, militairement et psychologiquement. On ne pouvait pas être plus intégralement vaincu que Paulus le fut. Et sa défaite ne pouvait avoir, dans l’opinion mondiale, une répercussion plus vaste. Pourtant, 300 000 hommes perdus, ce n’était pas la fin du monde : les Russes en avaient perdu vingt fois plus en un an et demi. D’immenses espaces restaient à Hitler en U.R.S.S. et en Allemagne de l’Est, où il pourrait manoeuvrer, et où il manoeuvra jusqu’à la fin d’avril 1945. L’Allemagne possédait toujours, en 1943, d’imposantes ressources matérielles et d’extraordinaires possibilités industrielles sur toute la surface de l’Europe occupée. A cette époque-là, Dniepropetrovsk, à des milliers [168] de kilomètres de la Rhur, brillait encore, la nuit, des feux éblouissants des fabriques de munition de la Wehrmacht. Et, protégées par leurs rideaux aériens de ballons, les usines esthoniennes [sic] d’Hitler continuaient à extraire du schiste l’essence la plus riche de la Luftwaffe. Pourtant, Stalingrad marqua la chute. Là fut rompue la cordée. On eût pu croire à une corde cassée, qui pourrait se réparer. Mais la rupture fut irrémédiable, suivie de la dégringolade toujours plus accélérée vers le gouffre. Hitler, en nommant Paulus à la tête du Sixième Corps, ne s’était pas imaginé que le militairefonctionnaire, pointilleux, indécis, qu’il détachait vers un grand commandement en Ukraine, serait, précisément, celui qui, de tous ses chefs de corps d’armées, allait devoir assumer, stratégiquement, les plus grandes responsabilités. Son corps d’armée avait, durant l’offensive de l’été 1942, reçu une zone de progression sans risques spéciaux. Foncer vers le Caucase, affronter, à plus de mille kilomètres du point de départ, les monts, les défilés, les eaux grondantes qui barraient l’accès des pétroles, était autrement risqué que de faire avancer des troupes, parfaitement aguerries, pendant quelques centaines de kilomètres entre le Dnieper et le Don, à travers des plaines à peine vallonnées, jusqu’à ce qu’elles atteignissent un fleuve très large, la Volga, qui pourrait former, aussitôt, la plus formidable ligne de défense naturelle de tout le front de Russie. Pourtant, c’est là que tout échoua et que tout craqua. N’importe quel autre chef militaire allemand, de la Wehrmacht ou de la Waffen S.S., - un Guderian, un Rommel, un Manstein, un von Kleist, un Sepp Dietrich, un Steiner ou un Gille – eût atteint Stalingrad en quel[169]-ques semaines et s’y fût embastillé. Paulus était un haut fonctionnaire d’état-major, compétent lorsqu’il était à son bureau devant ses cartes, un faiseur de plans en chambres, un dresseur minutieux de statistiques. Ces gens-là sont nécessaires, mais dans leur spécialité. Par contre, il n’avait aucune idée du maniement réel d’une grande unité. Le plus haut commandement direct qu’il avait exercé avait été celui d’un bataillon, c’est-à-dire d’un millier d’hommes ! Et cela remontait à dix ans ! Ce commandement, très limité, lui avait d’ailleurs valu, de son chef, le général Heim, le jugement suivant : « manque de force de décision ». Or, Hitler allait, d’un coup, lui confier trois cent mille hommes ! Presque toute sa vie, Paulus l’avait passée parmi la bureaucratie des états-majors. Mais il était ambitieux. Sa femme, une Roumaine, assez comiquement surnommée Coca, mousseuse comme de la bibine du même nom, était encore plus ambitieuse que lui. Elle était d’une suffisance et d’une vantardise crispantes. A l’entendre, elle était de la plus haute noblesse balkanique, de sang royal proclamait-elle. En fait, elle portait le nom roturier et peu poétique de Solescu et son père, drôle de bonhomme, avait laissé tomber sa mère de longue date. Elle minaudait dans tous les salons. Elle bassinait, par ses demandes indiscrètes, tout ce qui comptait parmi l’état-major général, acharnée à voir son mari prendre, tout simplement, la succession du maréchal Keitel ! Hitler se fiait avant tout aux visages qu’il connaissait. Il voyait, à tout bout de champ, la tête sévère de Paulus penchée sur ses dossiers de chef des opérations. Il venait de procéder à de nombreux et brusques remaniements au front russe, détachant, pour relever des généraux [170] trop vieux et sans mordant, les plus brillants des chefs dont il avait suivi les réussites pendant l’été. Il lui fallut remplacer, en outre, brusquement, le chef du Sixième Corps, le maréchal von Reichenau, frappé d’apoplexie dans les neiges du Donetz par 40° sous zéro. Pris de court, Hitler désigna le général Paulus, qu’il avait sous la main dans ses bureaux. L’homme fut absolument lamentable. Lorsqu’il fallut, en juillet 1943, entreprendre l’offensive vers la Volga, il eût dû foncer, courir comme tous nous courions. Il traîna, s’éternisa, se noyant dans des difficultés de détails, annulant ses décisions à peine prises, hanté en outre par des problèmes personnels vraiment dérisoires, dont les plus marquants furent, tout au long de la campagne, l’état déficient de son système intestinal ! Il est pénible de constater que le chef d’une grande unité au combat pouvait être littéralement absorbé, en pleine action, par des histoires à ce point misérables ! Tous nous avions la colique, sans faire tant d’affaires ! Bon Dieu, on se jetait vers les rares buissons de la steppe ! Trois minutes plus tard, on repartait en chantant, délesté, la boucle du pantalon resserrée d’un cran ! Mais Paulus inondait son courrier de ses incontinences intestinales ! Des centaines de milliers de soldats, qui avaient bu un bouillon de poule trop gras, ou une eau croupie, n’en appelaient pas, pour autant, au témoignage des Cieux et des Dieux ! Le courrier expédié par Paulus existe encore. Il déborde de descriptions désolées de ses diarrhées, de vieilles histoires de sinusites et de lamentations sur les difficultés matérielles qu’il rencontrait, comme chaque chef d’unité importante en rencontrait et qui n’étaient pas, dans son corps, plus dramatiques qu’ailleurs ! Au [171] contraire, il avait la partie la plus facile. Sa marche était la moins longue, celle où les obstacles étaient les plus réduits et, en tous cas, les plus simples à réduire. Une fois l’objectif atteint, la Volga lui fournirait son énorme barrière d’eau de dix kilomètres de largeur et d’une dizaine de mètres de profondeur. Au lieu de cela, perdu dans les détails, rongé par les appréhensions et par ses ennuis de tripaille, Paulus s’éternisa dans sa démarche, laissant à l’ennemi le temps de se regrouper dès avant le franchissement de la dernière grande boucle du Don. Le fleuve fut traversé, mais avec quinze jours de retard. Plus rien n’empêchait sérieusement de donner le dernier coup de boutoir. Des fonceurs arrivèrent à la rive de la Volga même. Deux ou trois jours d’exploitation vigoureuse de cette percée et Paulus, du haut des falaises de la rive droite, n’eût plus eu devant lui qu’un fleuve vide et, dans son dos, la masse des dernières troupes soviétiques encerclées. Le maréchal soviétique Eremenko ne vivait plus, acculé, étouffé dans son ultime réduit de huit cent mètres, le derrière dans la Volga. Là encore, Paulus manqua complètement de mordant, se laissa bloquer à ces quelques centaines de mètres de la victoire finale, sombrant dans des opérations limitées, meurtrières, décevantes, comme s’il ne se souvenait que des combats de terrain, au mètre carré, devant Verdun en 1917. Tout devait desservir ce fonctionnaire dépassé par son rôle. Le secteur qui couvrait, au nord, le front de Stalingrad avait été imprudemment confié, dans sa tota[172]-lité, à des contingents roumains et italiens qui se firent enfoncer dès le premier jour de l’offensive de novembre 1942, offensive que les Russes avaient préparée en grand secret dans leur tête de pont de Kremenskaia. L’observation allemande avait pourtant décelé leurs préparatifs, et des dispositions avaient été prises immédiatement pour renforcer le secteur menacé. Mais il était dit que pas une malchance ne serait épargnée à ce Paulus malchanceux. Les chars de la vingt-deuxième division blindée allemande, qui se trouvaient en réserve, avaient reçu d’Hitler, le 10 novembre 1942, c’est-à-dire neuf jours avant l’assaut des Soviets, l’ordre de rejoindre le secteur, jugé en danger, de la Troisième Armée roumaine. Ces chars au repos avaient été camouflés depuis un mois sous des meulards de foin. Sous ces abris, des rats – oui, des rats ! – avaient rongé, mangé, sans que nul ne s’en doutât, des centaines de mètres de fils et de câbles de l’équipement électrique ! Au moment de les sortir de leurs meulards et de les mettre en marche, trente-neuf de ces cent quatre chars ne purent même démarrer ; trente-sept autres durent être abandonnés en cours de route. Finalement, ils ne furent plus que vingt, après neuf jours de complications techniques, à pouvoir faire face à l’offensive russe qui, entre-temps avait rompu le front des Roumains depuis trente heures et déferlait en ouragan. Les guerres sont ainsi. Elles se perdent pour un incident dérisoire, ou bouffon. Un troupeau de rats boulimiques fut à la base de la grande débâcle du front de l’Est ! Sans eux, les cent quatre chars de la vingt-deuxième division blindée eussent pu dresser leur barrage avant [173] que l’assaut soviétique n’eût été déclenché. Ces sales petites dents de rongeurs avaient tailladé les nerfs des chars. La ruée soviétique ne trouva de barrage devant elle que trente heure après sa rupture. Vingt chars en tout ! Ce qui avait échappé à l’appétit des museaux fouinards ! Plus de soixante-quinze mille soldats roumains avaient été anéantis entre-temps ! Le Don formait, quand même, à l’ouest du secteur de Paulus, un deuxième barrage. Autre déveine incroyable : quand des chars soviétiques, fonçant à travers tout vers ce fleuve, apparurent à proximité du pont principal, à Kalatch, les défenseurs allemands les prirent pour des amis. Le pont ne sauta pas. En cinq minutes, le Don était franchi ! Dès alors, Paulus perdit la tête. Il se jeta même dans un avion pour aller se réfugier à un P.C. de secours, à Nijni-Tchirskaia, à l’ouest du Don, y gâcha des heures décisives, isolé de son état-major, dut revenir, sur ordre téléphonique d’Hitler furieux, hésita, plus énervé que jamais, ne sachant que décider. Il laissa se rejoindre dans son dos les colonnes de chars soviétiques descendant du nord et montant du sud, sans avoir pu imaginer une parade intelligente. Rien était encore perdu pour cela. Hitler avait immédiatement mis en route vers Stalingrad une colonne blindée de secours, sous le commandement du général Hoth, dépendant du maréchal von Manstein. On a décrit cent fois que le Führer avait abandonné Paulus. Rien n’est plus faux. Ses forces blindées arrivèrent jusqu’à la rivière Mischkova, à quarante-huit kilomètres du sud-ouest de Stalingrad, si près de Paulus que déjà les radios des encerclés et de leurs libérateurs avaient établi le contact. On a conservé la liasse des messages échangés [174] entre Paulus et le maréchal von Manstein. Leur lecture navre. Paulus eût pu, en quarante-huit heures, sauver ses hommes. Il fallait se jeter, comme il le pouvait, vers ses sauveteurs, avec ce qu’il avait à sa portée et avec la centaine de chars qui lui restaient. Un an plus tard, pris exactement comme lui, à onze divisions, dans l’encerclement de Tcherkassy, nous livrâmes d’abord sur le terrain vingt-trois jours de combats acharnés puis, lorsque furent signalés à une vingtaine de kilomètres les blindés du général Hube qui venaient à notre secours, nous nous ruâmes vers eux, for4ant la rupture. Nous perdîmes huit mille hommes au cours d’un corps à corps horrible, mais cinquante-quatre mille passèrent par la brèche et furent sauvés. Même si Paulus en avait perdu le double, ou le quintuple, c’était mieux que de livrer son armée, comme il le fit, à la mort dans l’horreur de l’encerclement final, ou à la capitulation qui fut pire encore, puisque, des deux cent mille prisonniers du Sixième Corps, les Soviets en firent périr, par la suite, de misère et de faim, plus de cent quatre-vingt-dix mille, dans leurs camps. De tous les prisonniers de Stalingrad, neuf mille seulement réapparurent dans leur patrie, nombre d’années après la guerre. Tout valait donc mieux que de rester dans la nasse. Il fallait rompre. Paulus ne parvint à se décider à rien. Von Manstein le relançait par radio ; il envoya, en avion, des officiers de son état-major dans la poche même de Stalingrad, afin de le décider à démarrer enfin. Ses colonnes de chars à lui, sous le commandement de Hoth, s’étaient avancées en fer de lance, elles couraient de plus en plus le risque de se faire encercler à leur [175] tour si les tergiversations de Paulus devaient encore se prolonger. C’est alors que celui-ci, tourneboulé par sa manie tatillonne des regroupements méticuleux à base de paperasses et qui, en fait, préférait au fond de lui-même ne plus bouger, câbla à ses sauveteurs qu’il lui fallait six jours pour mettre au point ses préparatifs de dégagement ! Six jours ! En six jours, en 1940, Guderian et Rommel avaient couru de la Meuse à la mer du Nord ! Paulus et son Sixième Corps n’ont pas échappé au désastre de Stalingrad parce que le chef n’eut ni la force de volonté ni l’esprit de décision. Le salut était sous son nez, à quarante-huit kilomètres. L’effort inouï des chars de libération, arrivés tout près de lui et qu’il eût pu rejoindre en deux jours, ne servit à rien. Paulus, théoricien incapable sur le terrain, cerveau mou, effondré avant même de se décider, laissa tout juste la colonne libératrice s’épuiser à l’attendre. Il n’apparut point. Il n’essaya même pas d’apparaître. Les chars de von Manstein, après une attente interminable et extrêmement dangereuse, durent rompre, repartir vers leur base de départ. Paulus finit, un mois plus tard, encore plus misérablement. Il eût dû, tout au moins, se faire tuer à la tête de ses dernières troupes. Il s’étendit sur son lit dans son poste souterrain de commandement, attendit que des négociateurs de son état-major eussent terminé, au-dehors, les palabres avec des émissaires soviétiques. Il demandait, avec une insistance qui fait mal, qu’une fois qu’il se serait rendu, une automobile soit mise à sa disposition pour le conduire au Grand Quartier général [176] de l’ennemi. Ses soldats agonisaient. Lui, pensait à une auto pour le transporter. Tout l’homme est là. Quelques heures plus tard, reçu à déjeuner par le commandement russe, il demanda de la vodka et leva son verre, devant les généraux soviétiques abasourdis, en l’honneur de l’Armée rouge qui venait de le battre ! Le texte de ce petit discours de table existe encore, enregistré à l’instant, comme on l’imagine, par les Services de Renseignements des Soviets. Ce texte donne la nausée. Deux cent mille soldats de Paulus étaient morts ou partaient vers les camps où une mort atroce les attendait. Lui, vodka en main, saluait les communistes vainqueurs ! On l’emmena à Moscou en train spécial, en wagon-lit. Déjà ce militaire éternellement indécis n’était plus, politiquement et moralement, qu’une épave. Il était, dès alors, mûr pour la trahison. Il échapperait, grâce à elle, aux gibets de Nuremberg. Il reviendrait s’installer en Allemagne de l’Est. Il y végéterait encore quelques années. Il est mort depuis longtemps. Mais ce militaire médiocre, pusillanime et sans volonté avait rompu les reins de l’armée de son pays. Comme un chat au dos broyé, la Wehrmacht s’étirerait, pendant deux ans encore, sur les routes de la défaite, tenace, héroïque. Mais elle était perdue depuis le jour où Paulus, se refusant au risque, avait rompu, devant le monde entier, le mythe de l’invincibilité du Troisième Reich. La preuve que Paulus eût pu résister, se libérer et même gagner sa bataille, fut administrée, l’hiver même, par le maréchal Von Manstein que Paulus n’avait pas osé rejoindre lorsqu’il eût pu – et eût dû – jeter avec vigueur toutes ses troupes encerclées vers leurs sauve[177]-teurs. Ceux-ci fouaillèrent sans répit pendant trois mois les Russes qui, débarrassés de l’armée de Paulus dans leurs arrières, avaient pu courir en avant pendant des centaines de kilomètres, dépassant le Don, dépassant le Donetz, submergeant une partie de l’Ukraine. Quand ils eurent dévalé vers l’ouest, Manstein les coinça, une fois de plus, les battit à plate couture, reconquit Kharkov haut la main, neutralisant partiellement et momentanément le désastre de la Volga. Si Paulus se fût jeté vers Manstein, combattant ensuite à ses côtés, ou s’il se fût cramponné aux ruines de Stalingrad jusqu’au grand printemps – ce qui n’était pas strictement irréalisable – la guerre eût, peut-être, pu encore être gagnée, ou, du moins, les Soviets eussent été contenus plus longtemps. Malgré tout ce qu’avait d’atroce le combat de Stalingrad, des possibilités de résistance subsistaient. Des stocks considérables de munitions et de ravitaillement furent saisis par les Russes dans Stalingrad conquis. Le pont aérien avait donné un appui qui n’avait pas été total, mais qui avait quand même été très considérable. Rien que les vingt-trois mille chevaux et bêtes de charge encerclés en même temps que les troupes, représentaient des millions de kilos de viande utilisables. Les statistiques des réserves fournies par Paulus étaient fausses, comme sont fausses toutes les statistiques fournies par les unités combattantes qui signalent la moitié de ce qu’elles possèdent et demandent le double de ce qu’elles attendent. A Leningrad, avec trente fois moins de ravitaillement, les Russes résistèrent pendant deux ans et l’emportèrent, finalement. Et puis, de toute façon, prolonger, même dans les pires [178] souffrances, la résistance à Stalingrad, valait mieux que d’envoyer deux cent mille survivants périr de souffrances dans les camps de famine soviétiques. Des divisions blindées étaient amenées en hâte de France pour dégager les assiégés. Tout mois gagné comptait. Entre-temps, des armes nouvelles pouvaient être utilisées, susceptibles de tout changer. Chasseurs à réaction, avions à géométrie variable, étaient inventés dans le Reich alors déjà, tandis que les Alliés n’en avaient aucune idée. Les fusées allemandes allaient être opérationnelles, elles aussi, en 1944. si la chance n’avait pas desservi Hitler, notamment lorsque sauta son usine d’eau lourde en Norvège, une bombe atomique comme celle d’Hiroshima eût pu tout aussi bien tomber avant 1945 sur Moscou, ou sur Londres, ou sur Washington. Sur un autre plan, il n’était pas inimaginable que Churchill et Roosevelt se rendissent compte, avant qu’il ne fût trop tard, qu’ils étaient en train de livrer la moitié de l’univers à l’U.R.S.S. Ils eussent pu, à temps, renoncer à mettre au service de Staline les quatre cent cinquante mille camions, les milliers d’avions et de chars, les matières premières et le matériel de guerre fabuleux qui assurèrent au Soviets leur domination, depuis les îles Kouriles jusqu’à l’Elbe. Me mieux était donc de tenir, tenir à la rive de la Volga, tenir au Dnieper, tenir à la Vistule, tenir à l’Oder. Chaque campagne employée à barrer la route aux armées rouges sauvait, peut-être, les millions d’être libres de l’Europe menacée de mort. Après Stalingrad, une fois réaffirmées les possibilités de résistance militaire du Troisième Reich et reconquis [179] Kharkov, l’espoir survécut, pendant quelques mois encore, de reprendre, une troisième fois, l’initiative. Après le premier hiver, la remise en marche des armées européennes avait demandé un effort énorme car Staline avait eu le temps de s’adapter à la guerre-éclair et, surtout, d’en percer le secret. La course au Caucase avait été réalisée, mais, à dire le vrai, avait été manquée, puisque le gros de l'ennemi nous avait glissé entre les doigts. Après un deuxième hiver et après le désastre de Stalingrad, moralement beaucoup plus important que militairement, une troisième offensive deviendrait encore plus difficile, d’autant plus que tout, entre-temps, avait changé en Occident. Les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, s’étaient répandus tout le long du canal de Suez. Rommel avait perdu la partie, et n’était plus, lui, l’ancien proconsul romain, qu’un sous-ordre amer, aigri, prochaine victime d’intrigants. Le continent européen pouvait être envahi n’importe quand, et il le serait l’année même, qui verrait les Yankees mastiquer leur chewing-gum sous les orangers de Palerme et courir les filles dans les ruelles ténébreuses de Naples aux parfums de jasmin et d’urine. L’ultime tentative fut risquée tout de même. La masse puissante de toutes les Panzer Divisionen qui restaient disponibles s’élança, une nouvelle fois, vers Koursk, près d’Orel, en juillet 1943 pour une grande bataille d’anéantissement du matériel soviétique, qui, si elle réussissait, nous livrerait, enfin, après tant d’assauts, les grands fleuves et les grandes plaines jusqu’à l’Asie. L’épreuve fut décisive. Les Soviets avaient été à bonne école. Leurs maîtres allemands de 1941 et 1942 leur avaient désor[180]-mais tout appris. Leurs usines, remontées à l’abri des monts Oural, leur avaient fabriqué des milliers et des milliers de chars. Les Américains avaient fait stupidement le reste, les comblant gratuitement de matières premières en quantités géantes et des armements les plus modernes. Dans nos arrières, l’aviation angloaméricaine broyait tout, pour faciliter aux soviets la course vers la proie européenne. Le duel Koursk-Orel fut hallucinant. Hitler avait engagé sur ce terrain étroit autant de chars et d’avions que sur toute l’étendue du front russe lors de l’assaut général de juin 1941. Pendant plusieurs jours, des milliers de blindés allemands et soviétiques luttèrent fer contre fer. Mais la double percée originelle des armées du Reich se rétrécit de jour en jour, fut stoppée, neutralisée. L’armée allemande, cette fois-ci, était vraiment battue. Elle n’avait pu passer. La preuve venait d’être faite que le matériel russe était devenu le plus fort. C’est là que la Deuxième Guerre mondiale fut perdue, à Koursk et près d’Orel, et non à Stalingrad, car trois cent mille hommes perdus, accidentellement, sur onze millions de combattants ne signifiaient pas un désastre irrémédiable. Le désastre irrémédiable fut ce duel décisif des armées blindées d’Hitler et de Staline, sur le champ de bataille Koursk-Orel, au centre même de la Russie, en juillet 1943. Dès alors, l’immense rouleau compresseur russe n’avait plus qu’à descendre vers les pays civilisés de l’Ouest. Tout ce qu’on pourrait encore faire, c’était l’empêcher de descendre trop vite, avec l’espoir de le stopper tout de même avant qu’il n’atteignît le coeur de l’Europe. Pour sauver ce qui pouvait être sauvé, nous luttâmes [181] encore tout au long de deux années, deux années terribles, où l’on perdait en une semaine plus d’hommes qu’auparavant en un trimestre. Nous nous cramponnions au terrain, nous nous laissions encercler pour retenir l’ennemi pendant dix jours, vingt jours de plus. Nous ne nous échappions qu’au prix de sorties et de ruptures apocalyptiques, laissant derrière nous, dans les neiges nocturnes, se prolonger au loin les cris désespérés des mourants : camarades, camarades… Pauvres camarades que les neiges recouvraient lentement, ces neiges qui, plus d’une fois, avaient été notre unique nourriture… Il fallait foncer à travers les villages russes en feu, parmi les blessés qui se tordaient de douleur sur le verglas rougi, parmi les chevaux qui se débattaient, éventrés, leurs boyaux épandus comme d’affreux serpents bruns et verts. Les derniers chars se rejetaient vers le sacrifice ou, plus exactement, vers l’extermination. Des unités entières se faisaient massacrer sur place. Mais les fronts crevaient partout, étaient béants. Des dizaines de milliers de chars, des millions de Mongols et de Tchirgisses, s’épandirent sur la Pologne, sur la Roumanie, sur la Hongrie, sur l’Autriche, puis sur la Silésie et sur la Prusse orientale. Nous redonnions sans cesse, reconquérant des villages allemands submergés par les Soviets quelques heures plus tôt : les vieillards châtrés, agonisaient au sol dans des marais de sang ; les femmes, les toutes vieilles comme les gamines, violées cinquante fois, quatre-vingt fois, gisaient gluantes, les mains et les pieds attachés encore à des piquets. C’est ce martyre de l’Europe que nous voulions retarder, limiter dans la mesure où ce serait encore possible. Nos garçons mourraient par milliers pour contenir ces [182] horreurs, permettre aux fuyards de courir dans notre dos vers les havres d’un Ouest de plus en plus rétréci. Quand on reproche à Hitler d’avoir maintenu si longtemps le combat, on ne se rend pas compte que, sans sa volonté forcenée, sans ses ordres draconiens de résistance sur place, sans les exécutions et les pendaisons des généraux qui reculaient et des soldats qui s’enfuyaient, des dizaines de millions d’Européens de l’Ouest eussent, eux aussi, été atteints, submergés, et connaîtraient aujourd’hui l’étouffante servitude des Baltes, des Polonais, des Hongrois, des Tchèques. Immolant les restes de son armée dans un corps à corps désespéré, à un soldat contre cent soldats, à un blindé contre cent blindés, Hitler, quelle qu’eût été sa responsabilité au départ de la Deuxième Guerre mondiale, sauvait, a sauvé, des millions d’Européens qui sans lui, sans son énergie, et sans tous nos pauvres morts n’eussent plus été – et pour longtemps – que des esclaves. Lorsque Hitler se fit sauter le cerveau, ce qui pouvait être sauvé était sauvé. Les colonnes gémissantes des derniers réfugiés avaient atteint la Bavière, l’Elbe, le Schleswig-Holstein. Alors seulement la fumée du cadavre d’Hitler monta sous les arbres déchiquetés de son jardin. Les armes se turent. La tragédie était terminée. A l’heure où la capitulation fut rendue publique, les derniers combattants ne formaient plus que des groupes isolés, coupés souvent de tout contact avec le commandement. Les quelques camarades qui m’entouraient ne voulaient, pas plus que moi, céder, se livrer. Un avion était abandonné dans notre secteur, le secteur norvégien [183] que nous avions atteint au bout d’un combat interminable tout au long de la Baltique, de l’Esthonie, au Danemark. Nous grappillâmes de l’essence, de-ci, de-là. Nous aurions deux mille trois cent kilomètres à franchir, si nous voulions atteindre un pays comme l’Espagne demeuré hors de la mêlée. Il nous restait une chance sur mille d’en sortir ? Sans doute ! Durant plus de deux mille kilomètres audessus de l’ennemi, de son artillerie antiaérienne, des bases de ses escadrilles de chasseurs, nous serions canardés cent fois. Mais nous préférions tout à la capitulation. Nous nous élançâmes dans les airs en pleine nuit, franchîmes l’Europe entière dans l’éblouissement des tirs alliés. Nous atteignîmes, à l’aube, le golfe de Gascogne. Nos moteurs renâclaient, suffoquaient, les réservoirs d’essence étaient épuisés. Allions-nous périr à quelques minutes de l’Espagne ? … Nous étions décidés, s’il le fallait, à atterrir n’importe comment ; si nous n’étions pas tués au sol, nous prendrions d’assaut n’importe quelle voiture. Dans la pétarade des six mitrailleuses que nous portions, nous eussions tout de même atteint probablement la frontière. Mais non, l’avion se maintenait toujours. Nous pûmes le redresser une dernière fois, faire tomber sur les deux moteurs les derniers décilitres d’essence qui restaient au bout des réservoirs. Nous nous rejetâmes dans le vide. Nous n’eûmes plus le temps de rien voir. Nous rasions des toits roses, nous piquions vers une rade claire. Puis un énorme rocher se dressa devant nos yeux. Trop tard ! Nous fîmes frein, à trois cent kilomètres à l’heure, avec la coque même de l’appareil. Un moteur explosa comme fétu. Déjà l’avion [184] avait bifurqué, pris de folie, il courait dans les flots, il s’y abîmait. En face de nous, au bout des eaux luisantes, San Sebastian s’éveillait. Du haut de la digue, deux guardias civiles agitaient l’éventail noir de toile cirée de leur képi. L’eau avait envahi l’avion brisé, jusqu’à vint centimètres du toit, juste assez pour nous laisser encore respirer. Nous étions tous en capilotade, os rompus, chairs déchirées. Mais nul n’était mort, ni même mourant. Des pirogues approchaient, nous recueillaient, abordaient la plage. Une ambulance m’emmenait. Je passerais quinze mois, grand blessé, à l’Hôpital militaire Mola. Ma vie politique était finie. Ma vie de guerrier était finie. Celle, ingrate entre toutes, d’exilé traqué, haï, commençait. Chapitre XI Les exilés [185] Meine liebe Degrelle… C’est Himmler qui s’adressait à moi. Nous étions enfoncés, en pleine nuit du 2 mai 1945, dans la gadoue d’un camp ténébreux. A cinq cent mètres devant nous, un millier d’avions alliés achevaient d’anéantir la ville de Kiel. Tout sautait par paquets clairs comme du métal en fusion, rendant plus noire encore la nuit dans laquelle nous nous recroquevillions. Meine liebe Degrelle, vous devez survivre. Tout changera vite. Vous devez gagner six mois. Six mois… Il me fixait de ses petits yeux fureteurs, derrière ses bésicles qui luisaient à chaque gerbe des explosions. Sa face ronde, d’une pâleur lunaire normalement, était devenue blafarde dans ces dégringolades de fin du monde. Quelques heures plus tôt, à la fin de l’après-midi, nous avions perdu Lübeck. Talonnés par les chars anglais et mitraillés par les Tipfligers, nous refluions sur la grand-route du Danemark, lorsque j’avais vu débouler Himmler débouler d’un chemin de campagne, dans une grosse voiture noire. Déjà, peu avant, j’étais tombé nez à nez avec Speer, l’ancien ministre des Armements, architecte extraordinaire et le plus gentil garçon du monde. Lui, dans ce déluge de feu, restait, comme toujours, d’un [186] naturel gai. Nous avions blagué ensemble un instant. Himmler était survenu. Lui ne blaguait pas souvent. En tout cas, lorsqu’il le faisait, c’était toujours avec application. Dans ce crépuscule du 2 mai 1945 – Hitler était mort depuis cinquante heures et l’avait laissé hors de toute succession -, Himmler avait une tête plus austère que jamais, terne, luisante sous quatre cheveux maigres. Il avait tenté de me sourire, entre ses dents qu’il avait petites, des dents de rongeur sous lesquelles, déjà, était cachée la petite gousse de cyanure de potassium qui le foudroierait quelques jours plus tard. J’étais grimpé dans la bagnole près de lui. Nous avions fait halte dans la cour d’une ferme. Il m’avait annoncé que j’étais devenu général depuis quelques jours. Général, caporal, cela n’importait plus guère ! Le monde nous tombait sur le râble. Bientôt nous serions tous sans uniformes et sans épaulettes. Et même morts, pour la plupart. Nous avions repris ensemble, dès la nuit, la route du grand port de Kiel. Quand nous allions y pénétrer, l’aviation des Alliés nous avait offert le feu d’artifice prodigieux du dernier anéantissement. Tout Kiel sautait, grillait. Sur notre route, les bombes dégringolaient comme des noix, explosaient ou ricochaient. Nous n’avions eu que le temps de sauter dans un champ marécageux. Une des deux secrétaires d’Himmler, une longue fille ingrate, avait aussitôt perdu dans la glu ses deux souliers à hauts talons. Perchée sur un de ses mollets, qu’elle avait osseux et grêles, elle farfouillait dans la vase noire, cherchant en vain à repêcher ses chaussures et se lamentant. Chacun a ses préoccupations. Himmler continuait avec les siennes. Mein liebe[187] Degrelle, six mois, six mois… Je l’avais heurté souvent pas mon intransigeance. Homme intellectuellement médiocre, il eût fait un instituteur appliqué, en des temps normaux. Les vues européennes le dépassaient. Mais, enfin, il s’était habitué à mes points de vue et à mes manières. A ce moment où notre univers s’écroulait, il lui importait que je survécusse. Déjà, le 21 avril 1945, après l’Oder, il m’avait demandé d’être le ministre des Affaires étrangères du gouvernement qui succéderait à l’équipe d’Hitler. Il m’avait, ensuite, envoyé le général Steiner pour décrocher mon assentiment. J’avais cru à une plaisanterie. J’étais le dernier à pouvoir traiter, comme ministre des Affaires étrangères, avec des Alliés qui tous me guettaient, pour me pendre à toute vitesse ! Empêtré dans la gadoue, Himmler répétait, tenace : Tout aura changé dans six mois ! Finalement, je lui répondis, fixant, sous l’éclair des explosions, ses petits yeux fatigués : Pas dans six mois, Reichführer, dans six ans ! J’aurais dû dire : dans soixante ans ! Et, maintenant, je crois même que dans soixante ans, les chances, pour moi, d’une résurrection politique quelconque seront encore plus minces ! La seule résurrection qui m’attende désormais sera celle du Jugement Dernier, à grands coups de trompettes apocalyptiques ! L’exilé a, naturellement tendance à croire que ses chances vont réapparaître. Il guette l’horizon. Le moindre symptôme de modification dans son pays perdu revêt à ses yeux une importance capitale. Une élection, un incident de presse sans intérêt le mettent en effervescence. Tout va changer ! Rien ne change. Les mois passent, les années passent. Au début, l’exilé de marque était re[188]-connu. On le regardait où qu’il allât. Cent personnes aujourd’hui le coudoient, indifférents : la bonne grosse femme qui le heurte pense à ses poireaux à acheter ; l’homme, trop lent devant lui, reluque les passantes ; le gamin qui court lui cognant les tibias n’a pas la moindre idée de ce qu’il est et, surtout, de ce qu’il fut. Il n’est plus qu’un inconnu dans le tas. La vie a passé, a tout lavé, l’existence du proscrit est devenu sans couleur, comme le reste. En mais 1945, quand je me retrouvai sur un petit lit de fer à l’hôpital de Saint-Sébastien, plâtré depuis le cou jusqu’au pied gauche, j’étais encore une vedette. Le gros gouverneur militaire s’était amené, tapissé de grands cordons, s’épandant en abrazos bruyants ! Il n’avait pas encore bien saisi que j’étais tombé du mauvais côté et que je n’étais plus à fréquenter. Il le comprendrait vite ! Tous le comprendraient vite ! Au bout de quinze mois, quand mes os auraient été ressoudés, je me retrouverais, une nuit, bien loin de là, dans une rue noire, guidé vers un gîte secret. La seule solution pour moi, la seule survie, alors qu’on réclamait de toutes parts mon extradition, - douze balles dans la peau ! – était le trou de l’oubli. Je passerais deux années dans un premier trou de l’oubli. J’en connaîtrais bien d’autres ! On m’avait installé dans une chambrette sombre, colée à un ascenseur de service. Je ne pouvais voir personne. Je ne pouvais jamais m’approcher d’une fenêtre. Les volets restaient toujours baissés. Les deux vieillards qui m’hébergeaient constituaient mon seul univers. Lui, pesait dans les cent cinquante kilos. La première chose que j’apercevais le matin était, [189] dans le couloir, son seau d’urine. Il en produisait quatre litres en une nuit. Travail intensif. Son unique travail. Dès avant le repas de midi, il se remettait en pyjama, un pyjama gigantesque, ouvert, béant, sur un grand triangle de chair pâle. Elle, trottait sous un paquet de cheveux rares, jaunes et hirsutes, naviguant dans le noir de sa maison – la lumière brûle ! – sur deux vieilles loques – les souliers usent ! Le soir, ils écoutaient tous deux, installés dans des fauteuils d’osier, une pièce de théâtre à la radio. Au bout de cinq minutes, ils dormaient, lui, expectorant des grognements profonds vers l’avant, elle, la tête rejetée en arrière, émettant des sifflements stridents. A une heure du matin, le silence de la fin de l’émission les réveillait. Elle prenait alors la cage à oiseaux ; lui, une grande statue peinturlurée de saint Joseph brandissant une palme verte. Ils se mettaient en route à petit pas vers leur chambre à coucher. Les ronflements recommençaient. Le matin, je retrouvais devant la porte les quatre litres d’urine. Telle serait ma vie durant deux ans : la solitude, le silence, l’ombre, deux vieillards qui remplissaient un seau à pleins bords, portaient saint Joseph et deux perruches. Je ne verras pas un sourire une seule fois. Ni deux jambes gracieuses sur un trottoir. Ni même un arbre découpant quelques feuilles jaunies sur le ciel. Après, j’ai bien dû sortir. Ma blessure à l’estomac – cadeau du Caucase – s’était crevée d’un bout à l’autre. En six mois, j’avais perdu trente-deux kilos. Dans une clinique discrète, on m’avait ouvert le ventre, de l’oesophage jusqu’au nombril, sur dix-sept centimètres. [190] J’avais été reconnue au bout de trois jours par un infirmier. Il avait fallu m’emporte en pleine nuit sur une civière. On m’avait hissé par un escalier étroit jusqu’à un quatrième étage. Je ruisselais de sueur et de sang, car, sous les contorsions du brancard, tous les points de suture avaient sauté ! Quelle vie ! Ne pas se montrer – pour ne pas être reconnu – ne sert à rien. On vous reconnaît tout de même, on vous voit tout de même, même si vous êtes à dix mille kilomètres de là. Je possède un dossier vraiment cocasse sur mes séjours dans vingt pays différents. Ce jour-là un journaliste m’avait découvert à Lima ! Un autre jour, c’était à Panama ! Ou dans la pampa argentine ! Ou dans une villa proche du Nil, chez le colonel Nasser ! Chaque fois, les détails étaient tellement précis que je finissais par me demander si je n’étais pas là vraiment, si je ne me trompais pas. un grand journal français apporta, sous un énorme titre de première page, des précisions absolument complètes sur ma vie au Brésil, sur ma façon de m’habiller, de manger, de parler. En vrai reporter parisien, l’auteur s’étendait longuement, bien entendu, sur mes amours ! Oui, j’aimais ! J’aimais une négresse ! Et j’en avais même eu un beau petit négrillon ! Le lecteur, malgré tout, doutait ? Douter ? Mais la photo est là ! La photo de mon fils, le petit nègre, un moutard de trois ou quatre ans, l’oeil rond, des mèches de cheveux crépus s’étendant sur son crâne comme un tapis de mousse ! Ma belle-mère, sainte dame du Périgord, sursauta, au petit déjeuner, en lisant ces révélations assez inattendues dans son quotidien habituel ! Ce petit-fils de la main gauche ne lui plaisait vraiment pas du tout. J’eus bien de la peine à lui faire savoir que je n’avais jamais, de ma vie, mis les [191] pieds au Brésil, qu’aucun négrillon n’était entré dans la famille. N’importe. Trente fois, cinquante fois, il m’a fallu apprendre que j’étais à Caracas, à Valparaiso, à Cubaoù un pauvre diable fut mis en tôle à ma place ! – et même dans les soutes du navire Monte Ayala, arraisonné en haute mer par les Américains, à la fin du mois d’août 1946 – donc quinze mois après la guerre ! – et ramené au port de Lisbonne, où il fut fouillé de fond en comble pendant plusieurs jours : un policier américain remonta même la cheminée du bas en haut pour voir si je n’étais pas agrippé dans la suie ! Un rapport d’un service secret me décrivait pénétrant dans un bois avec un colonel portugais ! L’Intelligence Service m’avait repéré à Gibraltar ! D’autres journalistes m’avaient suivi au Vatican ! D’autres, dans un port de l’Atlantique, où j’achetais des canons ! On me vit même à Anvers, où, paraît-il, j’étais allé respirer l’air du pays. De temps en temps, c’est vrai, j’étais découvert par un ahuri ou par un fidèle qui me tombait dans les bras en pleurant. J’en étais quitte pour reprendre mes cliques et mes claques et de filer ailleurs. J’ai rencontré parfois aussi des ennemis. Ce fut toujours drôle. Ils avaient réclamé ma tête à cor et à cri, et brusquement ils étaient devant moi. Stupéfaction d’abord. La curiosité l’emportait. En deux mots amusants, l’atmosphère se dégageait. J’ai même eu, un jour, la surprise de me trouver assis, dans un petit restaurant populaire, à côté d’un des chefs les plus en vue du parti socialiste belge, un Liégeois. Je n’avais pas fait attention. Lui non plus. Il était attablé [192] avec une grande fille blonde carrossée comme une Mercury. Je lisais ma gazette. Je relevai le nez, croisai son regard. Il fut, une seconde, abasourdi. Puis il sourit, me fit un clin d’oeil. Lui non plus ne me conduirait pas au gibet ! Les seuls qui me traquèrent, partout,, avec une haine vraiment diabolique, furent les Juifs. Le gouvernement belge, bien sûr, me poursuivit longtemps avec hargne. Il réclama vingt fois mon extradition. Mais, tout de même, Spaak, le ministre des Affaires étrangères, n’osait pas aller trop fort. Il n’était pas droit dans ses bottes. Il avait tout fait, en juin et en juillet 1940, pour obtenir des Allemands de pouvoir rentrer dans le Bruxelles de l’Occupation. Il les avait bombardés de télégrammes, mettant en branle, à travers l’Europe, toutes ses relations. J’étais très au courant de ces manoeuvres. Son copain et Président, l’ex-ministre socialiste de Man, m’avait même communiqué les lettres que Spaak écrivait, à Bruxelles, à sa femme, pour qu’il lui fît obtenir d’Hitler l’autorisation de rappliquer. Henri de Man a toujours eu un faible pour toi ! écrivait Spaak à son épouse pour l’exciter à aller trouver ledit Henri, qui, l’oeil sardonique, s’esclaffait en lisant à ma table ces propos ! Hitler n’accepta pas la demande de Spaak, dix fois répétée. C’est pourquoi Spaak fila à Londres. Mais sans l’opposition d’Hitler, il fût bel et bien entré dans le système, comme de Man y était entré, dès le mois de mai 1940. Quant aux Juifs c’est une toute autre affaire. Jamais [193] REX, avant la guerre, n’avait été vraiment antisémite. Les manoeuvres bellicistes des Juifs m’indignaient, c’est vrai. C’est vrai aussi que je ne les porte pas spécialement dans mon coeur. Ils me tapent sur le tempérament. Mais je les laissais plutôt tranquilles. A REX, ils pouvaient faire partie du mouvement comme n’importe qui. Le chef de REXBruxelles, lors de notre victoire de 1936, était un Juif. Même en 1942, en pleine occupation allemande, le secrétaire de mon remplaçant, Victor Mattys, était juif. Il s’appelait Kahn, c’est tout dire ! Des camps de concentration, des fours crématoires, j’avais tout ignoré. N’empêche que les Juifs se sont mis dans la tête, après la guerre, qu'un grand mouvement antisémite avait été reconstitué à travers le monde, et que j’en étais le chef. D’abord, je n’en étais pas le chef. Ensuite, que ce soit regrettable ou non, il n’existait pas. Donc pas question de persécutions ni d’organisations antijuives. Voilà vingt-cinq ans que les chrétiens se tiennent peinards. N’empêche que, pour décapiter, en me liquidant, une organisation absolument inexistante, des dirigeants juif, du plus haut niveau, appartenant notamment à la direction de la Sûreté générale de l’Etat d’Israël, ont monté contre moi expéditions de rapt sur expéditions de rapt. Rien ne manquait : la grande Lincoln noire au bac arrière reconverti en une sorte de cercueil à narcotique, dans lequel on me transporterai inconscient ; le bateau qui m’attendait à la côte proche, pour me conduire à [194] Tel Aviv ; cinq revolvers pour me trucider si je résistais ; six millions pour payer les complices ; les plans complets de mon logis et de ses accès. La nuit précédentes, les lignes téléphoniques et électriques avaient été coupées sur ma colline, les chiens des propriétés voisines avaient été empoisonnés. Il s’en fallut de peu, par un juillet brûlant de soleil, que je n’y passasse. Les agresseurs israéliens, conduits par un Juif très connu, le journaliste Zwij Aldouby, se firent cueillir, armés jusqu’aux dents, alors qu’ils étaient sur le point de réussir. Ils furent condamnés à huit, dix et douze ans de prison. Une autre opération fut montée, presque simultanément, au moyen d’un hélicoptère, au départ d’un port marocain. Quelques années plus tard, un nouveau rapt-assassinat fut tenté. Cette fois, les agresseurs juifs étaient arrivés par mer, venant d’Anvers. Ce fut une Juive même qui informa du complot une de mes soeurs, voulant me remercier, dit-elle, de lui avoir sauvé la vie pendant la guerre. A cette époque-là, j’ai, comme tout le monde l’eût fait, essayé de sauver tous les gens dont j’avais su qu’il étaient inquiétés. Mais je ne dressais pas de listes pour l’aprèsguerre ! Si bien que je ne me souviens même pas de cette Juive que je sauvai alors et qui me sauva par la suite ! Son avertissement tomba à pic, les trois expéditionnaires se firent coffrer, à peine débarqués. Mais c’est râlant. Chaque fois, il me fallait déménager, plonger dans des propriétés campagnardes de vieux amis, voire dans une brasserie ou, pour de longs mois, dans une cellule, pas rigolote je vous prie de le croire, d’un cloître bénédictin. Je me souviendrai longtemps des Benedi[195]-camus Domino hurlés à cinq heures du matin par le réveilleur de service ! Mais décamper sans cesse, veut dire aussi impossibilité de gagner sa croûte, d’avoir une occupation fixe où que ce soit, ou simplement d’avoir un toit, si l’on est toujours menacé et si l’on doit toujours filer ailleurs. Les interviews des journalistes n’ont pas manqué, elles aussi, de compliquer ma vie de proscrit, en rappelant souvent et intempestivement l’attention sur mon nom. De ces interviews, on en a publié des dizaines, toutes inventées comme des romans policiers. Deux fois, il y a bien longtemps, j’ai reçu dans mon refuges des « envoyés spéciaux » qui ont ensuite présenté mes déclarations tout à fait de travers, alors qu’ils m’avaient promis, bien sûr, de m’envoyer les textes pour accord préalable ! J’ai fui, depuis lors, les journalistes comme la peste ! On est toujours refait par eux car leur objectif est différent : ils cherchent du sensationnel, à publier rapidement. Mais la vérité ne s’expose pas sous des titres d’une main de haut, à une telle vitesse. Une seule fois, une revue a publié une véritable interview de moi. Elle le désirait. Je désirais, moi, faire croire à ce moment-là que j’étais à Buenos Aires dans une clinique. Le texte parut dans son intégralité. La revue savait parfaitement [196] que nul reporter de son équipe ne m’avait vu, et que je n’étais à Buenos Aiers en aucune façon. Que lui importait ? Le principal, c’est que le public pousse des oh ! et des ah ! tout au long de la lecture ! On lui explique bien ce que M. Onassis et l’ex-Mme Kennedy font dans leur lit, et l’état des ovaires, avec dessins à l’appui, de la reine Fabiola, alors que nul, dans ces rédactions, n’est valet de chambre ou infirmier de service ! Quand le journaliste se déplace, c’est parce qu’il veut s’aérer aux frais de la princesse et dresser des frais de route nettement encourageants. Il hume un peu l’air, rend hommage aux beautés peu farouches du cru, puis rédige sa copie à toute vitesse et à la diable. Il ne reste plus qu’à toucher les « piges ». Mais, l’exilé, lui, comment voit-il le public ? Lui aussi, avec le temps, ne va plus imaginer qu’un public irréel, inexistant. Il lui prête une façon de penser qu’il n’a pas, qu’il n’a plus. Il a perdu le fil de l’évolution. Tout change, et il ne sait pas que tout a changé. Le monde n’est plus comme il l’était, les gens ne sont plus comme il les a connus. Comme n’importe quel vieil industriel dépassé par la vie moderne, il devrait se réadapter. Il continue à croire que les méthodes de jadis sont toujours valables, qu’on se passionne encore pour elles, et surtout pour lui. A qui s’intéresse-t-on encore au bout de quelques années ? Les gens s’éclipsent. Les événements se succèdent. Chacun d’entre nous projette le précédent dans la fosse de l’oubli. l’exilé reste convaincu qu’il est encore sur l’estrade de l’actualité. Or, le rideau a été baissé depuis longtemps. Il attend que renaissent les applaudissements, comme si le public était toujours devant sa [197] tribune, ne se rendant pas compte que les années l’ont poussé dans les coulisses. Ce quiproquo est souvent pénible. Qui va dire à un exilé qu’il ne compte plus ? Il ne se rend pas compte. Surtout, il ne veut pas s’en rendre compte. Son sourire est souvent contracté, mais c’est sa dernière façon de se convaincre que l’avenir ne lui est pas bouché de façon définitive… Moi aussi, longtemps, j’ai cru à la survie. J’étais en pleine jeunesse. A trente-huit ans, je n’allais pas disparaître ainsi, à jamais, tout de même ! Eh bien ! si, on disparaît ! Les amis meurent au loin, l’un après l’autre. Le passé devient flou, comme un rivage qui se dilue puis, finalement, disparaît aux regards des navigateurs. Pour un garçon de vingt ans, qui n’était pas né quand nous avons sombré, qui sommes-nous ? … Il emmêle tout. Ou il ne sait même plus rien de nos histoires, qui ne le passionnent pas plus que les moustaches rugueuses de Vercingétorix ou les dents cariées de Louis XIV. Ce n’est pas tout : il y a de la bousculade dans le métier. Les exilés se succèdent, s’empilent les uns sur les autres. Déjà les Peron, les Trujillo, les Batista, les abbés Fulbert Youlou, vaincus bien après nous, ne sont plus que des silhouettes, à peine décelables. Les noms des Lagaillarde, des Ortiz, et même des Bidault et des Soustelle, les deux dernières vedettes politiques de l’affaire d’Algérie ne disent plus rien, au bout de cinq ans, à 90% des Français. Nous sommes au siècle de la vitesse. Pour disparaître du champ visuel du public, aussi, ça va vite. [198] Même pour des gens très informés, un homme politique exilé depuis vingt-cinq ans est devenu un être presque irréel. Ils le croient disparu. Ou ils ne croient plus qu’il existe encore. Un soir, j’étais invité à dîner chez une sommité médicale, connue universellement, et très proche du chef de l’Etat dans lequel je résidais à ce moment-là. Des personnages très en vue entraient. Chacun de ces incités m’avait connu à diverses étapes de mon exil, et sous des noms différents. Pour l’un, j’avait été Enrique Duran, polonais (un drôle de nom polonais !) Pour l’autre, Lucien Demeure, français. Pour l’autre Juan Sanchiz. Pour d’autres, Pepe, sans plus. J’étais las de déployer, à chaque pognée de main, cette panoplie de faux noms. Lorsque entra un gros banquier que je n’avais jamais rencontré, je n’hésitais plus et me présentai sous mon vrai nom : Léon Degrelle ! L’autre me regarda, amusé. – Et moi, Bénito Mussolini ! Je dus suer avant de le convaincre que j’étais bien qui j’étais, et que je ne lui avais pas monté une blague ! Ainsi, avec le temps, l’exilé glisse dans le vague ou dans l’oubli. Il est passé des Mercedes du pouvoir au métro malodorant de l’exil. Il faut du temps aux plus lucides pour se faire une raison. L’exilé préfère s’accrocher. Il a cru à quelque chose qui fut, à un moment de sa vie, exceptionnel. Il souffre horriblement d’être passé de cet exceptionnel à l’ordinaire, au restaurant banal à prix fixe, au linge de quatre sous. Le grand rêve disloqué, désintégré, le travaille. Il se reprend souvent [199] à croire que, tout de même, on ne sait jamais, quelque chose pourrait rejaillir. Quelque chose, oui. Mais nous, non. Nous, c’est fini. Autant s’en rendre compte virilement et dresser le bilan. Les fascismes ont marqué leur temps, et l’avenir au-delà de leur temps. C’est cela qui compte. Qu’ont-ils laissé ? Qu’ont-ils changé ? Indépendamment de nos vies personnelles, si bruyantes de dynamisme jadis, éliminées désormais, le vrai problème qui se pose est celui-là : de cette grande Aventure – ou Epopée – des fascismes, une fois les tombeaux clos, que reste-t-il ? et que restera-t-il ? Chapitre XII Et si Hitler avait gagné ? C’est la grande question : - Si Hitler avait gagné ? Mettons, puisque ce fut longtemps possible qu’un tel événement fût arrivé. En octobre 1941, Hitler fut bien près de conquérir Moscou (il en atteignit les faubourgs) et de border le fleuve Volga, depuis sa source (il y était arrivé) jusqu’à son embouchure (elle était à sa portée). Moscou n’attendait que l’apparition des chars du Reich sur la place du Kremlin pour se révolter. Staline eût sauté. C’eût été fini. Quelques colonnes allemandes d’occupation, à l’instar de celles de l’amiral Koltchak en 1919, eussent promptement traversé la Sibérie ou y eussent été parachutées. Face à l’océan Pacifique, la croix gammée eût flottée à Vladivostok, à dix mille kilomètres du Rhin. Quelles eussent été les réactions dans le monde ? L’Angleterre de la fin de 1941 pouvait laisser tomber les bras n’importe quand. Il eût suffi qu’un soir de whisky trop abondant, Churchill s’écroulât dans un fauteuil, bavant, frappé d’apoplexie. Que ce buveur invétéré se soit conservé si longtemps dans l’alcool est un cas pour médecins. Son médecin personnel a, d’ailleurs [202] publié, après sa mort, des détails très cocasses sur la résistance bachique de son illustre client. Mais, même vivant, Churchill dépendait de l’humeur de son public. Le public anglais essayait encore, 1941, de tenir le coup. Mais il était las. La conquête de la Russie par Hitler, dégageant toute la Luftwaffe, eût achevé de l’écraser. Cette guerre, à quoi le conduisait-elle ? A quoi, d’ailleurs, l’a-t-elle conduit ? L’Angleterre a terminé la guerre toute nue, privée de la totalité de son Empire et ramenée, mondialement, au rang d’Etat secondaire, à la fin de ses cinq années de strip-tease. Un Chamberlain à la place de Churchill eût, depuis longtemps, piqué un drapeau blanc au bout de son parapluie. De toute façon, seule en face d’une Allemagne victorieuse – étendant un Empire, sans égal au monde et gorgé de tout, sur dix mille kilomètres de largeur, des îles anglo-normandes de la mer du Nord aux îles Sakhaline dans le Pacifique - , l’Angleterre n’eût pu été qu’un radeau crevé par la tornade. Elle ne pourrait résister longtemps sur les vagues. Churchill se lasserait – et les Anglais avant lui – de vider des seaux d’eau, sans arrêt, d’une coque de plus en plus envahie. Se réfugier plus loin ? Au Canada ? Churchill, bouteille au flanc, y fût devenu trappeur ou bistroquet, mais non sauveur. En Afrique ? Aux Indes ? L’Empire britannique était déjà perdu. Il ne pouvait être le dernier tremplin d’une résistance qui n’avait plus de sens. On n’eût même plus jamais parlé de De Gaulle, devenu professeur à Ottawa, relisant Saint-Simon à la veillée ou tenant entre ses mains l’écheveau de laine à tricoter de la laborieuse Tante Yvonne. La victoire anglaise fut vraiment le coup de pot d’un [203] vieillard têtu fonctionnant à l’alcool, éperdument accroché à un mât fendu, aux craquements sinistres, et pour qui les dieux des pochards eurent d’exceptionnelles indulgences. N’importe ! Une fois l’U.R.S.S. dans les mains d’Hitler, à l’automne de 1941, la résistance anglaise eût fait long feu, sans Churchill ou avec Churchill. Quant aux Américains, ils n’étaient pas encore entrés en guerre à cette époque-là. Le Japon les guettait, se préparait à leur sauter dessus. Hitler, une fois l’Europe à lui, n’avait pas plus à se mêler du Japon que le Japon, en juin 1941, ne s’était mêlé de l’offensive allemande en U.R.S.S. Les Etats-Unis, occupés en Asie pour longtemps, ne se fussent pas mis une guerre de plus sur le dos, en Europe. Le conflit militaire Etats-Unis-Hitler n’aurait pas eu lieu, en dépit des démangeaisons bellicistes du vieux Roosevelt, verdi, cadavérique dans sa cape de cocher de fiacre, malgré les excitations de son épouse Eléonore, toutes dents dehors, des dents saillantes en dos d’ânes, pareilles à des crocs de caterpillar. Mettons donc qu’à la fin de l’automne 1941 – il en fut à un quart d’heure de tram – Hitler eût été installé au Kremlin, comme il s’était installé à Vienne en 1937, à Prague en 1939, et dans le wagon de l’armistice à Compiègne en 1940. Quid ? Que se serait-il passé en Europe ? Hitler eût unifié l’Europe par la force, c’est hors de doute. Tout ce qui s’est fait de grand dans le monde, s’est fait par la force. C’est regrettable, dira-t-on. Il serait [204] certes plus décent que le brave populo, les dames patronnesses de la Paroisse et les Vestales impavides de l’Armée du Salut nous rassemblent démocratiquement en de paisibles unités territoriales, sentant le chocolat, le mimosa et l’eau bénite. Mais jamais cela ne se passa ainsi. Les Capet n’ont pas taillé le Royaume de France à coups d’élections au suffrage universel. A part l’une ou l’autre province déposée dans le lit royal, en même temps que sa robe de nuit, par une jeune épouse trémoussante, le reste du territoire français s’enleva à l’escopette ou à la bombarde. Dans le Nord, conquis par les Armées royales, les habitants se firent chasser de leurs villes – Arras notamment – comme des rats. Au Sud, dans l’Albigeois résistant à Louis VIII, les Cathares, battus, crossés, rossés par les Croisés de la Couronne, furent grillés dans leurs châteaux forts, sorte de fours crématoires d’avant l’hitlérisme. Les protestants de Coligny se retrouvèrent au bout des piques de la Saint-Barthélémy, ou se balancèrent sous les cordes du gibet de Montfaucon. La Révolution des Marat et des Fouquier-Tinville préféra, pour asseoir son autorité, l’acier luisant de la guillotine et son panier de son, à des rasades de gros rouge aux électeurs du cru, au café du coin. Même Napoléon embrocha à la baïonnette chacune des frontières de son Empire. L’Espagne catholique n’invita pas les Maures à s’espagnoliser au rythme de ses castagnettes. Elle les étripa vigoureusement pendant les sept siècles de la Reconquête, jusqu’à ce que le dernier des Abencérages eût pris ses jambes à son cou et eût retrouvé les palmiers et les cocotiers des rives d’Afrique. Les Arabes n’avaient pas imaginé d’unifier plus aimablement, à leur profit, le Sud de l’Espagne, eux qui [205] clouaient les Espagnols résistants aux portes des villes, telle que Cordoue, entre un chien et un cochon crucifiés des deux côtés et vociférant avec indignation. Au siècle dernier, Bismarck forgea au canon l’unité allemande, à Sadowa et à Sedan. Garibaldi ne rassembla pas les terres italiennes le rosaire à la main, mais en prenant d’assaut la Rome pontificale. Les Etats d’Amérique eux-mêmes ne devinrent Unis qu’après l’extermination des anciens propriétaires, les Peaux-Rouges, et après quatre ans de tueries fort peu démocratiques au long de la guerre de Sécession. Et encore ! Vingt millions de Noirs vivent-ils, à cette heure, contre leur gré, sous la férule de millions de Blancs qui, au siècle dernier, continuaient à tatouer au fer rouge leurs pères et leurs mères, exactement comme s’ils eussent été des poulains ou des mules. En fait d’inscription sur les listes électorales, c’était assez rudimentaire. Ils ne votaient d’ailleurs même pas, une fois la ferrade finie ! Seuls, les Suisses ont constitué, plus ou moins pacifiquement, leur petit Etat de cafetiers, d’arbalétriers, de boniches et de laitiers. Mais, à part l’éclat de la pomme de Guillaume Tell, leurs dignes cantons n’ont guère brillé dans l’histoire de la politique universelle. Les grands Empires, les grands Etats, se sont tous constitués par la force ? C’est regrettable ? C’est un fait. Hitler, campant dans une Europe rétive, n’en eût certainement pas fait plus que César s’adjugeant les Gaules, que Louis XIV s’emparant de l’Artois et du Roussillon, que les Anglais conquérant l’Irlandais, les pillant, les persécutant, que les Américains braquant les canons de leurs croiseurs sur les Philippines, sur Porto Rico, sur Cuba, sur Panama et portant, à coups de roquettes, leurs [206] frontières militaires jusqu’au 37e parallèle vietnamien. La démocratie, c’est-à-dire le consentement électoral des peuples, ne vient après, quand tout est fini. Les foules voient l’univers à travers le trou de la serrure de leurs petites préoccupations personnelles. Jamais un Breton, un Flamand, un Catalan du Roussillon, n’eussent, d’eux-mêmes, oeuvré pour s’intégrer à une unité française. Le Badois prétendait mordicus rester Badois. Le Wurtembergeois, Wurtembergeois. Le père d’un de mes amis de Hambourg s’expatria aux Etats-Unis après 1870 plutôt que de se voir intégré à l’Empire de Guillaume 1er. Ce sont les élites qui font le monde. Et ce sont les forts qui, botte au train, poussent les faibles en avant. Sans eux, les peuples, émiettés, feraient sempiternellement du sur-place. En 1941, ou en 1942, même si la victoire d’Hitler en Europe eût été totale, irréversible, même si, comme disait Spaak, l’Allemagne eût été « maîtresse de l’Europe pour mille ans », les râleurs eussent fructifié par millions. Chacun se fût accroché à ses marottes, à son coin de pays, supérieur, évidemment, à tous les autres coins de pays ! Etudiant, j’écoutais toujours avec ahurissement mes camarades de Charleroi hurler par-dessus leurs caisses de bière : Pays de Charleroi C’est toi que je préfère ! Le plus beau coin de la terre Oui, c’est toi, oui, c’est toi ! [207] Or, c’est le plus laid coin de terre du monde, avec ses interminables corons aux briques noirâtres, sous les cent châteaux de ses terrils poussiéreux ! Même les fleurs y sont saupoudrées de charbon ! Pourtant, les yeux émerveillés, les copains carolorégiens braillaient leur enthousiasme ! Chacun est entiché de son patelin, de sa région, de son royaume, de sa république. Mais ce complexe européen du petit et du mesquin pouvait évoluer, était même en train d’évoluer. Une évolution accélérée n’avait rien d’irréalisable. La preuve avait été faite, à dix reprises, des possibilités d’unir des Européens très éloignés les uns des autres et qui, pourtant, sont fondamentalement les mêmes. Les cent mille Protestants français qui durent quitter leur pays après la révocation de l’Edit de Nantes, s’amalgamèrent merveilleusement aux Prussiens qui les recueillirent. Au cours de nos combats de février et de mars 19045,dans les villages de l’est et de l’ouest de l’Oder, nous voyions partout, sur les plaques des charrettes des paysans, d’admirables noms français sentant le terroir d’Anjou et de l’Aquitaine. Au front, abondaient les Von Dieu le veut, les Von Mezières, les de la Chevalerie. A l’inverse, des centaines de milliers de colons allemands se sont épandus, au long de plusieurs siècles, à travers les pays baltes, en Hongrie, en Roumanie, et même – à cent cinquante mille ! – le long de la Volga. Les Flamands, descendus en très grands nombre dans le Nord de la France, ont donné à [208] celle-ci ses élites industrielles les plus tenaces. Les bienfaits de ces cohabitations ont été aussi sensibles dans l’espace dit latin. Les Espagnols de Gauche, qui n’eurent d’autre ressource que de se réfugier en France après leur débâcle de 1939, se sont, en une génération, confondus avec les Français qui les accueillirent : une Maria Casarès, fille d’un Premier ministre du Frente Popular, est devenue une des actrices les plus admirées du Théâtre-Français ! Les centaines de milliers d’Italiens poussés en France par la faim, au cours du siècle dernier, se sont, eux aussi, assimilés avec une facilité extrême. A tel point qu’un des plus grands écrivains de la France du siècle dernier fut un fils de Vénitien : Zola. A notre époque, les écrivains fils d’Italiens sont légion, Giono en tête. L’empire napoléonien, lui aussi, avait rassemblé les Européens sans trop leur demander leur avis. Pourtant, on avait bu comment leurs élites s’étaient rejointes avec une rapidité extraordinaire : l’Allemand Goethe était chevalier de la Légion d’honneur ; le prince polonais Poniatowski était devenu maréchal de France ; Goya pourvoyait en maîtres espagnols le Musée du Louvre ; Napoléon se proclamait, sur ses monnaies, Rex Italicus. Les grognards, recrutés dans dix pays différents de l’Europe, s’étaient frottés les uns aux autres, avaient fraternisé, exactement comme nous le ferions à notre tour dans les rangs de la Waffen S.S. au cours de la Deuxième guerre mondiale. Mais chaque fois, ou la persécution, ou la guerre, ou la nécessité de gagner son [209] pain, ou la volonté de l’homme fort, avaient dû donner le coup de pouce. Normalement, les peuples d’Europe s’en tenaient à la cuvette de leurs frontières. Ils ne la dépassaient – et chaque fois avec succès – que lorsqu’on les poussait dehors. Ces expériences fécondes, échelonnées dans le temps, unissant les Européens les plus divers, provenant aussi bien de la Prusse que de l’Aquitaine, de la Flandre que de l’Andalousie ou de la Sicile, pouvaient parfaitement se renouveler, s’accumuler et s’amplifier. Gagnée, perdue, la Deuxième Guerre mondiale allait donner le grand démarrage. Elle avait obligé tous les Européens et notamment les adversaires qui paraissaient les plus irréductibles, les Français et les Allemands, à se côtoyer. Même s’ils se détestaient, même s’ils ne rêvaient qu’à s’envoyer des ruades dans les tibias, il durent bien apprendre, bon gré mal gré, à se connaître. Ces quatre années à se taper dessus, ou à cohabiter vaille que vaille, à chercher à se comprendre, à se déchiffre parce qu’il le fallait bien, ne seraient pas vaines. Tous avaient dû faire du face à face, vainqueurs ou vaincu. Nul n’oublierait la tête de l’autre. Les mauvais moments s’estomperaient. On se souviendrait, ensuite, de ce qui comptait. La confrontation des peuples européens avait été faite. Durant les vingt-cinq années qui ont suivi cet affrontement, d’autres affrontements ont eu lieu à la cadence et à la vitesse de notre époque. Des dizaines de millions d’Européens voyagent désormais. L’étranger n’est plus un être qu’on regarde avec crainte ou avec haine, ou en s’en moquant. On fraie avec lui. Le Bressan ne voit plus uniquement l’univers à travers ses fromages bleus et ses [210] poules baguées. Le Normand a dépassé sa cidrerie, et le Belge son pot de gueuze-lambic. Des milliers de Suédois vivent à la côte de Malaga. Michelin, malgré ses pinces à bicyclette, s’accouple avec l’Italien Agnelli, et l’Allemand Gunther Sachs a pu épouser, sans que la République s’écroulât, une actrice « made in Paris ». Même le général de Gaulle trouve de bon ton de découvrir au Français qu’il a dans les veines du sang allemand, grâce à un grand-oncle dévoreur de choucroute, né au pays que rendirent si populaire les Nazis ! Les jeunes n’ont même plus de pays, souvent. Ils se sentent dénationalisés. Ils se sont créé un monde à eux, d’idées audacieuses ou biscornues, de disques trépidants, de poils tombants, de pantalons râpés, de chemises voyantes, de filles ouvertes largement à la confusion des nationalités ! Le petit Coq français de 1914 et le gros Aigle noir planant sur la ville ont cessé de lancer leurs cocoricos ou de glapir. Leurs plumes, leur bec, leur fumier et leur vol plané apparaissent déjà, à la génération nouvelle, comme d’étranges pièces préhistoriques pour musées qui ne seront même pas visités. Ce rapprochement européen, et même mondial, qui a submergé, en un quart de siècle, des siècles de passé, s’est opéré sans stimulant politique, rien qu’à circuler par millions d’un pays à l’autre, à regarder par millions, au cinéma ou à la télévision, d’autres paysages et d’au[233]-tres visages. Les moeurs se sont mêlées aussi naturellement que, dans un cocktail, se lient les ingrédients les plus divers. Sous Hitler, certainement le processus d’unification se fût développé plus rapidement encore, et surtout moins anarchiquement. Une grande construction politique commune eût orienté et concentré toutes les tendances. D’abord, des millions de jeunes, non-Allemands comme Allemands, qui avaient lutté ensemble de la Vistule à la Volga, étaient devenus, dans les efforts et les souffrances subies en commun, des camarades à la vie et à la mort. Ils se connaissaient. Ils s’estimaient. Les petites rivalités européennes de jadis, marottes de bourgeois demeurés, nous apparaissaient dérisoires. Ce « nous » n’était, en 1945, qu’un noyau. Mais, au centre du plus gros fruit, se trouve un noyau, un principe. Nous étions ce noyau-là. L’Europe, masse pâteuse, ne l’avait jamais porté en elle. Maintenant il existait. Il contenait alors déjà l’avenir. A toute la jeunesse, un monde à créer serait offert par l’Europe sortie du génie et des armes. Les millions de jeunes Européens restés peinards, durant la guerre, à déguster les conserves de Papa et à faire des essais de marché noir, allaient être tentés à leur tour. Au lieu de végéter à Caudebec-en-Caux ou à Wuustwezel, penchés pendant cinquante ans sur des harengs saurs ou sur des pommes blettes, des millions de jeunes eussent eu, étalées devant leur dynamisme, les terres sans fin de l’Est, offertes à tous, qu’ils fussent de la Frise, de la Lozère, du Mecklembourg ou des Abruzzes. Là ils pourraient se tailler une vraie vie d’hommes, d’initiateurs, de créateurs, de chefs ! [212] Toute l’Europe eût été traversée par ce courant d’énergie. L’idéal qui avait, en si peu d’années, pris au coeur toute la jeunesse du Troisième Reich, parce qu’il signifiait l’audace, le don, l’honneur, la projection vers le grand, eût pris au coeur, exactement de la même manière, les jeunes de toute l’Europe. Finies, les vies médiocres ! Fini, l’horizon toujours gris et rétréci ! Finie, la vie collée au même patelin, au même turbin, au même râtelier du même logis médiocre, au panier de préjugés de parents stabilisés dans le petit et le moisi ! Un monde vibrant hélerait les jeunes à travers des milliers de kilomètres sans frontières, où on pourrait ouvrir ses poumons largement, avoir un appétit vorace, dévorer tout à pleines dents, conquérir tout à pleines mains, dans la joie et dans la foi ! Les vieux même eussent suivi, pour finir, car l’argent eût suivi. Au lieu de piétiner dans les conciliabules aigris, les dosages, les arrêts d’horloges bloquées afin de prolonger les débats, la volonté de fer d’un chef, les décisions des équipes responsables qui installeraient pour bâtir largement son oeuvre, eussent, en vingt ans, créé une Europe réelle, non un congrès hésitant de comparses rongés par la défiance et par des calculs cachés, mais une grande unité politique, sociale, économique, sans secteurs réservés. Il fallait entendre Hitler exposer, dans son baraquement de bois, ses grands projets d’avenir ! Des canaux [213] géants uniraient tous les grands fleuves européens, ouverts aux bateaux de tous, de la Seine à la Volga, de la Vistule au Danube. Des trains à deux étages – en bas les marchandises, en haut les voyageurs – sur des voies surélevées, de quatre mètres d’écartement, franchiraient commodément les immenses territoires de l’Est où les soldats de jadis auraient bâti les exploitations agricoles et les industries les plus modernes du monde. Que représentent les quelques concentrations interminablement discutées, boiteuses sur leurs jambes de bois, qui ont été tentées sous l’égide de l’actuel Marché commun, à côté des grands ensembles qu’une autorité réelle eût pu réaliser – imposer si c’eût été nécessaire -, à des forces économiques européennes jadis disparates, contradictoires, ou hostiles, se tirant dans les mollets, faisant double ou triple emploi, égoïstes et anarchistes ? La poigne d’un maître les eût ramenées rapidement à la loi de la coproduction intelligente et de l’intérêt commun. Le public pendant vingt ans eût grogné, renâclé. Mais, au bout d’une génération, l’unité eût été réalisée. L’Europe eût constitué à jamais le plus grand foyer d’intelligence créatrice. Les foules européennes eussent alors pu respirer. La discipline eût pu se détendre, une fois cette bataille de l’Europe gagnée. - L’Allemagne eût dévoré l’Europe ? Le danger existait. Pourquoi dire non ? Le même danger avait existé jadis. La France de Napoléon eût pu dévorer l’Europe. Personnellement, je ne le crois pas. Les divers génies européens, déjà sous l’Empereur, se fussent compensés. [214] La même ambition de domination guettait, incontestablement, l’Europe hitlérienne. Les Allemands sont de gros mangeurs. Certains considéraient l’Europe comme un plat à eux. Ils étaient capables de nombreux crocs-en-jambe, tendus avec fourberie. Mais oui, mais oui ! Nous nous en rendions compte. Nous le redoutions. Sinon, nous eussions été des nigauds ou, au moins, des naïfs, ce qui, en politique, ne vaut pas mieux. Nous prenions nos précautions, cherchant à saisir, le plus fermement possible, des positions de contrôle ou de prestige d’où nous pourrions nous défendre, tempêter, ou bloquer les frais. Il y avait des risques, c’est donc bien vrai. Le nier serait imbécile. Mais il y avait aussi des motifs de confiance, qui étaient aussi forts. Hitler, d’abord, était un homme habitué à voir très loin, et que l’exclusivisme allemand n’étouffait pas. il avait été autrichien, puis allemand, puis grand-allemand. Dès 1941, il avait dépassé toutes ces étapes-là, il était Européen. Le génie plane au-dessus des frontières et des races. Napoléon, lui aussi, n’avait d’abord été que Corse, et même un Corse antifrançais ! A la fin, à Sainte-Hélène, il parlait du « peuple français qu’il avait tant aimé » comme d’un peuple estimé, mais pas le sien en exclusivité. Que veut le génie ? Se surpasser toujours. Plus la masse à pétrir est considérable, plus il est dans son élément. Napoléon en 1811 se voyait déjà arrivé aux Indes. L’Europe, pour Hitler, était une construction à sa taille. L’Allemagne n’était qu’un immeuble important qu’il avait édifié jadis, qu’il regardait avec complaisance. Mais il était déjà parvenu bien au-delà. De son côté, [215] nul danger réel n’existait d’une germanisation de l’Europe. Elle était à l’extrême opposé de tout ce que son ambition, son orgueil, son génie visaient, lui dictaient. Il y avait les autres Allemands ? Mais il y avait aussi les autres Européens ! Et ces autres Européens possédaient des qualités propres, exceptionnelles, indispensables aux Allemands, sans lesquelles leur Europe n’eût été qu’un lourd pâté, mal levé. Je pense, avant tout, au génie français. Jamais les Allemands n’eussent peu, pour donner vie à l’Europe, se passer du génie de la France, même s’ils eussent voulu ne pas recourir à elle, même si, comme c‘était le cas de certains, ils la méprisaient. Rien n’était possible et rien ne sera jamais possible en Europe sans la finesse et la grâce françaises, sans la vivacité et la clarté de l’esprit français. Le peuple français a l’intelligence la plus prompte. Elle capte, elle saisit, elle transporte, elle transfigure. Elle est vive. Elle est légère. Le goût français est parfait. Jamais on ne refera une deuxième coupole des Invalides. Jamais il n’y aura un deuxième fleuve enchanteur comme l’est la Loire. Jamais il n’y aura un chic, un charme, un plaisir de vivre comme à Paris. L’Europe d’Hitler eût été lourde au début. A côté d’un Goering, seigneur de la Renaissance, qui avait le sens de l’art et du faste, et d’un Goebbels à l’intelligence aiguisée comme un couperet, nombre de chefs hitlériens étaient épais, vulgaires comme des bouviers, sans goût, débitant leur doctrine, leurs idées, leurs ordres, comme de la viande hachée ou des sacs d’engrais chimiques. [216] Mais précisément à cause de cette lourdeur, le génie français eût été indispensable. En dix ans, il eût tout marqué. Le génie italien, lui aussi, eût fait contrepoids à la puissance trop massive des Germains. On s’est souvent moqué des Italiens. On a vu, depuis la guerre, de quoi ils étaient capables. Ils eussent aussi facilement inondé de leurs souliers impeccables, de leur mode élégante, de leurs voitures racées comme des lévriers, une Europe hitlérienne, que les étroites plates-bandes d’un Marché Commun débutant. Le génie russe fût intervenu également, j’en suis sûr, de façon considérable, dans l’affinage d’une Europe trop allemande, où deux cent millions de Slaves de l’Est allaient être intégrés. Quatre ans à vivre mêlé au peuple russe, l’ont fait estimer, admirer et aimer par tous les combattants soviétiques. Le malheur est que, depuis un demi-siècle, les vertus de ces deux cent millions de braves gens soient étouffées – et risquent de l’être longtemps encore sous l’énorme chape de plomb du régime des Soviets. Ce peuple est paisible, sensible, intelligent et artiste, possédant aussi le don des mathématiques, ce qui n’est pas contradictoire : la loi des nombres est la base de tous les arts. En entrant en Russie, les Allemands, qui avaient été soumis à un endoctrinement nazi vraiment trop sommaire, s’imaginaient que les seuls êtres valables de l’univers étaient les Aryens, qui, obligatoirement, devaient être des géants blonds, charpentés comme des jeux d’orgues, plus blonds que du thé, les yeux bleus comme un ciel tyrolien au mois d’août. [217] C’était assez comique, car Hitler n’était pas grand et il avait le poil châtain. Goebbels avait une jambe plus petite que l’autre, il était court de taille et noiraud comme un pruneau. Zeep Dietrich avait la touche d’un tenancier trapu de bar marseillais. Bormann était tordu comme un champion cycliste retraité. A part quelques géants, servant l’apéritif à la terrasse de Berchtesgaden, les grands gaillards au poil oxygéné, aux yeux de bleuets, n’abondaient pas, on le voit, dans l’entourage d’Hitler. On imagine la surprise des Allemands, dévalant à travers la Russie, à ne rencontrer que des blonds aux yeux bleus, types exacts des Aryens parfaits qu’on leur avait fait admirer en exclusivité ! Des blonds ! Et des blondes ! Et quelles blondes ! De grandes filles des champs, splendides, fortes, l’oeil bleu clair, plus naturelles et plus saines que tout ce qu’avait rassemblé la Hitler-Jugend. On ne pouvait imaginer race plus typiquement aryenne, si l’on s’en tenait aux canons sacro-saints de l’hitlérisme ! En six mois, toute l’armés allemande était devenue russophile. On fraternisait partout avec les paysans. Et avec les paysannes ! Comme sous Napoléon, l’Europe se faisait aussi dans les bras des Européennes, en l’espèce ces belles filles russes, taillées pour l’amour et la fécondité, et qu’on vit, pendant la retraite, suivre éperdument, dans l’horreur des pires combats, les Eric, les Walter, les Karl, les Wolfgang qui leur avaient appris, au heures creuses, que le plaisir d’aimer a son charme partout, même venant de l’Ouest. Des théoriciens nazis professaient des théories violemment antislaves. Elles n’eussent pas résisté à dix ans de compénétration russo-germanique. Les Russes des [218] deux sexes eussent connu l’allemand très vite. Ils le connaissaient déjà souvent. Nous trouvions des manuels d’allemand dans toutes les écoles. Le lien de la langue eût été établi en Russie plus vite que n’importe où en Europe. L’Allemand possède d’admirable qualités de technicien et d’organisateur. Mais le Russe, rêveur, est plus imaginatif et vif d’esprit. L’un eût complété l’autre. Les liens du sang eussent fait le reste. Les jeunes Allemands, tout naturellement, et quoi que leur propagande eût fait pour s’y opposer, eussent épousé des centaines de milliers de jeunes Russes. Elles leur plaisaient. La création de l’Europe à l’Est se fût complétée de la façon la plus agréable. La conjonction germano-russe eût fait merveille. Oui, le problème était gigantesque : souder cinq cent millions d’Européens, qui n’avaient, en commençant, aucune envie de coordonner leur travail, d’accoupler leurs forces, d’harmoniser leurs caractères, leurs tempéraments particuliers. Mais Hitler portait en lui le génie et la puissance capables d’imposer et de réaliser cette oeuvre géante sur laquelle eussent buté cent politiciens desservis par leur médiocrité et par leurs oeillères. Ses millions de soldats eussent été là pour seconder son action de paix, provenant de l’Europe entière, ceux de la Division Azul et ceux des Pays baltes, ceux de la Division Flandern et ceux des Balkans, ceux de la Division Charlemagne et leurs centaines de milliers de camarades des trente-huit division de la Waffen S.S. ! Sur la presqu’île européenne qui surnagea à l’Ouest, après le déluge du Troisième Reich, se sont édifiées, tout de même, les premiers comptoirs, mal achalandés, peu [219] stables encore, d’un Marché commun sentant le troc. Bien. Mais une vraie Europe, soulevée par un idéal héroïque et révolutionnaire, bâtie en grand, eût eu quand même une autre allure ! La vie de la jeunesse de toute l’Europe eût connu un autre panache et un autre sens qu’en menant une existence de beatniks errants et de protestataires, justement révoltés contre des régimes démocratiques qui ne leur proposèrent jamais d’objectif qui pût les enthousiasmer, les étouffant au contraire tout au long des années miteuses de l’après-guerre. Après avoir rué dans les brancards, les divers peuples européens eussent été surpris de voir qu’ils se complétaient si bien. Les plébiscites populaires eussent confirmé, nous encore vivants, que l’Europe de la force était devenue, des Pyrénées à l’Oural, l’Europe libre, la Communauté de cinq cent milions d’Européens consentants. Il est malheureux qu’au XIXe Napoléoon ait raté. Son Europe, fondue dans le creuset de son épopée, nous eût épargné bien des malheurs, les deux guerres mondiales notamment. Elle eût pris à temps, dans ses mains habiles, la grande machine de l’univers, au lieu de laisser l’Europe dans des rivalités colonialistes, souvent abjectes et cupides et qui, finalement, se révélèrent non payantes. De même, il est malheureux qu’au XXe siècle, Hitler ait raté l’affaire à son tour. Le communisme eût été balayé. Les Etats-Unis n’eussent pas fait plier l’univers sous la dictature de la conserve. Et, après vingt siècles [220] de balbutiements et d’efforts ratés, les fils de cinq cent millions d’Européens, unis malgré eux au début, eussent possédé enfin l’ensemble politique, social, économique et intellectuel le plus puissant de la planète. - C’eût été l’Europe des camps de concentration ? On va donc resservir sans fin cette rengaine ! Comme s’il n’y avait eu que ça dans l’Europe qui s’édifiait ! Comme si, après la chute d’Hitler, les hommes n’avaient pas continué à s’exterminer en Asie, en Amérique, en Europe même, dans les rues de Prague et de Budapest ! Comme si les invasions, les violations de territoires, les abus de pouvoir, les complots, les rapts politiques n’avaient pas fleuri, plus que jamais, au Vietnam, à Saint-Domingue, au Venezuela, à la Baie des Cochons, à Cuba, y compris en plein Paris lors de l’affaire Ben Barka, déjà oubliée ! et même au-delà des frontières d’Israël ! Pourquoi ne pas le dire ! Car ce n’est pas Hitler, tout de même, qui a foncé avec ses chars vers le mont Sinaï et occupé par la force, au Proche-Orient, les territoires d’autrui ! Il faut être – oui ! - contre la violence, c’est-à-dire plus exactement contre toutes les violences. Non seulement contre les violences d’Hitler, mais aussi contre les violences de Mollet jetant des milliers de parachutistes sur le canal de Suez en 1956, avec autant de préméditation que de fourberie ; contre les violences des Américains, canardant à quinze mille kilomètres du Massachusetts ou de la Floride les Vietnamiens, dont ils n’avaient à régenter la vie en rien ; contre les violences des [221] Anglais, comblant d’armes les Nigeriens pour dégager, grâce à un million de morts biafrais, les puits de pétrole supercapitalistes ; contre les violences des Soviets, aplatissant sous leurs chars les Hongrois et les Tchèques qui se refusent à leur tyrannie ! Même remarque au sujet des crimes de guerre. On a traîné des vaincus à Nuremberg, on les y a enfermés comme des singes dans des cellules, on a interdit à leur défenseur de faire usage des documents qui eussent pu gêner les accusateurs, notamment de toute référence au massacre, à Katyn, de quinze mille officiers polonais, parce que le représentant de Staline, leur assassin, faisait partie du Tribunal des Crimes de Guerre de Nuremberg au lieu d’y être cité. Si on prétend recourir à un telle procédure, qu’il soit bien entendu qu’elle vaut pour tous les criminels, non seulement pour les criminels allemands, mais aussi pour les criminels anglais qui massacrèrent deux cent mille innocents à Dresde, mais aussi pour les criminels français qui, sans jugement quelconque, fusillèrent sur leur territoire des prisonniers allemands sans défense, mais aussi pour les criminels américains qui broyèrent les organes sexuels des prisonniers S.S. de Malmédy ! Cette procédure devait valoir également pour les criminels soviétiques qui clôturèrent la Deuxième Guerre mondiale par d’effroyables cruautés en Europe occupée et qui ont fait enfourner des millions de personnes dans leurs épouvantables camps de concentration de la mer Blanche et de la Sibérie. Or ces camps-là ne sont pas fermés depuis la Deuxième Guerre mondiale comme ceux du Troisième Reich dont, vingt ans après la liquidation, on nous rebat sans répit [222] les oreilles. Ces camps d’U.R.S.S. existent toujours aujourd’hui, fonctionnent toujours aujourd’hui. On continue toujours à y envoyer des milliers d’êtres humains qui ont le malheur de déplaire à MM. Brejnev, Kossyguine et autres doux agneaux démocratiques ! De ces camps-là, en pleine activité, où les Soviets bouclent implacablement tous ceux qui s’opposent à leur dictature, personne ne souffle un mot parmi les hurleurs de Gauche ! Nul d’entre eux ne s’en offusque ! Alors quoi ! Où est le souci de la vérité ? De l’équité ? Où est la bonne foi ? Où est la farce ? Qui est le plus répugnant ? Celui qui tue ? ou celui qui joue la comédie de la vertu et qui se tait ? Voyant l’impunité totale ainsi accordée aux criminel de paix et de guerre dès l’instant où ils n’étaient pas allemands, tous les forbans de l’après-guerre s’en sont donnés à coeur joie, torturant à mort, avec une sauvagerie atroce, un Lumumba, achevant à la mitraillette un Che Guevara, assassinant au revolver, devant la presse, des prisonniers en plein Saigon, montant avec les plus puissantes complicités, l’abattage public – comme à un tir aux pipes d’un stand forain – d’un Kennedy I, puis d’un Kennedy II, qui gênaient, aux U.S.A., les détenteurs réels du pouvoir – flicaille et haute finance, tapis sous la couverture démocratique. - Tous les criminels à la barre ! Quels qu’ils soient ! où qu’ils soient ! Sinon, tant de cris vertueux de censeurs indignés lorsqu’il s’agit d’Hitler et muets lorsqu’il ne s’agit plus de [223] lui, ne sont qu’abjectes comédies, ne visant qu’à convertir l’esprit de justice en esprit de vengeance, et la critique de la violence en la plus tortueuse des hypocrisies ! Paix aux cendres de ceux qui sont morts sous Hitler ! Mais le tam-tam infernal poursuivi inlassablement sur leurs urnes par les faux puritains de la démocratie, finit par devenir indécent ! Voilà plus de vingt ans que se poursuit, à travers le monde, ce chantage scandaleux, scandaleux parce que mené avec un parti pris aussi total que cynique ! Le sens unique, c’est bien pour les rues étroites. L’Histoire, elle, ne s’en satisfait pas. elle n’admet pas qu’on la convertisse en un cul-de-sac, où se postent aux aguets les provocateurs de la haine éternelle, les sépulcres blanchis, les falsificateurs et les imposteurs. Le bilan est le bilan. Malgré la défaite en U.R.S.S., malgré qu’Hitler ait été brûlé, malgré que Mussolini ait été pendu, les « fascismes » ont été – avec l’instauration des Soviets en Russie – le grand événement du siècle. Certaines des préoccupations de l’Hitler de 1930 se sont estompées. La notion d’espace vital est dépassée. La preuve : l’Allemagne de l’Ouest, réduite au tiers du territoire du Grand Reich, est à présent plus riche et plus puissante que l’Etat hitlérien de 1939. Les transports internationaux et les transports maritimes à bas prix ont tout changé. Sur un rocher pelé, mais bien placé, on peut, à présent, installer la plus puissante industrie du monde. La paysannerie, tellement favorisée par les « fascismes », est passée partout au second rang. Une ferme intelligemment industrialisée rapporte plus, à présent, que cent exploitations sans rationalisation et sans maté[224]-riel moderne exactement adapté. Majorité jadis, les paysans forment une minorité de plus en plus réduite. Le pâturage et le labourage, chers à Sully déjà, ont cessé d’être les seules mamelles des peuples, suralimentés ou n’ayant pas d’argent pour s’alimenter. Et surtout les doctrines sociales, quelles qu’elles fussent, qui ne tenaient compte que du capital et du travail, sont dépassées. Un troisième élément intervient de plus en plus : la matière grise. L’Economie n’est plus un ménage à deux, mais à trois. Un gramme d’intelligence créatrice a plus d’importance, souvent, qu’un train de charbon ou de pyrites. Le cerveau est devenu la matière première par excellence. Un laboratoire de recherches scientifiques peut valoir plus qu’une chaîne de montage. Avant le capitaliste et avant le travailleur : le chercheur ! Sans lui, sans ses équipements hautement spécialisés, sans ses ordinateurs et sans ses statistiques, le Capital et le Travail sont des corps morts. Les Krupp eux-mêmes et les Rothschild not dût s’effacer devant les têtes les mieux faites. L’évolution de ces problèmes n’eût pas pris Hitler de court. Il lisait tout, était au courant de tout. Ses laboratoires atomiques furent les premiers du monde. Le propre du génie est de se recycler sans cesse. Hitler, foyer imaginatif en continuelle combustion, eût prévenu l’événement et le changement. Il avait, avant tout, formé des hommes. L’Allemagne et l’Italie, bien que vaincues, écrasées (le Troisième Reich n’était plus qu’un fabuleux monceau de débris et de briques en 1945), eurent tôt fait de reprendre la tête de l’Europe. Pourquoi ? Parce que la grande école de l’hitlérisme et du fascisme avait crée [225] des caractères. Elle avait formé des milliers de jeunes chefs, avait donné une personnalité à des milliers d’êtres, elle leur avait révélé, dans des circonstances exceptionnelles, des dons d’organisation et de commandement que le bête petit train-train, semi-bourgeois, des temps précédents ne leur eût jamais permis de mettre en valeur. Le miracle allemand d’après 1945 fut cela : une génération, broyée matériellement, avait été préparée supérieurement à un rôle de dirigeants par une doctrine basée sur l’autorité, sur la responsabilité, sur l’esprit d’initiative ; à l’épreuve du feu, celle-ci avait donné aux caractères la trempe du meilleur acier qui, à l’heure où il fallait tout redresser, se révéla un levier irrésistible. Mais l’Allemagne et l’Italie ne furent pas les seules à être soulevées par le grand ouragan hitlérien. Notre siècle a été ébranlé par lui jusque dans ses fondements, transformé dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’Etat, des relations sociales, de l’économie, ou de la recherche scientifique. L’actuel déploiement des découvertes modernes, depuis l’énergie nucléaire jusqu’à la miniaturisation, c’est Hitler – bouchez-vous les oreilles, mais c’est ainsi ! – qui le mit en train, alors que l’Europe assoupie mangeait sa soupe quotidienne sans se soucier de voir plus loin que son bol. Qu’eût été un Von Braun, jeune Germain massif, totalement inconnu et sans ressources, sans Hitler ? Pendant les années ingrates, celui-ci le poussa, le stimula. Goebbels prenait parfois le relais, soutenant Von Braun de son amitié. En 1944 encore, ce ministre – le plus intelligent des ministres d’Hitler – délaissait ses occupations pour encourager Von Braun dans l’intimité. [226] Ce fut le cas de centaines d’autres. Ils avaient du talent. Mais qu’eussent-ils fait avec leur seul talent ? Les Américains savaient bien que l’avenir scientifique du monde était là, dans les laboratoires d’Hitler. Alors qu’ils se laissaient complaisamment présenter comme les rois de la science et de la technique, ils n’eurent pas de préoccupation plus grandes, lorsqu’ils furent vainqueurs en mai 1945, que de se précipiter à travers le Troisième Reich, encore fumant, pour récupérer des centaines de savants atomiques. Les Soviets menèrent une course parallèle. Ils transportèrent des savants d’Hitler à Moscou par trains entiers. A tous ceux d’entre eux qu’elle put joindre, l’Amérique fit des ponts d’or. Les U.S.A. prirent comme chef de leur immense complexe nucléaire le von Braun d’Hitler, d’Hitler à qui l’Amérique moderne doit tant car c’est lui qui, le premier, en août 1939, donc avant même que la Deuxième Guerre mondiale commençât, fit monter la première fusée du monde dans le ciel de la Prusse. Le monde moderne est né ce jour-là. De même que la poudre, qui tuait, a servi l’univers, l’ère nucléaire, ouverte par Hitler en 1939, transformera les siècles futurs. Là encore, comme dans le domaine social, les contempteurs d’Hitler ne sont que ses tardifs imitateurs. Le Centre de Recherches de Pierrelate est-il autre chose qu’un « à la manière » de la base hitlérienne de Peenemunde, avec vingt-cinq ans de retard ? Hitler a disparu, le monde démocratique s’est révélé [227] incapable de créer du neuf dans le domaine politique et social, ou même de rafistoler avec du vieux. Ila a eu beau essayer de redresser sur leurs pattes les vieilles haridelles efflanquées de l’avant-guerre. Flageolantes, elles sont retombées sur le sol souillé. De Nasser à de Gaulle, de Tito à Castro, où qu’on regarde, parmi les vieux pays qui cherchent à sortir du passé où, parmi les pays nouveaux pays du Tiers Monde qui s’éveille, partout resurgissent les formules : nationalisme et socialisme, représentées par l’homme fort, incarnation et guide du peuple, aimant puissant des volontés, créateur d’idéal et de foi. Le mythe démocratique, à l’ancien style, pompier, bavard, incompétent, stérile, n’est plus qu’une baudruche à cent têtes vides, qui ne mystifie plus personne, n’intéresse plus personne, et fait même rire la jeunesse. Qui se préoccupe encore des vieux partis et de leurs vieux bonzes démonétisés et oubliés ? Mais Hitler, mais Mussolini, qui les oubliera jamais ?… Des millions de nos garçons sont morts, au bout d’une odyssée horrible. Que sont même devenues, là-bas, tout au loin, leurs pauvres tombes ? … Nos vies à nous, les survivants, ont été broyées, saccagées, définitivement éliminées. Mais les fascismes, pour lesquels nous avons vécu, ont modelé notre époque à jamais. Dans nos malheurs, c’est notre grande joie. On aura beau gratter le tatouage sous nos bras de soldats ! Trop tard ! Nous regardons les exterminateurs en les défiant. Le rideau de l’Histoire peut tomber sur Hitler et Mussolini, comme il tomba sur Napoléon. Les nains n’y changeront rien. La grande Révolution du XXe siècle est faite. |