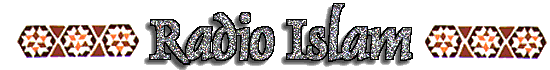
HOME
Léon Degrelle
( 15-6-1906 à Bouillon en Belgique- 31-3-1994 à Malaga en Espagne)
Qu´importe de souffrir si on a
eu dans
sa vie quelques heures immortelles.Au moins, on a vécu!

Les
tramways de Moscou
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
La guerre d’Hitler en U.R.S.S., déclenchée le 22 juin 1941, commença bien et commença mal. Elle commença bien. L’immense machinerie de l’armée allemande se mit en marche avec une précision parfaite. Il y eut, de-ci de-là, des accrocs, des colonnes fourvoyées, des ponts défoncés sous le poids des chars. Mais ce ne furent que des détails. Dès la première heure, la Luftwaffe avait réduit à l’impuissance, pour des mois, l’aviation soviétique et rendu impossibles les concentrations de l’ennemi. Au bout de dix jours, la Wehrmacht avait triomphé partout, s’était élancée très loin partout. Un effondrement total du front russe et du régime soviétique pouvaient se produire à brève échéance. Winston Churchill plus que tout autre les redoutait et, dans ses dépêches secrètes, les annonçait. Pourtant, la guerre avait, aussi, mal commencé. Et elle finirait mal, précisément, parce qu’elle avait mal commencé. Tout d’abord – et ce fut un élément décisif – elle avait commencé tard, très tard, trop tard, cinq semaines après la date fixée par Hitler, parce que la folle aventure de Mussolini à la frontière grecque, en octobre 1940, avait torpillé les plans hitlériens à l’Est. C’est dans les monts boueux qui séparent la Grèce de l’Albanie que le sort de la Deuxième Guerre mondiale s’est bel et bien joué, plus qu’à Stalingrad, plus qu’à El-Alamein, plus qu’aux plages de Normandie, plus qu’au pont rhénan de Remagen, pris intact, en mars 1945, par le général américain Patton. Mussolini était hanté par les victoires d’Hitler. Lui, le père du fascisme, avait été relégué à un rôle de second plan par la série de campagnes foudroyantes – et toujours triomphales – que le Führer avait menées, tambour battant, de Dantzig à Lemberg, de Narwik à Rotterdam, d’Anvers à Biarritz. Chaque fois, les aigles allemandes avaient été hissées sur des pays, parfois immenses, conquis en un tournemain, cependant que plusieurs millions de prisonniers avaient avancé, comme d’interminables files de chenilles, vers les camps d’hébergement d’un Reich de plus en plus sûr de ses succès. Mussolini, lui, militairement, avait tout raté. Son invasion, in extremis, dans les Alpes françaises, s’était soldée par un échec humiliant. Le maréchal Badoglio, pion très intéressé qui avait ramené chez lui, d’Addis-Abéba, des trésors en or massifs volés dans le palais du Négus en fuite, avait, dès juin 1940, révélé son incapacité tactique, digne de son émule Gamelin. Alors que la France était au sol, que les chars de Guderian et de Rommel se déployaient presque sans combat jusqu’à la Provence et qu’une descente à Nice n’eut dû être, pour les Italiens, qu’une brève excursion militaire parmi des verges aux fruits mûrs, Badoglio, qui, pourtant, avait eu à sa disposition de longs mois pour se préparer, avait réclamé à Mussolini vingt et un jours supplémentaires pour astiquer les derniers boulons de ses guerriers. L’opération avait vite tourné en cacade. Les Français avaient sonné durement les agresseurs de la dernière minute, leur infligeant des pertes considérables et les clouant au sol, dans le déploiement piteux de leurs plumets mordorés. En Afrique, le démarrage en Libye n’avait guère été plus brillant : un général italien avait été fait prisonnier dès le premier jour. Lorsque l’artillerie italienne s’était payé le luxe d’abattre un avion qui miroitait en plein soleil, il se trouva que ce fut celui du maréchal Balbo. Il fut descendu comme une perdrix. Ainsi, le plus fameux aviateur tué par les Italiens en 1940 avait été leur plus glorieux chef ! Le temps n’avait rien arrangé. L’armement italien, vanté tapageusement pendant vingt ans, était déficient. La Marine manquait de zèle. Le troupier ne se sentait pas guidé. Le maréchal Graziani, esprit brouillon, piètre entraîneur, préférait donner ses ordres à quinze mètres sous terre plutôt qu’à quinze mètres en avant de ses troupes comme le ferait plus tard sur le front italien le général Rommel, le lansquenet intrépide. Mussolini rageait. Il était furieux de tous ces échecs. Il imagina de redorer son blason militaire au cours d’une conquête facile de la Grèce, qui serait préparée à coups de millions départis discrètement parmi le personnel politique d’Athènes. Ainsi, la victoire serait acquise sans grand heurt, sur un ennemi d’accord d’avance pour céder et qui ne résisterait que pour la forme. – « J’avais acheté tout le monde ! Ces salauds de Grecs ont empoché mes millions et m’ont roulé ! » Cette confidence surprenante, c’est le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d’Italie, vif d’esprit et assez fripouillard sur les bords, qui me la fit personnellement, en juin 1942, lorsque, passant en avion par Rome, en coup de vent, je le vis pour la dernière fois et l’interrogeai sur cette guerre de Grèce, ratée de façon si extraordinaire. Sur ces affirmations de Ciano (son gendre), Mussolini, en octobre 1940, brusqua les événements. Il ne souffla mot à Hitler de ce plan d’invasion. Lorsque le chancelier allemand qui se trouvait à Hendaye, où il venait de rencontrer le général Franco, eut vent d’un tel projet, il fit aussitôt lancer son train spécial vers l’Italie, où il se vit accueillir, le surlendemain, sur les quais de Florence, par un Mussolini triomphant « Mes troupes viennent de débarquer en Grèce ce matin ! » Hitler était arrivé trop tard ! Il ne put que souhaiter bonne chance à son collègue. Mais il tremblait. Et avec raison. Au bout de quelques jours, les troupes italiennes qui s’étaient engouffrées en Grèce, dans la chaîne des monts du Pinde, se faisaient bousculer, écharper, refouler de l’Epire, dans une débâcle de plus en plus tragique. Les chefs italiens, vantards le premier jour, paniquards le second, s’étaient comportés lamentablement. Les soldats étaient anéantis. On vit le moment où le corps expéditionnaire italien allait se faire jeter au grand complet dans l’Adriatique et où l’Albanie entière serait submergée par les jupons blancs des Grecs. Il fallut, comble de l’humiliation, faire appel à Hitler qui dépêcha en toute hâte vers Tirana des forces allemandes de secours. La situation fut rétablie, mais l’essentiel ne résidait même pas en cela. Que les grecs se fussent adjugé l’Albanie, excroissance assez vaine de l’empire italien, n’eût pas été spécialement tragique. Le roi Victor-Emmanuel eût porté sur la tête une couronne de moins. Il se fût trouvé raccourci d’une vingtaine de centimètres lors des cérémonies d’Etat, ce qui n’eût absolument rien eu d’affolant. L’affolant, c’est que l’entrée des Grecs dans la guerre avait provoqué le débarquement en Grèce des Anglais, devenus des alliés par ricochet. Or, les Anglais installés en bas des Balkans, c’était la possibilité, la presque certitude de les voir couper les lignes de l’Est lorsque Hitler se serait enfoncé très profondément dans l’immense espace soviétique. S’y ajoutait la hantise des raids de l’aviation britannique, installée en force dans ses nouvelles bases grecques. Elle pouvait, sous des bombardements massifs, incendier les puits de pétrole roumains, indispensables au ravitaillement des vingt divisions de Panzers qu’Hitler se préparait à lancer à travers deux mille kilomètres de frontières soviétiques. Les risques étaient devenus immenses. Ils devinrent absolument redoutables lorsque, le même hiver, la Yougoslavie du roi Pierre, à l’instigation d’agents anglais, se dressa contre les Allemands. Il n’y avait plus, dès lors, de ruée possible, à la date prévue, en U.R.S.S., d’autant plus que Molotov venait d’envoyer au roi yougoslave des félicitations particulièrement insolentes de Staline et l’assurance de son appui moral. A la suite de cette sotte aventure mussolinienne, Hitler, avant de reprendre l’Est à son grand projet, se voyait condamné à nettoyer préalablement les Balkans, à dévaler avec ses chars à travers toute la Yougoslavie, toute la Grèce et même à s’emparer du porte-avions anglais qu’était devenue l’île de Crète. Ce fut un rush sensationnel. En dix jours, la Yougoslavie fut vaincue et entièrement occupée. Puis ce fut la descente à tombeau ouvert jusqu’à Athènes et jusqu’à Sparte. La croix gammée brillait au-dessus des marbres dorés de l’Acropole. Les parachutistes de Goering descendaient, avec un héroïsme triomphant, sur l’île de Crète où la déroute des Anglais fut consacrée en quarante-huit heures. Les navires alliés en fuite vers l’Egypte se firent descendre comme des canards sur les étangs landais. Parfait. La menace avait été liquidée. Mais cinq semaines avaient été perdues, cinq semaines qu’Hitler ne rattraperait plus jamais. Soldat, j’ai connu pas à pas – car nous traversâmes la Russie entière à pied – chaque détail de cette tragédie. C’est parce qu’un mois manqua à Hitler que la guerre ne se termina pas en 1941, au front russe, ce mois-là que, précisément, l’amour-propre blessé de Mussolini avait fait perdre à l’Axe par sa lamentable équipée de la frontière grecque. Le temps avait été perdu. Et un matériel de la plus haute importance avait aussi été perdu. Non point que les chars allemands aient été détruits en grand nombre au cours des combats échelonnés de Belgrade au canal de Corinthe. Mais le matériel lourd des Panzer Divisionen avait été sérieusement mis à mal au cours de trois mille kilomètres de courses par monts et par vaux, souvent très caillouteux. Des centaines de chars devaient être révisés. Ils ne purent pas être mis en ligne, le 22 juin 1941, lors du grand démarrage. Je dis ce que j’ai vu, de mes yeux vu : les divisions blindées de Von Kleist, du groupe d’armées du Sud aux ordres du maréchal Von Rundstedt, qui se ruèrent à travers l’Ukraine, ne comportaient, chiffre à peine croyable, que six cent chars ! Six cent chars pour mettre en pièces des millions de soldats soviétiques, des milliers de chars soviétiques, et arriver, tout de même, à Rostov, au fin fond de la mer Noire et de la mer d’Azov, avant que ne surgît l’hiver, non sans avoir dû encore détourner l’essentiel de cette force blindée pour se jeter à la rencontre du général Guderian descendant du nord, et réaliser avec lui le plus grand encerclement de l’histoire militaire du monde à deux cent kilomètres à l’est de Kiev. Avec cinq cent chars de plus, le groupe d’armées allemandes d’invasion au Sud de l’U.R.S.S. eût atteint, avant les froids, Stalingrad et Bakou. Ces chars qui manquaient, c’est Mussolini qui les avait fait perdre. Si catastrophique qu’ait été ce décalage de cinq semaines dans l’horaire, un matériel allemand plus abondant eût pu compenser, très probablement, le déséquilibre dans les temps. Mais, là aussi, la guerre commença mal. Les renseignements fournis sur la force de l’U.R.S.S. s’étaient rapidement révélés faux. Les Soviets possédaient non point trois mille chars, comme les Services secrets allemands l’avaient prétendu à Hitler, mais dix mille, c’est-à-dire trois fois plus de char que l’Allemagne n’en alignait. Et certains types de chars russes, tels que le T. 34 et le KV. 2, de cinquante deux tonnes, étaient normalement invulnérables, d’une solidité extraordinaire, construits tout spécialement pour dominer les boues et les neiges de là-bas. En outre, la documentation sur les voies d’accès à travers l’espace russe était erronée : de grandes artères prévues pour les chars n’existaient même pas ; d’autres, sablonneuses, étaient tout juste bonnes pour supporter le passage de troïkas légères. La moindre auto s’y engloutissait. Néanmoins, grâce à des miracles d’énergie, la ruée s’accomplit. En vingt-cinq jours, sept cent kilomètres avaient été franchis et conquis. Dès le 16 juillet 1941, Smolensk, la dernière grande ville sur l’autoroute qui conduisait à Moscou, était tombée. Du point extrême de l’avancée allemande, la boucle d’Elyna, il ne restait plus que 298 kilomètres avant d’atteindre la capitale de l’U.R.S.S. ! En deux semaines d’offensive à la cadence en cours, celle-ci eût été atteinte. Staline préparait déjà le transfert du corps diplomatique jusqu’au-delà de la Volga. La panique régnait. Des manifestants huaient le communisme. On vit même brandir, dans une rue de Moscou, un drapeau à la croix gammée, fabriqué à la hâte. Mais se précipiter vers Moscou, d’un intérêt stratégique relativement maigre, c’était renoncer à détruire l’immense cohue de plus d’un million de soldats soviétiques, qui, au Sud, refluaient en désordre vers le Dniepr et vers le Dniester. On ne mène pas une guerre pour occuper des villes mais pour anéantir la force combattante de l’adversaire. Ce million de Russes en déroute, laissé en paix, se fût reconstitué à l’arrière. Hitler avait donc raison. Il fallait les prendre sans retard, avec tout leur matériel lourd, dans la nasse d’immenses encercle[12]-ments, près desquels les encerclements de Belgique et de France de 1940 seraient presque des jeux d’enfants. C’était aussi s’assurer, économiquement, les énormes richesses minières du Donetz. Malheureusement, Guderian ne disposait pas de forces suffisantes pour mener, à la fois, la course vers Moscou et l’anéantissement de l’ennemi à l’autre extrémité de la Russie. Quel que fût le choix, la deuxième opération serait presque certainement engagée trop tard. Si, au lieu de devoir arrêter ses blindés sur l’autoroute de Smolensk et abandonner provisoirement la conquête de Moscou, à portée de sa main, Hitler avait disposé de deux ou trois mille chars de plus, les deux opérations géantes, la conquête de Moscou à l’Est et l’encerclement de la Masse soviétique au Sud, eussent pu être réussies à temps et simultanément. Et même la troisième opération, la conquête, dès avant l’hiver 1941, de la Volga inférieure et du Caucase. Longtemps on s’est demandé comment Hitler avait pu commettre une telle erreur d’évaluation et s’élancer à travers l’empire gigantesque des Soviets avec, seulement, 3254 chars, à peu de choses près ce qu’il possédait en entrant en France au mois de mai 1940. Avait-il été victime, lui aussi, des illusions qui égarèrent tant de stratèges à la suite de la piteuse campagne militaire des Soviets en Finlande au cours de l’hivers 1939-1940 ? Pas même ! - « Quand j’ai donné l’ordre à mes troupes d’entrer en Russie, me dit-il un jour, j’ai eu la sensation d’enfoncer à coups d’épaule une porte derrière laquelle se trouvait un local obscur dont j’ignorais tout ! » Alors ? … Alors il a fallu attendre le dépouillement des archives de la Heereswaffenamt pour connaître la vérité. Ces documents révèlent qu’aussitôt après la campagne de France de 1940, Hitler, voyant l’écrasante menace soviétique s’affirmer, exigea une production mensuelle de 800 à 1000 chars. Le chiffre n’avait rien de fou, et il serait largement dépassé un an plus tard. Les usines du Reich n’eussent-elles même sorti que la moitié des chars réclamés alors par le Führer que le rush des blindés hitlériens à travers l’U.R.S.S. eût été impossible à arrêter. Mais, dès alors, le sabotage qui aboutirait à l’attentat contre Hitler, du 20 juillet 1944, était mené sournoisement par d’importants généraux d’Administration, à qui étaient confiés les services de production de l’arrière. Sous prétexte que ces chars coûteraient deux milliards de marks (quelle importance !), et réclameraient cent mille travailleurs qualifiés (l’Allemagne en regorgeait, la Wehrmacht étant alors inactive) le Heereswaffenamt étouffa les ordres de fabrication. Les saboteurs allèrent même plus loin. Hitler avait exigé que les chars III, pourvus jusqu’alors de canons de 37 calibres, fussent dotés de canons de 50 mm L 60, capables de venir à bout des blindés les plus puissants. Ce n’est qu’à la fin de l’hiver, c’est-à-dire trop tard, qu’Hitler apprit que les canons prévus par lui, à 60 calibres de longueur, n’en possédaient que 42. cette faiblesse se révéla fatale devant Moscou. - « Lorsque, raconte Guderian, Hitler remarqua, en février 1942, que ses instructions n’avaient pas été exécutées, bien que les possibilités techniques existassent, il fut pris d’une violente colère et ne pardonna jamais aux officiers responsables d’avoir agi de leur propre autorité » Mais le mal était fait. L’effort de création d’un nouvel armement fut presque insignifiant. Pendant ces mois, le Troisième Reich, s’il l’avait réellement voulu, eût pu facilement fabriquer cinq mille, six mille nouveaux chars, plus puissamment calibrés, adaptés exactement au climat et aux extraordinaires difficultés du terrain qu’ils devraient affronter dans leurs futurs combats. Alors, oui, la ruée à travers l’U.R.S.S. eût été irrésistible. Il n’en fut rien. Vingt Panzer Divisionen pénétrèrent le 22 juin 1942 en Russie, au lieu des dix qui avaient conquis la Belgique, la Hollande et la France en mai de l’année précédente. Mais le passage de dix à vingt divisions était théorique. Il y avait deux fois plus de Panzer Divisionen mais deux fois moins de chars dans chacune d’elles. Malgré tout, ce qui se passa tint du prodige. Guderian descendit à marches forcées vers le Donetz, menant des combats d’une audace inouïes. Deux fabuleuses razzias, près de Kiev, à Ouman, où Guderian n’était pas intervenu, puis près de Poltava, anéantirent les forces soviétiques du Dnieper. C’est seulement après ce dernier encerclement, le plus colossal de la guerre (665 000 prisonniers, 884 blindés et 3718 canons conquis) qu’Hitler donna l’ordre à Guderian de regrimper vers le nord, pour essayer, non seulement de prendre Moscou à revers, c’est-à-dire par le sud-est, mais même de foncer jusqu’à Nijni-Novgorod (actuellement Gorki) à quatre cent kilomètres plus à l’est, sur la Volga même ! L’opération, si elle eût réussi, eût été la plus prodigieuse chevauchée blindée de tous les temps : de Pologne à Smolensk, puis de Smolensk au Donetz, puis du Donetz, de nouveau, vers Moscou, et à 80 lieues au-delà, vers la Volga ! Plusieurs milliers de kilomètres à franchir en cinq mois, en combattant ! Avec du matériel usé, des servants rendus ! Guderian repartit à travers tout, franchissant des étapes qui atteignirent jusqu’à cent vingt-cinq kilomètres en un jour. En même temps que lui, toutes les forces blindées allemandes du Nord couraient de Smolensk droit devant elles, vers la capitale soviétique. Moscou allait être pris au bout d’une manœuvre d’une précision stratégique parfaite. La guerre eût été terminée quand même ! Les cinq semaines perdues avant le commencement de la campagne et le manque de deux ou trois mille chars qui eussent permis le dédoublement de colonnes d’assaut, allaient faire échouer cet immense effort final, à quelques kilomètres de la réussite. Dès la fin d’octobre 1941, des boues effroyables avaient enlisé les formations de chars du Reich. Plus un blindé n’avançait. Plus un canon ne pouvait être déplacé. Les approvisionnements restaient englués sur les routes : non seulement le ravitaillement des soldats, mais les munitions de l’artillerie et l’essence des chars. Le gel allait faire le reste. Il allait, en novembre et au début de décembre 1941, s’aggraver de façon de plus en plus catastrophique, passant de 15° sous zéro, à 20° sous zéro, à 35° sous zéro, pour atteindre même 50° sous zéro ! Depuis cent cinquante ans, la Russie n’avait pas connue un hiver plus féroce ! Impossible aux chars de se déplacer. Quarante pour cent des soldats avaient les pieds gelés, privés de l’équipement d’hiver auxquels l’Intendance n’avait guère pensé, elle non plus, entre 1940 et 1941. Vêtus toujours de leurs uniformes légers de l’été, sans manteau souvent et sans gants, à peine nourris, ils courraient inexorablement à l’effondrement physique. En face d’eux, les Soviets disposaient de chars capables de braver la boue, le gel et le froid. Le premier matériel anglais venait d’atteindre les faubourgs de Moscou. Des troupes fraîches avaient été amenées, en très grand nombre, de Sibérie, qu’une intervention japonaise – qui, elle aussi, fit défaut – eût retenu en Asie très utilement. Chaque jour le combat devenait plus atroce. Pourtant, les assaillants allemands poursuivaient leur effort, quelle qu’en fût la rigueur. Des flèches avancées avaient même dépassé Moscou au nord, à Krasnaia Poliana. D’autres avaient atteint les faubourgs de Moscou et occupé le dépôt des tramways. Devant eux, dans le gel dévorant, les coupoles de la capitale des Soviets brillaient, tentaculaires. C’est là, à quelques kilomètres du Kremlin même, que l’assaut fut enrayé à jamais. Les unités étaient devenues squelettiques. La plupart ne possédaient même plus le cinquième de leurs effectifs. Les soldats s’abattaient sur la neige, incapable encore du moindre sursaut. Les armes, gelées, s’enrayaient, se refusaient à tout service.
Les Soviets, par
contre, arc-boutés à quelques kilomètres à peine de leurs bases, recevaient en
abondance vivres, munitions et l’appui de nouveaux chars qui sortaient par
centaines des usines même de Moscou. Ils s’élancèrent à la contre-offensive. Les
survivants allemands de cette terrible épopée furent dépassés par la vague. La
bataille de Moscou était perdue. En plus d’elle, Staline avait gagné la
semi-tranquillité de six mois d’hiver, six mois qui seraient un rempart
immédiat, et son salut par la suite. |
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!