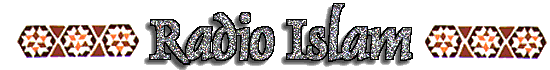
HOME
Léon Degrelle
( 15-6-1906 à Bouillon en Belgique- 31-3-1994 à Malaga en Espagne)
Qu´importe de souffrir si on a
eu dans
sa vie quelques heures immortelles.Au moins, on a vécu!

Les exilés
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
Meine liebe Degrelle… C’est Himmler qui s’adressait à moi. Nous étions enfoncés, en pleine nuit du 2 mai 1945, dans la gadoue d’un camp ténébreux. A cinq cent mètres devant nous, un millier d’avions alliés achevaient d’anéantir la ville de Kiel. Tout sautait par paquets clairs comme du métal en fusion, rendant plus noire encore la nuit dans laquelle nous nous recroquevillions. Meine liebe Degrelle, vous devez survivre. Tout changera vite. Vous devez gagner six mois. Six mois… Il me fixait de ses petits yeux fureteurs, derrière ses bésicles qui luisaient à chaque gerbe des explosions. Sa face ronde, d’une pâleur lunaire normalement, était devenue blafarde dans ces dégringolades de fin du monde. Quelques heures plus tôt, à la fin de l’après-midi, nous avions perdu Lübeck. Talonnés par les chars anglais et mitraillés par les Tipfligers, nous refluions sur la grand-route du Danemark, lorsque j’avais vu débouler Himmler débouler d’un chemin de campagne, dans une grosse voiture noire. Déjà, peu avant, j’étais tombé nez à nez avec Speer, l’ancien ministre des Armements, architecte extraordinaire et le plus gentil garçon du monde. Lui, dans ce déluge de feu, restait, comme toujours, d’un naturel gai. Nous avions blagué ensemble un instant. Himmler était survenu. Lui ne blaguait pas souvent. En tout cas, lorsqu’il le faisait, c’était toujours avec application. Dans ce crépuscule du 2 mai 1945 – Hitler était mort depuis cinquante heures et l’avait laissé hors de toute succession -, Himmler avait une tête plus austère que jamais, terne, luisante sous quatre cheveux maigres. Il avait tenté de me sourire, entre ses dents qu’il avait petites, des dents de rongeur sous lesquelles, déjà, était cachée la petite gousse de cyanure de potassium qui le foudroierait quelques jours plus tard. J’étais grimpé dans la bagnole près de lui. Nous avions fait halte dans la cour d’une ferme. Il m’avait annoncé que j’étais devenu général depuis quelques jours. Général, caporal, cela n’importait plus guère ! Le monde nous tombait sur le râble. Bientôt nous serions tous sans uniformes et sans épaulettes. Et même morts, pour la plupart. Nous avions repris ensemble, dès la nuit, la route du grand port de Kiel. Quand nous allions y pénétrer, l’aviation des Alliés nous avait offert le feu d’artifice prodigieux du dernier anéantissement. Tout Kiel sautait, grillait. Sur notre route, les bombes dégringolaient comme des noix, explosaient ou ricochaient. Nous n’avions eu que le temps de sauter dans un champ marécageux. Une des deux secrétaires d’Himmler, une longue fille ingrate, avait aussitôt perdu dans la glu ses deux souliers à hauts talons. Perchée sur un de ses mollets, qu’elle avait osseux et grêles, elle farfouillait dans la vase noire, cherchant en vain à repêcher ses chaussures et se lamentant. Chacun a ses préoccupations. Himmler continuait avec les siennes. Mein liebe Degrelle, six mois, six mois… Je l’avais heurté souvent pas mon intransigeance. Homme intellectuellement médiocre, il eût fait un instituteur appliqué, en des temps normaux. Les vues européennes le dépassaient. Mais, enfin, il s’était habitué à mes points de vue et à mes manières. A ce moment où notre univers s’écroulait, il lui importait que je survécusse. Déjà, le 21 avril 1945, après l’Oder, il m’avait demandé d’être le ministre des Affaires étrangères du gouvernement qui succéderait à l’équipe d’Hitler. Il m’avait, ensuite, envoyé le général Steiner pour décrocher mon assentiment. J’avais cru à une plaisanterie. J’étais le dernier à pouvoir traiter, comme ministre des Affaires étrangères, avec des Alliés qui tous me guettaient, pour me pendre à toute vitesse ! Empêtré dans la gadoue, Himmler répétait, tenace : Tout aura changé dans six mois ! Finalement, je lui répondis, fixant, sous l’éclair des explosions, ses petits yeux fatigués : Pas dans six mois, Reichführer, dans six ans ! J’aurais dû dire : dans soixante ans ! Et, maintenant, je crois même que dans soixante ans, les chances, pour moi, d’une résurrection politique quelconque seront encore plus minces ! La seule résurrection qui m’attende désormais sera celle du Jugement Dernier, à grands coups de trompettes apocalyptiques ! L’exilé a, naturellement tendance à croire que ses chances vont réapparaître. Il guette l’horizon. Le moindre symptôme de modification dans son pays perdu revêt à ses yeux une importance capitale. Une élection, un incident de presse sans intérêt le mettent en effervescence. Tout va changer ! Rien ne change. Les mois passent, les années passent. Au début, l’exilé de marque était reconnu. On le regardait où qu’il allât. Cent personnes aujourd’hui le coudoient, indifférents : la bonne grosse femme qui le heurte pense à ses poireaux à acheter ; l’homme, trop lent devant lui, reluque les passantes ; le gamin qui court lui cognant les tibias n’a pas la moindre idée de ce qu’il est et, surtout, de ce qu’il fut. Il n’est plus qu’un inconnu dans le tas. La vie a passé, a tout lavé, l’existence du proscrit est devenu sans couleur, comme le reste. En mais 1945, quand je me retrouvai sur un petit lit de fer à l’hôpital de Saint-Sébastien, plâtré depuis le cou jusqu’au pied gauche, j’étais encore une vedette. Le gros gouverneur militaire s’était amené, tapissé de grands cordons, s’épandant en abrazos bruyants ! Il n’avait pas encore bien saisi que j’étais tombé du mauvais côté et que je n’étais plus à fréquenter. Il le comprendrait vite ! Tous le comprendraient vite ! Au bout de quinze mois, quand mes os auraient été ressoudés, je me retrouverais, une nuit, bien loin de là, dans une rue noire, guidé vers un gîte secret. La seule solution pour moi, la seule survie, alors qu’on réclamait de toutes parts mon extradition, - douze balles dans la peau ! – était le trou de l’oubli. Je passerais deux années dans un premier trou de l’oubli. J’en connaîtrais bien d’autres ! On m’avait installé dans une chambrette sombre, colée à un ascenseur de service. Je ne pouvais voir personne. Je ne pouvais jamais m’approcher d’une fenêtre. Les volets restaient toujours baissés. Les deux vieillards qui m’hébergeaient constituaient mon seul univers. Lui, pesait dans les cent cinquante kilos. La première chose que j’apercevais le matin était, dans le couloir, son seau d’urine. Il en produisait quatre litres en une nuit. Travail intensif. Son unique travail. Dès avant le repas de midi, il se remettait en pyjama, un pyjama gigantesque, ouvert, béant, sur un grand triangle de chair pâle. Elle, trottait sous un paquet de cheveux rares, jaunes et hirsutes, naviguant dans le noir de sa maison – la lumière brûle ! – sur deux vieilles loques – les souliers usent ! Le soir, ils écoutaient tous deux, installés dans des fauteuils d’osier, une pièce de théâtre à la radio. Au bout de cinq minutes, ils dormaient, lui, expectorant des grognements profonds vers l’avant, elle, la tête rejetée en arrière, émettant des sifflements stridents. A une heure du matin, le silence de la fin de l’émission les réveillait. Elle prenait alors la cage à oiseaux ; lui, une grande statue peinturlurée de saint Joseph brandissant une palme verte. Ils se mettaient en route à petit pas vers leur chambre à coucher. Les ronflements recommençaient. Le matin, je retrouvais devant la porte les quatre litres d’urine. Telle serait ma vie durant deux ans : la solitude, le silence, l’ombre, deux vieillards qui remplissaient un seau à pleins bords, portaient saint Joseph et deux perruches. Je ne verras pas un sourire une seule fois. Ni deux jambes gracieuses sur un trottoir. Ni même un arbre découpant quelques feuilles jaunies sur le ciel. Après, j’ai bien dû sortir. Ma blessure à l’estomac – cadeau du Caucase – s’était crevée d’un bout à l’autre. En six mois, j’avais perdu trente-deux kilos. Dans une clinique discrète, on m’avait ouvert le ventre, de l’œsophage jusqu’au nombril, sur dix-sept centimètres. J’avais été reconnue au bout de trois jours par un infirmier. Il avait fallu m’emporte en pleine nuit sur une civière. On m’avait hissé par un escalier étroit jusqu’à un quatrième étage. Je ruisselais de sueur et de sang, car, sous les contorsions du brancard, tous les points de suture avaient sauté ! Quelle vie ! Ne pas se montrer – pour ne pas être reconnu – ne sert à rien. On vous reconnaît tout de même, on vous voit tout de même, même si vous êtes à dix mille kilomètres de là. Je possède un dossier vraiment cocasse sur mes séjours dans vingt pays différents. Ce jour-là un journaliste m’avait découvert à Lima ! Un autre jour, c’était à Panama ! Ou dans la pampa argentine ! Ou dans une villa proche du Nil, chez le colonel Nasser ! Chaque fois, les détails étaient tellement précis que je finissais par me demander si je n’étais pas là vraiment, si je ne me trompais pas. un grand journal français apporta, sous un énorme titre de première page, des précisions absolument complètes sur ma vie au Brésil, sur ma façon de m’habiller, de manger, de parler. En vrai reporter parisien, l’auteur s’étendait longuement, bien entendu, sur mes amours ! Oui, j’aimais ! J’aimais une négresse ! Et j’en avais même eu un beau petit négrillon ! Le lecteur, malgré tout, doutait ? Douter ? Mais la photo est là ! La photo de mon fils, le petit nègre, un moutard de trois ou quatre ans, l’œil rond, des mèches de cheveux crépus s’étendant sur son crâne comme un tapis de mousse ! Ma belle-mère, sainte dame du Périgord, sursauta, au petit déjeuner, en lisant ces révélations assez inattendues dans son quotidien habituel ! Ce petit-fils de la main gauche ne lui plaisait vraiment pas du tout. J’eus bien de la peine à lui faire savoir que je n’avais jamais, de ma vie, mis les pieds au Brésil, qu’aucun négrillon n’était entré dans la famille. N’importe. Trente fois, cinquante fois, il m’a fallu apprendre que j’étais à Caracas, à Valparaiso, à Cuba- où un pauvre diable fut mis en tôle à ma place ! – et même dans les soutes du navire Monte Ayala, arraisonné en haute mer par les Américains, à la fin du mois d’août 1946 – donc quinze mois après la guerre ! – et ramené au port de Lisbonne, où il fut fouillé de fond en comble pendant plusieurs jours : un policier américain remonta même la cheminée du bas en haut pour voir si je n’étais pas agrippé dans la suie ! Un rapport d’un service secret me décrivait pénétrant dans un bois avec un colonel portugais ! L’Intelligence Service m’avait repéré à Gibraltar ! D’autres journalistes m’avaient suivi au Vatican ! D’autres, dans un port de l’Atlantique, où j’achetais des canons ! On me vit même à Anvers, où, paraît-il, j’étais allé respirer l’air du pays. De temps en temps, c’est vrai, j’étais découvert par un ahuri ou par un fidèle qui me tombait dans les bras en pleurant. J’en étais quitte pour reprendre mes cliques et mes claques et de filer ailleurs. J’ai rencontré parfois aussi des ennemis. Ce fut toujours drôle. Ils avaient réclamé ma tête à cor et à cri, et brusquement ils étaient devant moi. Stupéfaction d’abord. La curiosité l’emportait. En deux mots amusants, l’atmosphère se dégageait. J’ai même eu, un jour, la surprise de me trouver assis, dans un petit restaurant populaire, à côté d’un des chefs les plus en vue du parti socialiste belge, un Liégeois. Je n’avais pas fait attention. Lui non plus. Il était attablé avec une grande fille blonde carrossée comme une Mercury. Je lisais ma gazette. Je relevai le nez, croisai son regard. Il fut, une seconde, abasourdi. Puis il sourit, me fit un clin d’œil. Lui non plus ne me conduirait pas au gibet ! Les seuls qui me traquèrent, partout,, avec une haine vraiment diabolique, furent les Juifs. Le gouvernement belge, bien sûr, me poursuivit longtemps avec hargne. Il réclama vingt fois mon extradition. Mais, tout de même, Spaak, le ministre des Affaires étrangères, n’osait pas aller trop fort. Il n’était pas droit dans ses bottes. Il avait tout fait, en juin et en juillet 1940, pour obtenir des Allemands de pouvoir rentrer dans le Bruxelles de l’Occupation. Il les avait bombardés de télégrammes, mettant en branle, à travers l’Europe, toutes ses relations. J’étais très au courant de ces manœuvres. Son copain et Président, l’ex-ministre socialiste de Man, m’avait même communiqué les lettres que Spaak écrivait, à Bruxelles, à sa femme, pour qu’il lui fît obtenir d’Hitler l’autorisation de rappliquer. Henri de Man a toujours eu un faible pour toi ! écrivait Spaak à son épouse pour l’exciter à aller trouver ledit Henri, qui, l’œil sardonique, s’esclaffait en lisant à ma table ces propos ! Hitler n’accepta pas la demande de Spaak, dix fois répétée. C’est pourquoi Spaak fila à Londres. Mais sans l’opposition d’Hitler, il fût bel et bien entré dans le système, comme de Man y était entré, dès le mois de mai 1940. Quant aux Juifs c’est une toute autre affaire. Jamais REX, avant la guerre, n’avait été vraiment antisémite. Les manœuvres bellicistes des Juifs m’indignaient, c’est vrai. C’est vrai aussi que je ne les porte pas spécialement dans mon cœur. Ils me tapent sur le tempérament. Mais je les laissais plutôt tranquilles. A REX, ils pouvaient faire partie du mouvement comme n’importe qui. Le chef de REX-Bruxelles, lors de notre victoire de 1936, était un Juif. Même en 1942, en pleine occupation allemande, le secrétaire de mon remplaçant, Victor Mattys, était juif. Il s’appelait Kahn, c’est tout dire ! Des camps de concentration, des fours crématoires, j’avais tout ignoré. N’empêche que les Juifs se sont mis dans la tête, après la guerre, qu'un grand mouvement antisémite avait été reconstitué à travers le monde, et que j’en étais le chef. D’abord, je n’en étais pas le chef. Ensuite, que ce soit regrettable ou non, il n’existait pas. Donc pas question de persécutions ni d’organisations antijuives. Voilà vingt-cinq ans que les chrétiens se tiennent peinards. N’empêche que, pour décapiter, en me liquidant, une organisation absolument inexistante, des dirigeants juif, du plus haut niveau, appartenant notamment à la direction de la Sûreté générale de l’Etat d’Israël, ont monté contre moi expéditions de rapt sur expéditions de rapt. Rien ne manquait : la grande Lincoln noire au bac arrière reconverti en une sorte de cercueil à narcotique, dans lequel on me transporterai inconscient ; le bateau qui m’attendait à la côte proche, pour me conduire à Tel Aviv ; cinq revolvers pour me trucider si je résistais ; six millions pour payer les complices ; les plans complets de mon logis et de ses accès. La nuit précédentes, les lignes téléphoniques et électriques avaient été coupées sur ma colline, les chiens des propriétés voisines avaient été empoisonnés. Il s’en fallut de peu, par un juillet brûlant de soleil, que je n’y passasse. Les agresseurs israéliens, conduits par un Juif très connu, le journaliste Zwij Aldouby, se firent cueillir, armés jusqu’aux dents, alors qu’ils étaient sur le point de réussir. Ils furent condamnés à huit, dix et douze ans de prison. Une autre opération fut montée, presque simultanément, au moyen d’un hélicoptère, au départ d’un port marocain. Quelques années plus tard, un nouveau rapt-assassinat fut tenté. Cette fois, les agresseurs juifs étaient arrivés par mer, venant d’Anvers. Ce fut une Juive même qui informa du complot une de mes sœurs, voulant me remercier, dit-elle, de lui avoir sauvé la vie pendant la guerre. A cette époque-là, j’ai, comme tout le monde l’eût fait, essayé de sauver tous les gens dont j’avais su qu’il étaient inquiétés. Mais je ne dressais pas de listes pour l’après-guerre ! Si bien que je ne me souviens même pas de cette Juive que je sauvai alors et qui me sauva par la suite ! Son avertissement tomba à pic, les trois expéditionnaires se firent coffrer, à peine débarqués. Mais c’est râlant. Chaque fois, il me fallait déménager, plonger dans des propriétés campagnardes de vieux amis, voire dans une brasserie ou, pour de longs mois, dans une cellule, pas rigolote je vous prie de le croire, d’un cloître bénédictin. Je me souviendrai longtemps des Benedicamus Domino hurlés à cinq heures du matin par le réveilleur de service ! Mais décamper sans cesse, veut dire aussi impossibilité de gagner sa croûte, d’avoir une occupation fixe où que ce soit, ou simplement d’avoir un toit, si l’on est toujours menacé et si l’on doit toujours filer ailleurs. Les interviews des journalistes n’ont pas manqué, elles aussi, de compliquer ma vie de proscrit, en rappelant souvent et intempestivement l’attention sur mon nom. De ces interviews, on en a publié des dizaines, toutes inventées comme des romans policiers. Deux fois, il y a bien longtemps, j’ai reçu dans mon refuges des « envoyés spéciaux » qui ont ensuite présenté mes déclarations tout à fait de travers, alors qu’ils m’avaient promis, bien sûr, de m’envoyer les textes pour accord préalable ! J’ai fui, depuis lors, les journalistes comme la peste ! On est toujours refait par eux car leur objectif est différent : ils cherchent du sensationnel, à publier rapidement. Mais la vérité ne s’expose pas sous des titres d’une main de haut, à une telle vitesse. Une seule fois, une revue a publié une véritable interview de moi. Elle le désirait. Je désirais, moi, faire croire à ce moment-là que j’étais à Buenos Aires dans une clinique. Le texte parut dans son intégralité. La revue savait parfaitement [196] que nul reporter de son équipe ne m’avait vu, et que je n’étais à Buenos Aiers en aucune façon. Que lui importait ? Le principal, c’est que le public pousse des oh ! et des ah ! tout au long de la lecture ! On lui explique bien ce que M. Onassis et l’ex-Mme Kennedy font dans leur lit, et l’état des ovaires, avec dessins à l’appui, de la reine Fabiola, alors que nul, dans ces rédactions, n’est valet de chambre ou infirmier de service ! Quand le journaliste se déplace, c’est parce qu’il veut s’aérer aux frais de la princesse et dresser des frais de route nettement encourageants. Il hume un peu l’air, rend hommage aux beautés peu farouches du cru, puis rédige sa copie à toute vitesse et à la diable. Il ne reste plus qu’à toucher les « piges ». Mais, l’exilé, lui, comment voit-il le public ? Lui aussi, avec le temps, ne va plus imaginer qu’un public irréel, inexistant. Il lui prête une façon de penser qu’il n’a pas, qu’il n’a plus. Il a perdu le fil de l’évolution. Tout change, et il ne sait pas que tout a changé. Le monde n’est plus comme il l’était, les gens ne sont plus comme il les a connus. Comme n’importe quel vieil industriel dépassé par la vie moderne, il devrait se réadapter. Il continue à croire que les méthodes de jadis sont toujours valables, qu’on se passionne encore pour elles, et surtout pour lui. A qui s’intéresse-t-on encore au bout de quelques années ? Les gens s’éclipsent. Les événements se succèdent. Chacun d’entre nous projette le précédent dans la fosse de l’oubli. l’exilé reste convaincu qu’il est encore sur l’estrade de l’actualité. Or, le rideau a été baissé depuis longtemps. Il attend que renaissent les applaudissements, comme si le public était toujours devant sa tribune, ne se rendant pas compte que les années l’ont poussé dans les coulisses. Ce quiproquo est souvent pénible. Qui va dire à un exilé qu’il ne compte plus ? Il ne se rend pas compte. Surtout, il ne veut pas s’en rendre compte. Son sourire est souvent contracté, mais c’est sa dernière façon de se convaincre que l’avenir ne lui est pas bouché de façon définitive… Moi aussi, longtemps, j’ai cru à la survie. J’étais en pleine jeunesse. A trente-huit ans, je n’allais pas disparaître ainsi, à jamais, tout de même ! Eh bien ! si, on disparaît ! Les amis meurent au loin, l’un après l’autre. Le passé devient flou, comme un rivage qui se dilue puis, finalement, disparaît aux regards des navigateurs. Pour un garçon de vingt ans, qui n’était pas né quand nous avons sombré, qui sommes-nous ? … Il emmêle tout. Ou il ne sait même plus rien de nos histoires, qui ne le passionnent pas plus que les moustaches rugueuses de Vercingétorix ou les dents cariées de Louis XIV. Ce n’est pas tout : il y a de la bousculade dans le métier. Les exilés se succèdent, s’empilent les uns sur les autres. Déjà les Peron, les Trujillo, les Batista, les abbés Fulbert Youlou, vaincus bien après nous, ne sont plus que des silhouettes, à peine décelables. Les noms des Lagaillarde, des Ortiz, et même des Bidault et des Soustelle, les deux dernières vedettes politiques de l’affaire d’Algérie ne disent plus rien, au bout de cinq ans, à 90% des Français. Nous sommes au siècle de la vitesse. Pour disparaître du champ visuel du public, aussi, ça va vite. Même pour des gens très informés, un homme politique exilé depuis vingt-cinq ans est devenu un être presque irréel. Ils le croient disparu. Ou ils ne croient plus qu’il existe encore. Un soir, j’étais invité à dîner chez une sommité médicale, connue universellement, et très proche du chef de l’Etat dans lequel je résidais à ce moment-là. Des personnages très en vue entraient. Chacun de ces incités m’avait connu à diverses étapes de mon exil, et sous des noms différents. Pour l’un, j’avait été Enrique Duran, polonais (un drôle de nom polonais !) Pour l’autre, Lucien Demeure, français. Pour l’autre Juan Sanchiz. Pour d’autres, Pepe, sans plus. J’étais las de déployer, à chaque pognée de main, cette panoplie de faux noms. Lorsque entra un gros banquier que je n’avais jamais rencontré, je n’hésitais plus et me présentai sous mon vrai nom : Léon Degrelle ! L’autre me regarda, amusé. – Et moi, Bénito Mussolini ! Je dus suer avant de le convaincre que j’étais bien qui j’étais, et que je ne lui avais pas monté une blague ! Ainsi, avec le temps, l’exilé glisse dans le vague ou dans l’oubli. Il est passé des Mercedes du pouvoir au métro malodorant de l’exil. Il faut du temps aux plus lucides pour se faire une raison. L’exilé préfère s’accrocher. Il a cru à quelque chose qui fut, à un moment de sa vie, exceptionnel. Il souffre horriblement d’être passé de cet exceptionnel à l’ordinaire, au restaurant banal à prix fixe, au linge de quatre sous. Le grand rêve disloqué, désintégré, le travaille. Il se reprend souvent à croire que, tout de même, on ne sait jamais, quelque chose pourrait rejaillir. Quelque chose, oui. Mais nous, non. Nous, c’est fini. Autant s’en rendre compte virilement et dresser le bilan. Les fascismes ont marqué leur temps, et l’avenir au-delà de leur temps. C’est cela qui compte. Qu’ont-ils laissé ? Qu’ont-ils changé ?
Indépendamment de nos vies personnelles, si bruyantes de dynamisme
jadis, éliminées désormais, le vrai problème qui se pose est celui-là : de cette
grande Aventure – ou Epopée – des fascismes, une fois les tombeaux clos, que
reste-t-il ? et que restera-t-il ? |
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!