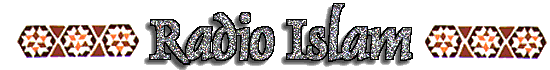
HOME
Léon Degrelle
( 15-6-1906 à Bouillon en Belgique- 31-3-1994 à Malaga en Espagne)
Qu´importe de souffrir si on a
eu dans
sa vie quelques heures immortelles.Au moins, on a vécu!

L’Europe éclate
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
Si vous aviez pris à temps le pouvoir en Belgique, eussiez-vous pu
empêcher la Deuxième Guerre mondiale ? Eh bien, cet « alors » n’est pas aussi problématique qu’il puisse paraître au premier abord. Entre les deux blocs d’Europe occidentale qui allaient s’empoigner à bras-le-corps, le seul pays capable de constituer une barrière, ou un lieu de rencontre des grands rivaux, était, tout de même, la Belgique. Installé à la tête de l’Etat, disposant du seul moyen de propagande internationale qu’était, à l’époque, la radio, il eût été possible, accroché au micro chaque jour, de contrecarrer, dans la France du Front Populaire, les violentes campagnes bellicistes qui cherchaient à dresser définitivement Paris contre le Troisième Reich. Les bellicistes français n’étaient qu’une minorité. Une toute petite minorité. On le vit lors des accords de Munich en septembre 1938, à la suite desquels le signataire français, le ministre Daladier, honnête pochard cultivé, qui s’attendait à être étoilé de tomates et d’œufs peu frais en débarquant à l’aérodrome du Bourget, fut acclamé par le peuple parisien, avec une frénésie qui le laissa bégayant et pantois. On le vit encore lors de la guerre de Pologne. Le Français, malgré les grands coups de pinard de rigueur, partit aux armes en renâclant. Il combattit mal en 1940, non seulement parce que la stratégie j’Hitler surclassa ses états-majors, empotés et en retard d’un siècle, mais parce qu’il ne comprenait rien aux buts de cette guerre, et que le moral n’y était pas. Eclairé chaque jour, dès 1936, le peuple français eût, peut-être, compris le problème de la réunification d’un Reich morcelé peu intelligemment après 1918. Il est vif d’esprit. Politiquement, il saisit le raisonnable. Il eût pu se rendre compte que le mieux serait de proposer lui-même, à temps, un règlement total, sur des bases justes, du problème des frontières allemandes et notamment de Dantzig, ville séparée arbitrairement du Reich, qui votait à 99% pour Hitler, et à qui, au nom de la « démocratie », on interdisait de rejoindre la patrie de son histoire, de sa race, de sa langue, et de son choix. Alors, à quoi rimait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? D’autre part, Dantzig était le goulot par lequel passait la vie maritime de la nouvelle Pologne. Il était impensable, évidemment, qu’un grand pays comme l’Allemagne restât à jamais coupé en deux, que ses habitants continuassent à ne pouvoir se rejoindre que dans des wagons plombés, à travers un territoire étranger. La Pologne, pour sa part, avait le droit de respirer, de pousser sa trachée artère jusqu’à la Baltique. Néanmoins, cet imbroglio du Corridor polonais n’était pas un remède. La solution d’un plébiscite amical, polono-allemand, était relativement simple, qui eût garanti à chacun des deux pays, qu’il fût vainqueur ou qu’il fût vaincu dans la compétition électorale, un accès libre au moyen d’une autoroute unifiant les deux parties du Reich, si les Allemands perdaient, joignant la Pologne à la mer Baltique, si les Allemands gagnaient. La recherche d’une solution pareille, ou assez semblable, ou même différente mais satisfaisant les parties en cause, était certainement plus facile à mettre en forme que les plans de cohabitation imposés en 1919 à des peuples très différents, rivaux parfois, ennemis souvent : à des millions de Tchèques, de Slovaques, de Ruthènes, de Hongrois, sur l’ancien glacis bohémien ; à des millions de Polonais, d’Ukrainiens, de Juifs et d’Allemands, au sein d’une Pologne hybride, sans majorité nationale. Ou à une Yougoslavie de Croates, de Serbes et de Bulgares qui se haïssaient et qui rêvaient plus de se dépecer que de s’embrasser. Mais, voilà, il ne fallait pas, pour envisager une solution valable au cas du couloir de Dantzig, attendre qu’on fût arrivé au 30 août 1939, alors que déjà les moteurs de quelques milliers de chars ronflaient tout le long de la Prusse orientale, de la Poméranie et de la Silésie ! La France a donné, de son habileté diplomatique, des preuves éclatantes, avant 1914, en liquidant les inimitiés anglo-françaises, en nouant l’alliance franco-russe ; elle les renouvela sous de Gaulle en se dégageant de la politique des blocs. La même habileté eût pu, tout aussi bien, en 1936, aider à préparer une liquidation pacifique du casse-tête allemand. Et puis l’Hitler de 1936 n’était pas l’Hitler rugissant de 1939. Je l’ai rencontré longuement à l’époque, car l’intérêt de mon pays, terre d’entre-deux, était de nouer des relations intelligentes et précises avec les meneurs du jeu européen. C’est ainsi que je vis discrètement tous les principaux hommes d’Etat d’Europe, qu’ils fussent français, comme Tardieu et Laval, ou italiens comme Mussolini et Ciano, ou allemands comme Hitler, Ribbentrop et Goebbels, ou espagnols comme Franco et Serrano Suner, ou anglais comme Churchill et Samuel Hoare. En août 1936, j’avais donc du longuement Hitler. La rencontre avait été excellente. Il était calme et fort. Moi, j’avais vingt-neuf ans, et toutes les audaces. « Jamais je n’ai vu de tels dons chez un garçon de cet âge », avait dit et répété Hitler à Ribbentrop et à Otto Abetz après notre entrevue. Je cite ce jugement, non pour me planter dans l’arrière-train des plumes de paon, mais pour que l’on voie que les atomes crochus avaient fonctionné, que la conversation que je lui avais tenue, pendant plusieurs heures, Ribbentrop présent, l’avait intéressé. Or, que lui avais-je proposé ? Ni plus ni moins qu’une rencontre Léopold III-Hitler, à Eupen-Malmédy, autre terre séparée de l’Allemagne par le traité de Versailles, au profit de la Belgique cette fois, après un plébiscite truqué : ceux qui n’étaient pas d’accord avaient été obligés de faire connaître leur opposition par écrit, en apposant leur signature sur un registre public, répertoire redoutable de suspects futurs ! Dans ces conditions, qui eût signé ? Toutes les cloches de Belgique avaient eu beau sonner pour fêter ce soi-disant rattachement ! A longue échéance, de tels procédés étaient indéfendables. Il fallait, à mon avis, prévenir les réclamations et enterrer la hache de guerre là-même où existait une possibilité de la brandir. Hitler avait été immédiatement d’accord sur ma formule : un plébiscite dont la campagne préparatoire se limiterait à une assemblée des populations locales en face de deux chefs d’Etat qui viendraient ensemble sur les lieux, expliqueraient publiquement leur point de vie, en toute courtoisie ; une seconde assemblée, identique, se tiendrait après le plébiscite pour que, quel qu’en fût le résultat, les deux chefs d’Etat y scellassent la réconciliation de leurs deux peuples. Si Hitler se ralliait à une solution si pacifique – qui plus aussi d’ailleurs à Léopold III quand j’allai lui en faire part – il eût pu, à plus forte raison, accepter, en 1936, un débat concernant l’ensemble des frontières autrichiennes, tchèques, danoises, etc. et, notamment, un arrangement à l’amiable avec une Pologne, réconciliée de puis 1933 avec le Reich et amie, d’autre part, d’une France qui eût été, en cette occasion, l’agent rêvé d’un règlement définitif. Peu avant, le maréchal Pétain et le maréchal Goering s’étaient rencontrés, en Pologne précisément. Rien de sensé n’était donc impossible. Il n’était pas d’hommes d’Etat qui n’avait déploré, dès 1920, l’inintelligence des décisions prises, à la suite de la Première Guerre mondiale, au sujet de Dantzig, du Corridor et de la Silésie. Les décisions imposées alors avaient été injustes, basées sur des dictats et sur des plébiscites faussés. Etudiée posément, une solution sage eût dû être présente bien avant même qu’il fût question de l’Anschluss et des Sudètes, d’autant plus que l’ambiance, en Pologne comme en Allemagne, était à la collaboration, à tel point que lorsque le président Hacha, répudié par les slovaques, eut confié, le 15 mars 1939, à Hitler, le sort de la Bohème, la Pologne du colonel Beck participa militairement à l’investissement, s’emparant de la ville et de la région de Teschen. Cette Pologne-là, bien conseillée, se fût difficilement refusée à un débat sérieux avec son allié de ce printemps même. Sans l’intervention provocatrice des Anglais à la fin d’avril 1939, promettant la lune au colonel Beck, homme taré physiquement et financièrement, cet accord eût été négociable. Des appels à l’esprit de compréhension des Français eussent pu être décisifs. Hitler avait renoncé publiquement et pour toujours à l’Alsace-Lorraine. Il ne désirait en aucune façon croiser le fer avec une France inassimilable, c’est-à-dire sans intérêt pour un conquérant. La France, de son côté, n’avait rien à gagner à une telle bagarre. Autant les terres fécondes de l’Est pouvaient tenter Hitler – et on eût même dû l’orienter et l’encourager dans ce sens, débarrassant l’Ouest, pour cent ans, du danger allemand – autant une guerre, stérile à l’avance, avec la France, avait cessé d’éveiller en lui le moindre désir. Un chef de gouvernement belge, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Français, expliquant aux Français l’importance vitale de leur rôle de conciliateurs, comme je l’eusse fait sans relâche, planté devant les micros de la Radiodiffusion, eût pu frapper en France les esprits. En tous cas, j’eusse tenté l’impossible. Je m’en voudrai jusqu’à la mort de ne pas avoir conquis le pouvoir à temps, même s’il ne m’eût offert qu’une chance minime de sauver la paix. Je l’eusse utilisée au maximum. La passion d’y parvenir m’eût dicté les mots qu’il fallait. Le peuple français est sensible aux orchestrations de la parole. Et il était mûr pour le langage que je lui eusse tenu. Le plus étonnant est que, si je n’ai pas pu prendre à temps, dans des mains fortes, un pouvoir que je n’eusse plus jamais lâché, on peut m’en croire, la proie m’échappa à cause d’Hitler, précisément. Ce sont ses interventions brusquées en Autriche, chez les Sudètes, chez les Tchèques, puis le début de la bagarre polonaise qui effrayèrent le public belge et mirent à mal mon ascension finale. Ce qui n’empêche qu’on m’a dépeint mille fois, à l’époque, comme étant l’instrument d’Hitler, le jouet d’Hitler. Je n’ai jamais été le jouet de personne, pas plus d’Hitler que d’un autre, pas même au cours de la guerre quand je luttais à côté des armées allemandes du front de l’Est. Les archives les plus secrètes du Troisième Reich l’établissent. Ni en 1936, ni plus tard, ni jamais, je n’ai reçu d’Hitler un pfennig, ni une consigne. Jamais, d’ailleurs, il n’a essayé de m’influencer en rien. Au contraire, par la suite, lorsque les incertitudes politiques de la guerre m’angoissaient, je lui en ai dit « des vertes et des pas mûres ». Son principal traducteur, le docteur Schmidt, qui assistait comme interprète à nos entrevues, a raconté lui-même, dans la presse, après la guerre, comment je parlais au Führer avec une vigueur et une crudité que nul autre n’osa jamais employer avec un tel interlocuteur. Il encaissait très bien, avec une bonne humeur cocasse. - Léon, me disait-il pendant la guerre, lorsque j’exigeais tout pour mon pays et refusais tout en son nom, finalement ce n’est pas vous qui collaborez avec moi, c’est moi qui collabore avec vous ! Et c’était assez vrai. Notre pays, parce que trop petit, risquait, dans une Europe mal définie, de perdre sa personnalité. Toujours j’ai exigé que le caractère propre de notre peuple soit respecté en tout : son unité, ses coutumes, sa foi, ses deux langues, son hymne national, ses drapeaux. Je n’ai jamais toléré, tout au long de la campagne de Russie, qu’un Allemand, si sympathique fût-il, exerçât un commandement parmi mes unités, ou simplement nous parlât en allemand. Nous devions d’abord nous affirmer. Après, on verrait. Même chez Hitler, je ne menais mes conversations qu’en français (qu’Hitler ignorait), ce qui me donnait, entre nous, le temps de bien réfléchir pendant qu’on traduisait la répartie, déjà comprise. Hitler n’était pas entièrement dupe. - Fuchs ! (renard), me disait-il un jour en riant, après avoir décelé dans mon œil un regard malicieux. Mais il ne se formalisait pas de mes subterfuges et me laissait soupeser à l’aise chacun de mes propos. En 1936, toutefois, on n’en était pas là. Hitler était encore pour nous un Allemand lointain. L’ère des grandes opérations de regroupement germanique n’était pas encore entamée. La réoccupation de la rive gauche du Rhin, logique, et qui eût dû être concédée aux Allemands longtemps auparavant, n’avait pas fait spécialement de malheurs. Elle avait été rapidement passée au compte des profits et pertes. Au moment de la victoire de REX (mai 1936), le baromètre de l’Europe était plutôt au beau temps. Au cours de notre campagne électorale, le nom d’Hitler n’avait pas été évoqué une seule fois par un contradicteur. On s’en était tenu, dans tous les partis belges au combat, à des problèmes de politique intérieure. Notre programme d’alors – les textes jaunis par les ans existent toujours – parle longuement et durement du balayage des vieux partis politiques, de la réforme de l’Etat (autorité, responsabilité, durée), du socialisme à édifier, de la haute finance à mater. Mais il n’y est même pas question d’une ébauche de programme international. Pendant de longs mois encore après notre victoire de 1936, notre position se limita à prôner une politique de neutralité qui dégagerait notre pays de toute alliance dangereuse – de Gaulle a-t-il agi autrement, plus tard, face aux deux « blocs » de l’après-guerre ? – et maintiendrait notre patrie à l’écart des querelles qui commençaient à gronder entre les démocraties d’ancien style (France, Angleterre) et les démocraties d’ordre nouveau (Allemagne, Italie). Sous notre impulsion, cette politique de neutralité devint rapidement – et officiellement – celle de la Belgique. Dans tout cela, rien donc qui marquait une orientation internationale du rexisme dans un sens prohitlérien. Certaines grandes réformes du national-socialisme et du fascisme nous intéressaient vivement. Mais nous les examinions en observateurs, sans plus. A dire le vrai, mes affinités étaient françaises. Ma famille était de là-bas. Ma femme était de là-bas et avait conservé sa nationalité. Mes enfants pourraient opter un jour pour le pays de leur choix. Ils ont, depuis lors, tous opté pour la France. De 1936 à 1941, je me suis rendu une seule fois à Berlin mais cent fois à Paris ! Aussi, pas question de main de l’Allemagne, d’argent de l’Allemagne, de mots d’ordre de l’Allemagne ! Nous étions neutres. Ni avec l’Allemagne, ni avec la France : la neutralité la plus rigoureuse, face à une bagarre où notre pays n’avait rien à gagner et où, pris entre les deux battants agités avec violence, il ne pouvait que recevoir de mauvais coups, des uns comme des autres. Toutefois, au printemps de 1936, une telle empoignade n’était pas encore inscrite nettement à l’ordre du jour européen. Nous connûmes quelques semaines de répit. Puis, au cours de l’été, l’avalanche dégringola. D’abord, en France. Le Front Populaire l’emporta électoralement. Le pouvoir passa au chef de la coalition des gauches. Léon Blum, ennemi par ses convictions marxistes et par judaïsme, de tout ce qui était hitlérien. Sa hargne – et l’aveuglement que donne la hargne – étaient tels qu’il avait prédit l’échec d’Hitler juste avant que celui-ci arrivât au pouvoir ! Une série de ministres de son équipe, hommes et femmes, étaient juifs également. On ne peut pas dire que leur passion de la France était exagérée : l’un d’eux, Méphisto à lunettes, nommé Jean Zay, avait même, précédemment, traité le drapeau français de « torche-cul ». Mais leur passion antihitlérienne était, elle, forcenée, sans limites. La tension monta aussitôt. Les campagnes de haine et de provocation antihitlériennes, sous de telles inspirations, s’épandirent vite et efficacement. Appuyé à fond par la propagande israélite, le Front Populaire se rua contre quiconque, à l’étranger aussi bien qu’en France, était de droite. Il me fit décrire, dans sa presse, uniquement parce que j’étais neutraliste, comme un suppôt d’Hitler. Il fit donner à fond contre moi les agents secrets du Deuxième Bureau français, extrêmement nombreux et actifs en Belgique, où ils déversaient abondamment, dans la presse et les milieux mondains, déplumés et avides d’argent de poche, les millions de la corruption. Un mois plus tard, deuxième décharge électrique : l’Espagne nationale se dressait contre le Frente Popular, frère chéri du Front Populaire français. L’Espagne et la Belgique, n’étant pas voisins, n’avaient et ne pouvaient avoir, en rien, d’intérêts opposés. Le soulèvement était juste, sain, nécessaire, comme l’épiscopat espagnol puis le Vatican allaient le proclamer l’année même. La guerre civile est le dernier recours, mais les fureurs du Frente Popular avaient acculé l’Espagne nationale à ce dernier recours. La Phalange, d’inspiration catholique, était très près du rexisme, politiquement et spirituellement. Moi-même avais été nommé, en 1934, par José Antonio Primo de Rivera, n° I de la Phalange de l’extérieur. L’armée espagnole, qui s’était soulevée, défendait les mêmes idéaux patriotiques et moraux que ceux du Rexisme. Et puis, quand même ! Si le Front populaire français, si les Soviets, si toute l’Internationale marxiste prenaient parti pour des incendiaires et des étrangleurs, s’ils les soutenaient frénétiquement, s’ils les comblaient d’avions français et de chars russes, s’ils leur envoyaient des milliers de recrues – des illuminés à la Malraux, des bouchers sanglants à la Marty, ou des fonds-de-tiroirs de prisons – pourquoi nous, patriotes et chrétiens, n’aurions-nous pas pu éprouver des sympathies pour des patriotes et des chrétiens, traqués et persécutés au long de cinq années de terreur et réduits à se dresser en armes pour survivre ?… N’empêche, un premier foyer de guerre européenne s’était allumé. Nul pompier n’apparaissait qui eût pu arroser le brasier naissant. Au contraire, l’incendie s’élargissait. Allemands et Italiens, communistes russes et Français rouges passaient des échanges de mots aux échanges d’explosifs, prétendaient se servir du champ de bataille espagnol pour régler au couteau leur contentieux. Internationalement, 1936 se terminait mal. Les nerfs étaient à fleur de peau : 1937 allait marquer, en Europe, le virage fatal. A partir d’alors, Hitler, qui n’avait guère à se préoccuper des plans électoraux du rexisme, allait régulièrement nous ficher dedans chaque fois que nous eussions dû renforcer notre action en gagnant de nouveaux votes et, grâce à eux, nous hisser pacifiquement au pouvoir. C’était, chez moi, une position bien arrêtée : pas d’accès au pouvoir par la violence. Jamais, en temps de paix, je n’ai porté sur moi une arme quelconque. On pouvait me voir à Bruxelles, où que ce fut, sans protection d’aucun ordre. J’allais à la messe, au restaurant ou au cinéma avec ma femme : c’était mon unique rempart, tout de grâce et de gentillesse. Je faisais des kilomètres dans les bois avec mes enfants. J’ai toujours éprouvé une horreur physique pour tout ce qui était janissaires ou gardes de corps. J’ai toujours cru à mon étoile. Il ne m’arrivera jamais rien. Et, de toute façon, un pistolet dans une poche de pantalon sortirait trop tard et n’empêcherait pas la casse. Le peuple a horreur de ces protections qui ont des airs de suspicion. Il faut se fier à lui, franchement. Je me rendais tout seul, en tramway, aux pires meetings rouges. Les incidents ne manquèrent point. Ils furent souvent cocasses. Mais ma méthode était la bonne. Le cœur du peuple est droit. C’est à ses sentiments d’hospitalité et d’amabilité qu’il faut faire appel, et non à une intimidation blessante. De même que je voulais gagner les masses par le cœur, sans recourir jamais à un étalage de forces, de même tout mon être s’opposait à un recours à la force armée pour me hisser au pouvoir dans mon pays. Cette force armée, je l’ai eu à ma disposition ; en octobre 1936, le chef le plus fameux et le plus populaire de l’armée belge, le général Chardonne, mit, par écrit, toutes ses troupes à ma disposition, m’offrit de les amener en trains spéciaux à Bruxelles. Le terrain eût été nettoyé en une heure par la division d’élite qu’étaient les Chasseurs ardennais. Le roi – son secrétaire l’expliqua à l’écrivain Pierre Daye, député rexiste – eût ordonné qu’on ne ripostât point. Je remerciai le général, mais me refusai à une telle opération. Sans aucun doute, si j’avais pu deviner comment les événements internationaux allaient me prendre de court, j’eusse accepté. Il y aurait eu très peu de résistance chez les nantis. Une fois ma décision prise, j’eusse, de toute façon, brisé tout obstacle sans exagérer les ménagements : le salut de mon pays et la paix de l’Europe eussent eu plus de prix à mes yeux que les criailleries de quelques dirigeants marxistes, promptement bouclés. Mais j’étais, tout au fond de moi-même, sûr de réussir sans recourir à une solution de force. La solution de mon goût, c’était la conviction, l’adhésion et le don consentis librement, dans l’enthousiasme. A vingt-neuf ans, des foules immenses s’étaient données à ma cause. Quelques mois plus tard, les chefs nationalistes flamands s’étaient ralliés à ma conception de la Belgique fédérale. Leurs députés et sénateurs, presque aussi nombreux que les miens, avaient fait bloc avec le rexisme. Pourquoi cette progression pacifique ne serait-elle pas menée sans violence jusqu’à la victoire définitive ? Encore une élection, deux élections, quelques campagnes populaires puissantes, et j’arriverais au pouvoir sans un coup de fusil, m’appuyant sur l’adhésion et l’affection de la majorité absolue de mes compatriotes ! J’ai bien failli y parvenir. Si je n’y suis point parvenu, c’est avant tout, et, par-dessus tout, je le répète, à cause d’Hitler, passé de l’ère du redressement intérieur du Reich, à l’ère des revendications internationales, rabattant dans tous nos pays les électeurs affolés vers les parapluies des anciens régimes conservateurs. Au début de l’année 1937, la bagarre s’était redoutablement aggravée en Europe, attisée de plus en plus violemment par les bravades incessantes du Front Populaire français. Hitler répondait à ses ennemis [68] en jetant vers eux les imprécations les plus bruyantes, les sarcasmes les plus cruels, les menaces les plus directes. En six mois, l’Europe se trouva coupée en deux camps. Non qu’elle s’y fût rangée : on nous y rangea. Nous qui n’avions aucun lien , d’aucun ordre que ce soit, pas plus politique que financier, avec le Troisième Reich, on nous jeta, comme un ballot sur un quai de gare, dans le clan allemand où, pourtant, nous ne voulions atterrir à aucun prix. J’entends toujours, à la sortie d’un meeting de gauche, pendant l’hiver 1936-1937, l’apostrophe : A Berlin ! C’était de la calomnie intégrale. N’empêche, je me retournai, inquiet, vers mes amis présents. – Mauvais, ce cri-là. Le lendemain, toute la presse marxiste le répétait. Désormais, nous serions catalogués, malgré nos protestations incessantes, comme les hommes de Berlin ! Mais la catastrophe suprême fut qu’Hitler, furieux des campagnes menées partout contre lui, avait commencé à perdre patience, à faire la grosse voix, à foncer ! Et, chaque fois, son rush, que ce fût vers le Danube autrichien, ou vers les montagnes des Sudètes, ou vers les jolis ponts baroques de Prague, tomba, toujours, comme automatiquement, en plein milieu des campagnes électorales de REX qui eussent peu entraîner définitivement le public belge derrière nous. Le Belge – et c’est compréhensible – avait conservé de l’invasion de 1914, qui avait été aussi injuste que cruelle, un souvenir horrifié. Chaque irruption militaire de la Nouvelle Allemagne dans un pays voisin, même si cette entrée avait été pacifique, même si elle avait été acceptée, voire accueillie dans l’enthousiasme comme en Autriche, mettait l’électorat belge en transes. A Berlin ! A Berlin ! nous lançaient en chœur, sûrs de l’effet du slogan, les propagandistes d’extrême-gauche ! Nous jeter lâchement cette calomnie à la face, c’était, en toute impunité, affoler le corps électoral, aussi bien wallon que flamand. A Berlin ! alors que ledit Berlin, par ses violences internationales, jetait invariablement la panique, au moment décisif, parmi le public que nous nous acharnions à conquérir. Lorsque je provoquai le Premier ministre belge, M. Van Zeeland, en 1937, à une véritable élection-plébiscite à Bruxelles, le hurlement « A Berlin ! » déferla durant toute la campagne. Elle se clôtura par un formidable coup de crosse que m’assena l’archevêque de Malines, plus antihitlérien encore que Léon Blum et que tous les comités juifs réunis. Le cardinal Van Roey était un colosse, paysan flamand taillé à la hache de silex, « taiseux », buté, répandant, sous ses atours, d’épaisses odeurs tenaces. Certains de ses fidèles qui ne l’admiraient qu’à demi l’avaient baptisé Le Rhinocéros. Timide, la Ligue de Protection des Animaux, n’avait pas protesté. Son palais archiépiscopal, d’un ennui accablant, était hanté de bossus, de bigles, de boiteux, valetaille lugubre et silencieuse racolée au plus bas prix. Face à l’escalier d’honneur en bois ciré, caquetait une volaille disparate. – Mes poules, murmurait lugubrement l’archevêque, visiblement sans penser à mal. Ce sont les seuls présentations auxquelles il se livrait. L’air éternellement renfrogné, il faisait preuve, en tout d’un fanatisme élémentaire, intégral, comme s’il eût dominé tribunaux de l’Inquisition et bûchers du XVIe siècle. Jamais il n’avait lu un seul exemplaire d’un journal non catholique. Rien que d’y penser le remplissait d’horreur, rendait plus maussade encore son visage embrouillé. Pour lui, un incroyant ne présentait pas le plus mince intérêt. Se poser des questions sur ce qu’un athée pouvait penser ne lui serait même jamais venu à l’esprit. L’incroyant était, dans son concept de l’univers, un être absolument insolite, un anormal. Il menait sa troupe archiépiscopale comme un sergent-major du Grand Frédéric eût conduit des recrues rétives à l’exercice. Il repoussait de sa godasse sacrée tout ce qui n’avait pas l’air confit, l’œil mi-clos, le nez tombant en banane, du frère lai se jetant à genoux, les bras en croix, devant la table de son supérieur, au plus minime manquement à la discipline. Aujourd’hui, on le mettrai, empaillé et préalablement désodorisé, dans un musée postconciliaire. Mais, alors, il régnait. En-dehors du problème de son impassibilité marmoréenne vis-à-vis des incroyants qui, spirituellement, me paraissait caricaturale et monstrueuse, nous avions, lui et moi, un œuf à peler, gros comme s’il avait été pondu par une autruche, une autruche aux œufs d’or. Pour une question de millions de francs chapardés à l’Etat belge, j’avais indisposé au plus haut point Son Eminence en démasquant – entre vingt autres – le scandale politique financier dans lequel s’était ébattu longtemps et parfaitement à l’aise, un ignoble petit requin de banque, nommé Philips, gnome cramoisi, au nez énorme surchargé d’une verrue violâtre et granulée comme une mûre. Ce Philips arrosait largement (six millions de francs en 1934) la hiérarchie ensoutanée qui constituait l’armature du réseau de propagande de sa banque. Il était d’autant plus généreux que, grâce à la corruption du parti catholique au pouvoir, il s’était fait accorder par les Etats (les collègues socialistes s’étaient fait adjuger, à la même époque, des subventions similaires en faveur de leur Banque du Travail en déconfiture) des « interventions » financières astronomiques. J’avais découvert le brigandage. J’avais traîné par les pieds les « banksters » au milieu de leurs immondices, les faisant tournoyer dans cette mélasse devant la Belgique entière. Philips n’avait pu faire autrement que de me poursuivre devant les tribunaux. J’avais gagné. A grands coups de balai, je l’avais vidé hors de la vie politique belge, le jetant littéralement à la porte du Sénat. Il s’était retrouvé sur le pavé avec son déshonneur, sa verrue violacée et la marque vigoureuse de mes bottes sur ses vieilles fesse tremblantes. - Excrément vivant ! lui avais-je crié, face à la foule, en lui signifiant son P.P.C. Or, ce vide-gousset était, très ostensiblement, le protégé et le protecteur du cardinal-primat de Belgique. Comme on dit, avec un certaine liberté de langage, hors des archevêchés, ils étaient comme cul et chemise. Le cardinal qui ne souriait à personne, souriait à cette fripouille hideuse comme à une apparition angélique. Leur intimité était telle que l’archevêque, casanier comme une rampe d’escalier, avait découché en son honneur, passant un week-end au château somptueux que le banquier s’était offert dans un gracieux vallon brabançon. Je possédais des photos des deux compères se promenant pieusement sous la charmille, sans qu’on sût très bien s’ils récitaient ensemble des psaumes bibliques ou s’ils discutaient moins séraphiquement de pourcentages s’échelonnant d’évêchés en doyennés. Quelques années plus tôt, alors que ce banquier était, politiquement, un inconnu, le cardinal Van Roey avait donné l’ordre aux parlementaires catholiques de le coopter comme sénateur, en lieu et place d’un éminent intellectuel de droite, Firmin van den Bossche, déjà choisi. Après cela, empoigner ce Philips par le fond de son pantalon, le défenestrer, le catapulter dans les airs jusqu’à ce qu’il s’abattît, à plat ventre, parmi ses millions inutiles, tenait, évidemment de la profanation ! Mon crime n’avait pas de nom. Tous les feux du ciel ne suffiraient pas à me faire expier cette liquidation impie. Comble des outrecuidances, je ne m’en étais pas tenu à ce traitement irrespectueux des soubassements de l’élu, de l’oint de Son Eminence. J’avais traité à la botte, avec le même feu sacré, quelques douzaines de collègues dudit sénateur, tout aussi cagots, ayant toujours l’air de transporter le Saint-Sacrement lorsqu’ils avançaient, pillards et paillards, parmi les coupe-gorge de la haute-finance. J’avais visé dans le peloton de tête, tirant à bout portant en plein dans la bobine du président du parti catholique, le ministre d’Etat Paul Segers, un petit sacristain vantard, toujours cocoricant, à la tête livide de cafard qui, entre deux oremus, avait abondamment puisé dans les caisses de l’Etat et, notamment, dans la caisse des petites gens, la Caisse d’Epargne. De la part du chef de ces grands bourgeois catholiques si satisfaits de leur haute moralité, une telle hypocrisie était particulièrement ignoble. Ils étaient les représentants typiques d’une élite pourrie qui jouait, le pouce au gilet, à la haute vertu. Je me ruai sur le Segers en question. Je fis irruption à la tribune où il présidait, l’Assemblée annuelle de son parti. C’était – les dieux, parfois, ont de l’humour – un 2 novembre, le Jour des Morts. J’avais amené avec moi trois cent gaillards décidés à tout. Le ministre Segers, entre ses quatre palmiers de la tribune officielle, fut traité par moi, durant une demi heure, comme un sous-produit d’engrais composé. Ce fut le plus grand scandale de la Belgique d’avant 1940. Comme Philips, et avec le même bonheur, Segers me cita devant les tribunaux, me réclamant trois millions de francs de dommage et intérêts, destinés à ravauder « son honneur ». Ravauder quoi ? Quel honneur ? A ces escrocs de la politico-finance, que restait-il qui, de loin ou de près, eût pu avoir encore un rapport quelconque avec l’honneur ? Le procès eut lieu. Non seulement je fus acquitté triomphalement (et Dieu sait si j’ignorais tout, alors, des « arrangements » de la Justice !) mais Segers, tout ministre d’Etat qu’il était, fut condamné comme un vulgaire aigrefin. - Vous êtes le drapeau du parti catholique ! lui avait crié, à la veille du procès, un sénateur nommé Struye, au buste de coiffeur de faubourg, surmonté d’une tête de crapaud à lunettes. Ledit crapaud, après la Libération, touché par une vocation tardive de tueur d’abattoir, se vengerait de la condamnation de son « drapeau » en envoyant au poteau d’exécution plus de cent de nos camarades. Le cas de la démocratie belge d’avant 1940 était le cas de tous les régimes démocratiques d’alors, débiles, c’est-à-dire offerts à toutes les tentations. Chacun d’entre eux connut à l’époque ses scandales : Barmat en Allemagne, Stavisky en France (tous deux juifs, soit dit en passant). Mais les polices se chargeaient, à chaque fois, de liquider la sale affaire avec une remarquable célérité. Barmat avait été retrouvé, au petit matin, mort dans sa cellule, et Stavisky, par un autre petit matin, s’était fait trucider, à bout portant, par la flicaille qui avait cerné, la nuit, sa villa de Chamonix, débarrassant ainsi de tout souci majeur la horde de l’argent de la France et avaient, en contre-partie, vécu de ses rapines. En Belgique – et nul ne me le pardonna jamais – je n’avais pas sauvé les Stavisky, wallons ou flamands, et n’avais pas toléré qu’on les sauvât. Au contraire, j’avais maintenu leur sales têtes pourries sous l’eau jusqu’à ce que la dernière bulle d’air eût fait surface. Mais à chaque fois que je liquidais un politicien véreux qui s’affublait du nom de « catholique » - ce qui me paraissait plus scandaleux que tout ! – mon nouveau crime était inscrit sur le calepin noir du cardinal. C’est pourtant lui, bon Dieu, qui eût dû les faire voler à travers les verrières de ses cathédrales ! Mais non, le coupable, c’était moi, qui, le balai au poing, traquais, en catholique sincère, les escrocs de la politico-finance, arc-boutés derrière les confessionnaux et les bénitiers ! Le cardinal était intervenu, en décembre 1936, au Vatican, pour décrocher une condamnation du Rexisme. Il avait échoué. Tapi derrière ses boiteux, ses bossus et ses bigles du palais de l’Archevêché, il me guettait. Il attendait l’heure. L’élection-plébiscite Van Zeeland-Degrelle du 11 avril 1937 allait lui offrir le virage au coin duquel, posé en silence, il me sonnerai au passage. En toute dernière minute de la campagne électorale, alors que toute riposte était techniquement impossible, il fit tout d’un coup tournoyer dans les airs sa crosse du Moyen Age. Avec une brutalité et surtout avec une intolérance que, bien sûr, nul public catholique n’admettrait plus aujourd’hui, il se jeta, mitre sur la tête, dans une bagarre strictement électorale, où le catholicisme n’avait strictement rien à voir, lançant urbi et orbi une déclaration fulminant interdisant en conscience de voter pour moi ! Ce n’était pas tout. Il interdisait en outre, et toujours en conscience, c’est-à-dire, sous peine de péché, de s’abstenir de voter ou de voter « blanc », ce que se disposaient à faire de très nombreux catholiques belges qui, non ralliés à REX, ne voulaient pas, tout de même, donner leurs voix au candidat mis en avant par l’extrême gauche et dont, au surplus, on commençait à chuchoter qu’il était, lui aussi, compromis dans une très vilaine histoire de finance. Le scandale éclaterait l’été même de son élection. On apprendrait alors que le poulain du cardinal n’avait pas hésité auparavant de s’approprier clandestinement, avec quelques complices, les traitements de hauts fonctionnaires de la Banque Nationale, bel et bien morts sur les listes de l’état civil mais que Van Zeeland et sa clique maintenaient en parfaite santé sur la feuille des émoluments de la Banque officielle de l’Etat belge ! Van Zeeland et ses collègues de brigandage appelaient cette caisse noire « la cagnotte ». Ils la vidaient sans vergogne chaque mois, volant l’Etat et volant, au surplus, par ricochet, le fisc à qui, on l’imagine, ils ne déclaraient pas ces revenus-détournements ! Les mœurs politico-financières des démocraties d’avant 1940 étaient telles qu’on pouvait parfaitement devenir Premier ministre après avoir utilisé des cadavres de fonctionnaires pour s’emplir les poches aux dépens de l’Etat ! La main sur le cœur, la bouche en cul de poule, le Van Zeeland en question s’offrait aux électeurs benoîts, pour représenter en leur nom la Patrie et la Vertu, mises en danger par le Rexisme ! Il fallait entendre le faux apôtre, plus rasoir que les millions d’appareils fabriqués par M. Gillette, compassé, pleurnichard, jouer au martyr démocratique : « Je m’avance calme et serein sur un chemin semé d’embûches ! » Essayez un peu de répéter dix fois à toute vitesse ce charabia caillouteux : « Je m’avance calme et serein sur un chemin semé d’embûches ! » Puis, il jetait des yeux attendris vers le ciel des Purs et des archevêques ! N’importe ! Ce détrousseur de macchabées bancaire fut, bel et bien, le champion européen numéro un de la lutte contre le « fascisme » avant la Deuxième Guerre mondiale ! Et, pour le sauver de la défaite électorale que les sondages du ministère de l’Intérieur laissaient clairement prévoir trois jours avant l’échéance, un cardinal n’hésita pas, à quelques heures de l’élection, à faire tournoyer sa crosse dans tous les sens, comme une massue de troglodyte. Il obligea sous peine de péché cent mille catholiques bruxellois à voter pour un pickpocket qui, l’année même, en octobre 1967 [sic, vrais. 1937], déraperait de tout son long dans le scandale de sa « cagnotte », devrait démissionner – pour toujours ! – de la présidence du gouvernement belge, cependant que plusieurs de ses collègues nécrophores de la Banque Nationale – un ministre d’Etat à leur tête – se suicideraient, à quelques jours d’intervalle, véritable ruban de saucisses bourrées de dynamite, sautant dans l’air, à Bruxelles et à Anvers ! Mais le 11 avril 1937, le « cagnottard » Van Zeeland, ruisselant de bénédictions, était monté vainqueur sur les autels de l’antinazisme. Il est clair que le fait d’être catholique fut, dans ma vie politique, un handicap considérable. Incroyant, je n’eusse pas été soumis à ces pressions abominables, à ce chantage aux consciences d’un haut clergé qui maniait la crosse comme un gourdin. Ou j’eusse envoyé ledit prélat politique voltiger dans les airs avec sa mitre, ses mules et sa matraque dorée ! J’eusse été moins fagoté, moins bourré de complexes, moins isolé, car le catholicisme de ces temps-là était étroit, vindicatif, incompréhensif, et même, souvent, provocant. Il dressait des barrières dans tous les sens. Il nous avait déformés. Il nous coupait de millions d’honnêtes gens. Et il nous exposait à des violences inouïes, comme celles de cet énergumène à crosse et à glands, tapant dans le tas, qui se croyait, de droit divin, maître omnipotent de tout, y compris de la liberté des électeurs. La Croix a vaincu la Croix Gammée proclama, le lendemain de l’élection de Van Zeeland, sur toute la largeur de sa première page, l’Intransigeant de Paris ! Un tel titre d’un journal franc-maçon en disait long ! Il répondait au Vive le Cardinal, nom de Dieu ! des marxistes belges, hurlé à Bruxelles le soir de leur victoire ! Léon Blum convia à Paris le triomphateur. Il fut reçu comme le Bayard belge dressé contre Hitler. Or – et cela aussi fut drôle, mais on ne l’apprit que plus tard – le principal bailleur de fonds de cet antihitlérien épiscopal avait été – exactement pour la même somme : six millions de francs – et au même moment, le bailleurs de fonds d’organisations hitlériennes en Allemagne. Il s’agissait du magnat de la soude, Solvay, qui, en hypercapitaliste accompli, finançait ce qu’il croyait être deux clans rivaux, pour avoir barre sur l’un comme sur l’autre, et se dédouaner de toute manière ! C’est sous ces millions de la duplicité et sous ces barils d’eau bénite coupée de fiel, sous ce déferlement de la calomnie A Berlin ! répétée sans fin par les bellicistes de Londres et de Paris, que je connus, lors de ce plébiscite Van Zeeland, et malgré que j’eusse obtenu 40 % de voix de plus que l’année précédente, mon premier échec électoral. Je culbuterais le même Van Zeeland six mois plus tard, après avoir révélé au public belge, dans toute son ampleur, le scandale de la fameuse « cagnotte ». Mais le mal était fait, la calomnie A Berlin ! m’avait coupé les jarrets, fauchant ma course. Sentant comment ce slogan frappait le public, la horde des marxistes belges lancée à mes trousses s’empressa de pavoiser la Belgique d’affiches où j’apparaissais coiffé d’un casque à pointe, comme les Allemands les portaient en 1914, à une époque où je n’étais qu’un garçonnet ! D’élection en élection, ce casque à pointe allait pavoiser de plus en plus les murailles de la Belgique, s’installer sur mon crâne à des centaines de milliers d’exemplaires. La presse marxiste n’hésita plus devant rien, pas même à recourir aux faux les plus grossiers. Elle publia des photos truqués où le chef de mes députés apparaissait sur le grand escalier d’honneur des concentrations nazies de Nuremberg, entre deux haies de drapeaux à croix gammée ! Nous retrouvâmes, dans les archives d’agences, la photo originale où se trouvai Hitler, au lieu de notre député ! Puis la photo de celui-ci, que l’on avait superposée à la précédente et qui avait été, elle, prise devant le parlement à Bruxelles ! Mais il ne servait vraiment plus à rien de s’indigner, ni même de protester. Les tribunaux faisaient la sourde oreille ou enterraient les dossiers. Plus rien d’autre n’existait que la haine des Allemands ! L’avant-garde des Allemands, pour le jour, tout proche, où la Belgique serait dévorée par eux, avec notre complicité ! La Deuxième guerre mondiale a eu lieu. Toutes les archives du Troisième Reich ont été saisies, épluchées. Nulle part on n’a découvert la plus infime trace d’un lien quelconque, ou même d’un contact quelconque de REX ou de moi, avant l’invasion allemande du 10 mai 1940, avec qui que ce fût qui appartînt à la diplomatie du Troisième Reich ou à la propagande du Troisième Reich. Depuis 1937, nous nous tenions à carreau, veillant – et c’était lamentable, car des contacts utiles dans tous les pays eussent été plus que jamais utiles – à ne jamais rencontrer, où que ce fût, un Italien ou un Allemand. Rien n’y fit. Au lieu d’avancer électoralement, il nous fallut reculer, tout en constatant, avec une inquiétude sans cesse accrue, que la Belgique était, comme toute l’Europe, prise désormais, par la folie antihitlérienne et qu’à l’heure de la prudence, de la réserve, elle se jetterait tête baissée vers le précipice. On put encore croire, en septembre 1939, lorsque la Pologne eut été envahie et que les Anglo-Français eurent déclaré la guerre au Reich, que la Belgique, s’en tenant officiellement à la neutralité, conserverait certaines chances de demeurer hors du conflit. Mais ces chances furent gâchées quelques semaines plus tard. Au début de novembre 1939, un accord avait été conclu entre le chef de l’armée française, le général Gamelin, et l’attaché militaire belge à Paris, le général Delvoie, accord clandestin, on l’imagine ! Un lieutenant-colonel français, nommé Hautecoeur, avait aussitôt été détaché en mission secrète en Belgique, près des plus hautes autorités, comme homme lige des chefs militaires alliés. Gamelin, depuis toujours, était un partisan résolu de l’entrée de l’armée française en Belgique, « voie unique », écrivait-il au Premier ministre Daladier, le 1er septembre 1949, en vue d’une action offensive, qui, ajoutait-il, écarterait la guerre des frontières françaises, particulièrement de nos riches frontières de l’Est. - « Il était, a expliqué par la suite Gamelin, pour se justifier (Servir, t.III, p. 243) du plus haut intérêt de chercher à souder au dispositif allié les vingt divisions belges dont l’équivalent ne pourrait être obtenu sur notre propres sol en raison de notre dénatalité croissante. »
De la part du généralissime Gamelin, la manœuvre était licite. Il était le chef de la coalition alliée et cherchait à gagner la guerre le plus sûrement possible et aux moindres frais. Il avait agi conformément à ces impératifs. « Le 20 septembre, nous avions décidé d’entrer en relation avec le gouvernement belge » (Servir, t. I, pp. 83 et 84). Nous, c’était Daladier, le ministre anglais de la production, Lord Hankey, et le ministre de la Guerre, Hore Belisha, juif comme par hasard. Cette décision avait été effective. « Au début de novembre, ajoute Gamelin, fort ingénu dans ses révélations, nous étions arrivés à un accord avec l’état-major belge. » (Servir, t.I p. 84) Nul ne pourrait se risquer à nier ces affirmations, si peu diplomatiques. « Le général Gamelin négociant secrètement avec les Belges », a précisé Churchill (L’Orage approche, p.89). « Il fut pourvu à la désignation d’officiers belges de liaison pour prêter leur concours aux Franco-Britanniques dès qu’ils auraient pénétré en territoire belge », a reconnu, tout crûment, mais huit ans plus tard, Pierlot, dans le journal Le Soir, du 9 juillet 1947, ajoutant : « quand les armées alliées entrèrent en Belgique, ce fut suivant les dispositions arrêtées d’avance et d’un commun accord. » En politique, presque tout est valable. Mais encore, ne fallait-il pas alors jouer officiellement aux champions de la neutralité, comme le faisaient avec tant d’éclat et d’hypocrisie le gouvernement belge ! Et surtout, celui-ci devait-il veiller à ce que des manœuvres à ce point tortueuses ne fussent pas découvertes ! On peut encore, en politique, se payer le luxe d’être fourbe, à condition, toutefois de ne pas se faire pincer ! Or, dès le début de novembre 1939, Hitler avait été exactement informé de tout : « Nos secrets, a reconnu mélancoliquement Gamelin, se trouvaient de bien des côtés perméables à l’espionnage des Allemands. » (Servir, t.I, pp. 96 et 97) Ce fut le cas, tout particulièrement en ce qui concernait son accord de collaboration secrète avec le gouvernement belge. Dès le 23 novembre 1939, Hitler en informa ses généraux, commandants d’Armée, au cours d’une réunion à la Chancellerie : « La neutralité belge en fait n’existe pas. J’ai la preuve qu’ils ont un accord secret avec les Français. » (Document 789 P.S. des archives de Nuremberg.) Il en avait même eu doublement la preuve. « Je l’ai su de deux côtés différents, la semaine même », me dit Hitler durant la guerre, un soir de confidences. Il avait reçu deux comptes rendus complets des décisions prises chez le généralissime Gamelin, le premier fourni par un informateur du Grand Quartier général allié, l’autre, par un confident qu’Hitler possédait au sein même du gouvernement français ! Hitler eût envahi sans doute la Belgique, de toute façon. Un petit pays n’allait pas faire dévier sa grande machine de guerre à l’heure décisive de la marche en avant. Mais si des scrupules l’eussent encore habité, il pouvait, dès novembre 1939, s’en débarrasser sans trop de remords, puisque la neutralité belge n’avait été qu’un mensonge et un leurre. Nous, Rexistes, ignorant tout de ces menées souterraines, peu reluisantes à dire la vérité, nous continuions à mener, en troupe sacrifiée, le combat national pour une neutralité qui restait, à nos yeux, l’une des ultimes possibilités de sauver la paix, possibilité non négligeable, même alors, comme le prouvèrent les échecs du gouvernement Reynaud qui, en pleine « drôle de guerre », ne se sauva de justesse qu’à une voix près (« et encore, elle était fausse », fit remarquer, par la suite, le président Herriot). Laval, son remplaçant presque certain, était disposé à négocier. Le soir, j’allais parfois retrouver le roi Léopold III à son palais de Laeken. Le général Jacques de Dixmude me guidait. Le souverain me recevait détendu, en culotte de cheval. Nous jetions ensemble les bases des campagnes de la presse rexiste, tendant à maintenir l’opinion belge dans une neutralité exemplaire. Je ne me doutais guère, toutefois, que dans le même fauteuil, s’asseyait, d’autres soirs, amené sur la pointe des pieds comme moi, le représentant secret en Belgique du haut commandement français ! Qu’eussent dit les Belges si, à la place de cet agent de Gamelin, un colonel de la Wehrmacht, en tant que délégué secret d’Hitler près du gouvernement dit de la neutralité, était venu s’asseoir ? Le double jeu était patent. Double jeu ou, plus exactement, triple jeu, car, en mars 1940, se rendant compte que l’affaire sentait le roussi, le roi Léopold III, se livrant à une nouvelle volte-face secrète, avait envoyé à Berlin chez le ministre Goebbels son homme de confiance, l’ex-ministre socialiste de [85] Man. Celui-ci me raconta lui-même, en août 1940, comment sa mission près du ministre nazi consista à faire comprendre aux Allemands l’intérêt qu’il y aurait pour eux à se glisser sur le côté sud de la Belgique et à foncer sur Sedan, la Somme et Abbeville. Hitler y avait pensé un peu avant lui ! Mais cela explique certaines choses. Et notamment pourquoi il eût il été difficile à Léopold III de filer à Londres le 28 mai 1940, sûr d’entendre, quelques heures plus tard, Goebbels déballer le paquet devant les micros ! Bref, tout était fichu ! Les dés étaient jetés. A force de provocations et d’incompréhension délibérée, les bellicistes d’Occident étaient arrivés à leurs fins, à faire sortir de sa tanière un Hitler mis à bout. Lorsqu’il s’agit des Soviets en 1954 (Budapest) et en 1968 (Prague), on eut d’autres ménagements ! La guerre « inutile et imbécile » (dixit Spaak) allait donc déferler.
Le 10 mai 1940, les palettes puissantes des blindés d’Hitler enfoncèrent
les portes de l’Occident, écrasant sous elles, durant plus de mille kilomètres,
des régimes démocratiques discrédités, tarés, irrémédiablement vermoulus. |
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
Qui est Léon Degrelle ?
Un grand résistant
contre la domination juive
Hitler pour mille
ans