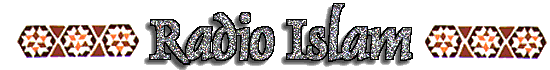
HOME
Léon Degrelle
( 15-6-1906 à Bouillon en Belgique- 31-3-1994 à Malaga en Espagne)
Qu´importe de souffrir si on a
eu dans
sa vie quelques heures immortelles.Au moins, on a vécu!

De Stalingrad
à San Sebastian
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!
|
Que penser de Paulus, le maréchal allemand qui, sombrant à Stalingrad à la fin de janvier 1943, entraîna dans sa noyade Hitler et le Troisième Reich ? Ce fut la déveine, ou plus exactement l’erreur d’Hitler – car c’est lui qui l’y nomma – d’avoir eu comme chef du Sixième Corps d’Armée, au point crucial de front russe et au moment où la guerre se joua, un homme qui n’avait aucune des qualités indispensables pour recevoir un tel choc, ou, tout au moins, pour mitiger le désastre. Ce désastre fut total, militairement et psychologiquement. On ne pouvait pas être plus intégralement vaincu que Paulus le fut. Et sa défaite ne pouvait avoir, dans l’opinion mondiale, une répercussion plus vaste. Pourtant, 300 000 hommes perdus, ce n’était pas la fin du monde : les Russes en avaient perdu vingt fois plus en un an et demi. D’immenses espaces restaient à Hitler en U.R.S.S. et en Allemagne de l’Est, où il pourrait manœuvrer, et où il manœuvra jusqu’à la fin d’avril 1945. L’Allemagne possédait toujours, en 1943, d’imposantes ressources matérielles et d’extraordinaires possibilités industrielles sur toute la surface de l’Europe occupée. A cette époque-là, Dniepropetrovsk, à des milliers [168] de kilomètres de la Rhur, brillait encore, la nuit, des feux éblouissants des fabriques de munition de la Wehrmacht. Et, protégées par leurs rideaux aériens de ballons, les usines esthoniennes [sic] d’Hitler continuaient à extraire du schiste l’essence la plus riche de la Luftwaffe. Pourtant, Stalingrad marqua la chute. Là fut rompue la cordée. On eût pu croire à une corde cassée, qui pourrait se réparer. Mais la rupture fut irrémédiable, suivie de la dégringolade toujours plus accélérée vers le gouffre. Hitler, en nommant Paulus à la tête du Sixième Corps, ne s’était pas imaginé que le militaire-fonctionnaire, pointilleux, indécis, qu’il détachait vers un grand commandement en Ukraine, serait, précisément, celui qui, de tous ses chefs de corps d’armées, allait devoir assumer, stratégiquement, les plus grandes responsabilités. Son corps d’armée avait, durant l’offensive de l’été 1942, reçu une zone de progression sans risques spéciaux. Foncer vers le Caucase, affronter, à plus de mille kilomètres du point de départ, les monts, les défilés, les eaux grondantes qui barraient l’accès des pétroles, était autrement risqué que de faire avancer des troupes, parfaitement aguerries, pendant quelques centaines de kilomètres entre le Dnieper et le Don, à travers des plaines à peine vallonnées, jusqu’à ce qu’elles atteignissent un fleuve très large, la Volga, qui pourrait former, aussitôt, la plus formidable ligne de défense naturelle de tout le front de Russie. Pourtant, c’est là que tout échoua et que tout craqua. N’importe quel autre chef militaire allemand, de la Wehrmacht ou de la Waffen S.S., - un Guderian, un Rommel, un Manstein, un von Kleist, un Sepp Dietrich, un Steiner ou un Gille – eût atteint Stalingrad en quelques semaines et s’y fût embastillé. Paulus était un haut fonctionnaire d’état-major, compétent lorsqu’il était à son bureau devant ses cartes, un faiseur de plans en chambres, un dresseur minutieux de statistiques. Ces gens-là sont nécessaires, mais dans leur spécialité. Par contre, il n’avait aucune idée du maniement réel d’une grande unité. Le plus haut commandement direct qu’il avait exercé avait été celui d’un bataillon, c’est-à-dire d’un millier d’hommes ! Et cela remontait à dix ans ! Ce commandement, très limité, lui avait d’ailleurs valu, de son chef, le général Heim, le jugement suivant : « manque de force de décision ». Or, Hitler allait, d’un coup, lui confier trois cent mille hommes ! Presque toute sa vie, Paulus l’avait passée parmi la bureaucratie des états-majors. Mais il était ambitieux. Sa femme, une Roumaine, assez comiquement surnommée Coca, mousseuse comme de la bibine du même nom, était encore plus ambitieuse que lui. Elle était d’une suffisance et d’une vantardise crispantes. A l’entendre, elle était de la plus haute noblesse balkanique, de sang royal proclamait-elle. En fait, elle portait le nom roturier et peu poétique de Solescu et son père, drôle de bonhomme, avait laissé tomber sa mère de longue date. Elle minaudait dans tous les salons. Elle bassinait, par ses demandes indiscrètes, tout ce qui comptait parmi l’état-major général, acharnée à voir son mari prendre, tout simplement, la succession du maréchal Keitel ! Hitler se fiait avant tout aux visages qu’il connaissait. Il voyait, à tout bout de champ, la tête sévère de Paulus penchée sur ses dossiers de chef des opérations. Il venait de procéder à de nombreux et brusques remaniements au front russe, détachant, pour relever des généraux trop vieux et sans mordant, les plus brillants des chefs dont il avait suivi les réussites pendant l’été. Il lui fallut remplacer, en outre, brusquement, le chef du Sixième Corps, le maréchal von Reichenau, frappé d’apoplexie dans les neiges du Donetz par 40° sous zéro. Pris de court, Hitler désigna le général Paulus, qu’il avait sous la main dans ses bureaux. L’homme fut absolument lamentable. Lorsqu’il fallut, en juillet 1943, entreprendre l’offensive vers la Volga, il eût dû foncer, courir comme tous nous courions. Il traîna, s’éternisa, se noyant dans des difficultés de détails, annulant ses décisions à peine prises, hanté en outre par des problèmes personnels vraiment dérisoires, dont les plus marquants furent, tout au long de la campagne, l’état déficient de son système intestinal ! Il est pénible de constater que le chef d’une grande unité au combat pouvait être littéralement absorbé, en pleine action, par des histoires à ce point misérables ! Tous nous avions la colique, sans faire tant d’affaires ! Bon Dieu, on se jetait vers les rares buissons de la steppe ! Trois minutes plus tard, on repartait en chantant, délesté, la boucle du pantalon resserrée d’un cran ! Mais Paulus inondait son courrier de ses incontinences intestinales ! Des centaines de milliers de soldats, qui avaient bu un bouillon de poule trop gras, ou une eau croupie, n’en appelaient pas, pour autant, au témoignage des Cieux et des Dieux ! Le courrier expédié par Paulus existe encore. Il déborde de descriptions désolées de ses diarrhées, de vieilles histoires de sinusites et de lamentations sur les difficultés matérielles qu’il rencontrait, comme chaque chef d’unité importante en rencontrait et qui n’étaient pas, dans son corps, plus dramatiques qu’ailleurs ! Au contraire, il avait la partie la plus facile. Sa marche était la moins longue, celle où les obstacles étaient les plus réduits et, en tous cas, les plus simples à réduire. Une fois l’objectif atteint, la Volga lui fournirait son énorme barrière d’eau de dix kilomètres de largeur et d’une dizaine de mètres de profondeur. Au lieu de cela, perdu dans les détails, rongé par les appréhensions et par ses ennuis de tripaille, Paulus s’éternisa dans sa démarche, laissant à l’ennemi le temps de se regrouper dès avant le franchissement de la dernière grande boucle du Don. Le fleuve fut traversé, mais avec quinze jours de retard. Plus rien n’empêchait sérieusement de donner le dernier coup de boutoir. Des fonceurs arrivèrent à la rive de la Volga même. Deux ou trois jours d’exploitation vigoureuse de cette percée et Paulus, du haut des falaises de la rive droite, n’eût plus eu devant lui qu’un fleuve vide et, dans son dos, la masse des dernières troupes soviétiques encerclées. Le maréchal soviétique Eremenko ne vivait plus, acculé, étouffé dans son ultime réduit de huit cent mètres, le derrière dans la Volga. Là encore, Paulus manqua complètement de mordant, se laissa bloquer à ces quelques centaines de mètres de la victoire finale, sombrant dans des opérations limitées, meurtrières, décevantes, comme s’il ne se souvenait que des combats de terrain, au mètre carré, devant Verdun en 1917. Tout devait desservir ce fonctionnaire dépassé par son rôle. Le secteur qui couvrait, au nord, le front de Stalingrad avait été imprudemment confié, dans sa totalité, à des contingents roumains et italiens qui se firent enfoncer dès le premier jour de l’offensive de novembre 1942, offensive que les Russes avaient préparée en grand secret dans leur tête de pont de Kremenskaia. L’observation allemande avait pourtant décelé leurs préparatifs, et des dispositions avaient été prises immédiatement pour renforcer le secteur menacé. Mais il était dit que pas une malchance ne serait épargnée à ce Paulus malchanceux. Les chars de la vingt-deuxième division blindée allemande, qui se trouvaient en réserve, avaient reçu d’Hitler, le 10 novembre 1942, c’est-à-dire neuf jours avant l’assaut des Soviets, l’ordre de rejoindre le secteur, jugé en danger, de la Troisième Armée roumaine. Ces chars au repos avaient été camouflés depuis un mois sous des meulards de foin. Sous ces abris, des rats – oui, des rats ! – avaient rongé, mangé, sans que nul ne s’en doutât, des centaines de mètres de fils et de câbles de l’équipement électrique !
Le Don formait, quand même, à l’ouest du secteur de Paulus, un deuxième barrage. Autre déveine incroyable : quand des chars soviétiques, fonçant à travers tout vers ce fleuve, apparurent à proximité du pont principal, à Kalatch, les défenseurs allemands les prirent pour des amis. Le pont ne sauta pas. En cinq minutes, le Don était franchi ! Dès alors, Paulus perdit la tête. Il se jeta même dans un avion pour aller se réfugier à un P.C. de secours, à Nijni-Tchirskaia, à l’ouest du Don, y gâcha des heures décisives, isolé de son état-major, dut revenir, sur ordre téléphonique d’Hitler furieux, hésita, plus énervé que jamais, ne sachant que décider. Il laissa se rejoindre dans son dos les colonnes de chars soviétiques descendant du nord et montant du sud, sans avoir pu imaginer une parade intelligente. Rien était encore perdu pour cela. Hitler avait immédiatement mis en route vers Stalingrad une colonne blindée de secours, sous le commandement du général Hoth, dépendant du maréchal von Manstein. On a décrit cent fois que le Führer avait abandonné Paulus. Rien n’est plus faux. Ses forces blindées arrivèrent jusqu’à la rivière Mischkova, à quarante-huit kilomètres du sud-ouest de Stalingrad, si près de Paulus que déjà les radios des encerclés et de leurs libérateurs avaient établi le contact. On a conservé la liasse des messages échangés entre Paulus et le maréchal von Manstein. Leur lecture navre. Paulus eût pu, en quarante-huit heures, sauver ses hommes. Il fallait se jeter, comme il le pouvait, vers ses sauveteurs, avec ce qu’il avait à sa portée et avec la centaine de chars qui lui restaient. Un an plus tard, pris exactement comme lui, à onze divisions, dans l’encerclement de Tcherkassy, nous livrâmes d’abord sur le terrain vingt-trois jours de combats acharnés puis, lorsque furent signalés à une vingtaine de kilomètres les blindés du général Hube qui venaient à notre secours, nous nous ruâmes vers eux, for4ant la rupture. Nous perdîmes huit mille hommes au cours d’un corps à corps horrible, mais cinquante-quatre mille passèrent par la brèche et furent sauvés. Même si Paulus en avait perdu le double, ou le quintuple, c’était mieux que de livrer son armée, comme il le fit, à la mort dans l’horreur de l’encerclement final, ou à la capitulation qui fut pire encore, puisque, des deux cent mille prisonniers du Sixième Corps, les Soviets en firent périr, par la suite, de misère et de faim, plus de cent quatre-vingt-dix mille, dans leurs camps. De tous les prisonniers de Stalingrad, neuf mille seulement réapparurent dans leur patrie, nombre d’années après la guerre. Tout valait donc mieux que de rester dans la nasse. Il fallait rompre. Paulus ne parvint à se décider à rien. Von Manstein le relançait par radio ; il envoya, en avion, des officiers de son état-major dans la poche même de Stalingrad, afin de le décider à démarrer enfin. Ses colonnes de chars à lui, sous le commandement de Hoth, s’étaient avancées en fer de lance, elles couraient de plus en plus le risque de se faire encercler à leur tour si les tergiversations de Paulus devaient encore se prolonger. C’est alors que celui-ci, tourneboulé par sa manie tatillonne des regroupements méticuleux à base de paperasses et qui, en fait, préférait au fond de lui-même ne plus bouger, câbla à ses sauveteurs qu’il lui fallait six jours pour mettre au point ses préparatifs de dégagement ! Six jours ! En six jours, en 1940, Guderian et Rommel avaient couru de la Meuse à la mer du Nord ! Paulus et son Sixième Corps n’ont pas échappé au désastre de Stalingrad parce que le chef n’eut ni la force de volonté ni l’esprit de décision. Le salut était sous son nez, à quarante-huit kilomètres. L’effort inouï des chars de libération, arrivés tout près de lui et qu’il eût pu rejoindre en deux jours, ne servit à rien. Paulus, théoricien incapable sur le terrain, cerveau mou, effondré avant même de se décider, laissa tout juste la colonne libératrice s’épuiser à l’attendre. Il n’apparut point. Il n’essaya même pas d’apparaître. Les chars de von Manstein, après une attente interminable et extrêmement dangereuse, durent rompre, repartir vers leur base de départ. Paulus finit, un mois plus tard, encore plus misérablement. Il eût dû, tout au moins, se faire tuer à la tête de ses dernières troupes. Il s’étendit sur son lit dans son poste souterrain de commandement, attendit que des négociateurs de son état-major eussent terminé, au-dehors, les palabres avec des émissaires soviétiques. Il demandait, avec une insistance qui fait mal, qu’une fois qu’il se serait rendu, une automobile soit mise à sa disposition pour le conduire au Grand Quartier général de l’ennemi. Ses soldats agonisaient. Lui, pensait à une auto pour le transporter. Tout l’homme est là. Quelques heures plus tard, reçu à déjeuner par le commandement russe, il demanda de la vodka et leva son verre, devant les généraux soviétiques abasourdis, en l’honneur de l’Armée rouge qui venait de le battre ! Le texte de ce petit discours de table existe encore, enregistré à l’instant, comme on l’imagine, par les Services de Renseignements des Soviets. Ce texte donne la nausée. Deux cent mille soldats de Paulus étaient morts ou partaient vers les camps où une mort atroce les attendait. Lui, vodka en main, saluait les communistes vainqueurs ! On l’emmena à Moscou en train spécial, en wagon-lit. Déjà ce militaire éternellement indécis n’était plus, politiquement et moralement, qu’une épave. Il était, dès alors, mûr pour la trahison. Il échapperait, grâce à elle, aux gibets de Nuremberg. Il reviendrait s’installer en Allemagne de l’Est. Il y végéterait encore quelques années. Il est mort depuis longtemps. Mais ce militaire médiocre, pusillanime et sans volonté avait rompu les reins de l’armée de son pays. Comme un chat au dos broyé, la Wehrmacht s’étirerait, pendant deux ans encore, sur les routes de la défaite, tenace, héroïque. Mais elle était perdue depuis le jour où Paulus, se refusant au risque, avait rompu, devant le monde entier, le mythe de l’invincibilité du Troisième Reich. La preuve que Paulus eût pu résister, se libérer et même gagner sa bataille, fut administrée, l’hiver même, par le maréchal Von Manstein que Paulus n’avait pas osé rejoindre lorsqu’il eût pu – et eût dû – jeter avec vigueur toutes ses troupes encerclées vers leurs sauveteurs. Ceux-ci fouaillèrent sans répit pendant trois mois les Russes qui, débarrassés de l’armée de Paulus dans leurs arrières, avaient pu courir en avant pendant des centaines de kilomètres, dépassant le Don, dépassant le Donetz, submergeant une partie de l’Ukraine. Quand ils eurent dévalé vers l’ouest, Manstein les coinça, une fois de plus, les battit à plate couture, reconquit Kharkov haut la main, neutralisant partiellement et momentanément le désastre de la Volga. Si Paulus se fût jeté vers Manstein, combattant ensuite à ses côtés, ou s’il se fût cramponné aux ruines de Stalingrad jusqu’au grand printemps – ce qui n’était pas strictement irréalisable – la guerre eût, peut-être, pu encore être gagnée, ou, du moins, les Soviets eussent été contenus plus longtemps. Malgré tout ce qu’avait d’atroce le combat de Stalingrad, des possibilités de résistance subsistaient. Des stocks considérables de munitions et de ravitaillement furent saisis par les Russes dans Stalingrad conquis. Le pont aérien avait donné un appui qui n’avait pas été total, mais qui avait quand même été très considérable. Rien que les vingt-trois mille chevaux et bêtes de charge encerclés en même temps que les troupes, représentaient des millions de kilos de viande utilisables. Les statistiques des réserves fournies par Paulus étaient fausses, comme sont fausses toutes les statistiques fournies par les unités combattantes qui signalent la moitié de ce qu’elles possèdent et demandent le double de ce qu’elles attendent. A Leningrad, avec trente fois moins de ravitaillement, les Russes résistèrent pendant deux ans et l’emportèrent, finalement. Et puis, de toute façon, prolonger, même dans les pires souffrances, la résistance à Stalingrad, valait mieux que d’envoyer deux cent mille survivants périr de souffrances dans les camps de famine soviétiques. Des divisions blindées étaient amenées en hâte de France pour dégager les assiégés. Tout mois gagné comptait. Entre-temps, des armes nouvelles pouvaient être utilisées, susceptibles de tout changer. Chasseurs à réaction, avions à géométrie variable, étaient inventés dans le Reich alors déjà, tandis que les Alliés n’en avaient aucune idée. Les fusées allemandes allaient être opérationnelles, elles aussi, en 1944. si la chance n’avait pas desservi Hitler, notamment lorsque sauta son usine d’eau lourde en Norvège, une bombe atomique comme celle d’Hiroshima eût pu tout aussi bien tomber avant 1945 sur Moscou, ou sur Londres, ou sur Washington. Sur un autre plan, il n’était pas inimaginable que Churchill et Roosevelt se rendissent compte, avant qu’il ne fût trop tard, qu’ils étaient en train de livrer la moitié de l’univers à l’U.R.S.S. Ils eussent pu, à temps, renoncer à mettre au service de Staline les quatre cent cinquante mille camions, les milliers d’avions et de chars, les matières premières et le matériel de guerre fabuleux qui assurèrent au Soviets leur domination, depuis les îles Kouriles jusqu’à l’Elbe. Me mieux était donc de tenir, tenir à la rive de la Volga, tenir au Dnieper, tenir à la Vistule, tenir à l’Oder. Chaque campagne employée à barrer la route aux armées rouges sauvait, peut-être, les millions d’être libres de l’Europe menacée de mort. Après Stalingrad, une fois réaffirmées les possibilités de résistance militaire du Troisième Reich et reconquis Kharkov, l’espoir survécut, pendant quelques mois encore, de reprendre, une troisième fois, l’initiative. Après le premier hiver, la remise en marche des armées européennes avait demandé un effort énorme car Staline avait eu le temps de s’adapter à la guerre-éclair et, surtout, d’en percer le secret. La course au Caucase avait été réalisée, mais, à dire le vrai, avait été manquée, puisque le gros de l'ennemi nous avait glissé entre les doigts. Après un deuxième hiver et après le désastre de Stalingrad, moralement beaucoup plus important que militairement, une troisième offensive deviendrait encore plus difficile, d’autant plus que tout, entre-temps, avait changé en Occident. Les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, s’étaient répandus tout le long du canal de Suez. Rommel avait perdu la partie, et n’était plus, lui, l’ancien proconsul romain, qu’un sous-ordre amer, aigri, prochaine victime d’intrigants. Le continent européen pouvait être envahi n’importe quand, et il le serait l’année même, qui verrait les Yankees mastiquer leur chewing-gum sous les orangers de Palerme et courir les filles dans les ruelles ténébreuses de Naples aux parfums de jasmin et d’urine. L’ultime tentative fut risquée tout de même. La masse puissante de toutes les Panzer Divisionen qui restaient disponibles s’élança, une nouvelle fois, vers Koursk, près d’Orel, en juillet 1943 pour une grande bataille d’anéantissement du matériel soviétique, qui, si elle réussissait, nous livrerait, enfin, après tant d’assauts, les grands fleuves et les grandes plaines jusqu’à l’Asie. L’épreuve fut décisive. Les Soviets avaient été à bonne école. Leurs maîtres allemands de 1941 et 1942 leur avaient désormais tout appris. Leurs usines, remontées à l’abri des monts Oural, leur avaient fabriqué des milliers et des milliers de chars. Les Américains avaient fait stupidement le reste, les comblant gratuitement de matières premières en quantités géantes et des armements les plus modernes. Dans nos arrières, l’aviation anglo-américaine broyait tout, pour faciliter aux soviets la course vers la proie européenne. Le duel Koursk-Orel fut hallucinant. Hitler avait engagé sur ce terrain étroit autant de chars et d’avions que sur toute l’étendue du front russe lors de l’assaut général de juin 1941. Pendant plusieurs jours, des milliers de blindés allemands et soviétiques luttèrent fer contre fer. Mais la double percée originelle des armées du Reich se rétrécit de jour en jour, fut stoppée, neutralisée. L’armée allemande, cette fois-ci, était vraiment battue. Elle n’avait pu passer. La preuve venait d’être faite que le matériel russe était devenu le plus fort. C’est là que la Deuxième Guerre mondiale fut perdue, à Koursk et près d’Orel, et non à Stalingrad, car trois cent mille hommes perdus, accidentellement, sur onze millions de combattants ne signifiaient pas un désastre irrémédiable. Le désastre irrémédiable fut ce duel décisif des armées blindées d’Hitler et de Staline, sur le champ de bataille Koursk-Orel, au centre même de la Russie, en juillet 1943. Dès alors, l’immense rouleau compresseur russe n’avait plus qu’à descendre vers les pays civilisés de l’Ouest. Tout ce qu’on pourrait encore faire, c’était l’empêcher de descendre trop vite, avec l’espoir de le stopper tout de même avant qu’il n’atteignît le cœur de l’Europe. Pour sauver ce qui pouvait être sauvé, nous luttâmes encore tout au long de deux années, deux années terribles, où l’on perdait en une semaine plus d’hommes qu’auparavant en un trimestre. Nous nous cramponnions au terrain, nous nous laissions encercler pour retenir l’ennemi pendant dix jours, vingt jours de plus. Nous ne nous échappions qu’au prix de sorties et de ruptures apocalyptiques, laissant derrière nous, dans les neiges nocturnes, se prolonger au loin les cris désespérés des mourants : camarades, camarades… Pauvres camarades que les neiges recouvraient lentement, ces neiges qui, plus d’une fois, avaient été notre unique nourriture… Il fallait foncer à travers les villages russes en feu, parmi les blessés qui se tordaient de douleur sur le verglas rougi, parmi les chevaux qui se débattaient, éventrés, leurs boyaux épandus comme d’affreux serpents bruns et verts. Les derniers chars se rejetaient vers le sacrifice ou, plus exactement, vers l’extermination. Des unités entières se faisaient massacrer sur place. Mais les fronts crevaient partout, étaient béants. Des dizaines de milliers de chars, des millions de Mongols et de Tchirgisses, s’épandirent sur la Pologne, sur la Roumanie, sur la Hongrie, sur l’Autriche, puis sur la Silésie et sur la Prusse orientale. Nous redonnions sans cesse, reconquérant des villages allemands submergés par les Soviets quelques heures plus tôt : les vieillards châtrés, agonisaient au sol dans des marais de sang ; les femmes, les toutes vieilles comme les gamines, violées cinquante fois, quatre-vingt fois, gisaient gluantes, les mains et les pieds attachés encore à des piquets. C’est ce martyre de l’Europe que nous voulions retarder, limiter dans la mesure où ce serait encore possible. Nos garçons mourraient par milliers pour contenir ces horreurs, permettre aux fuyards de courir dans notre dos vers les havres d’un Ouest de plus en plus rétréci. Quand on reproche à Hitler d’avoir maintenu si longtemps le combat, on ne se rend pas compte que, sans sa volonté forcenée, sans ses ordres draconiens de résistance sur place, sans les exécutions et les pendaisons des généraux qui reculaient et des soldats qui s’enfuyaient, des dizaines de millions d’Européens de l’Ouest eussent, eux aussi, été atteints, submergés, et connaîtraient aujourd’hui l’étouffante servitude des Baltes, des Polonais, des Hongrois, des Tchèques. Immolant les restes de son armée dans un corps à corps désespéré, à un soldat contre cent soldats, à un blindé contre cent blindés, Hitler, quelle qu’eût été sa responsabilité au départ de la Deuxième Guerre mondiale, sauvait, a sauvé, des millions d’Européens qui sans lui, sans son énergie, et sans tous nos pauvres morts n’eussent plus été – et pour longtemps – que des esclaves. Lorsque Hitler se fit sauter le cerveau, ce qui pouvait être sauvé était sauvé. Les colonnes gémissantes des derniers réfugiés avaient atteint la Bavière, l’Elbe, le Schleswig-Holstein. Alors seulement la fumée du cadavre d’Hitler monta sous les arbres déchiquetés de son jardin. Les armes se turent. La tragédie était terminée. A l’heure où la capitulation fut rendue publique, les derniers combattants ne formaient plus que des groupes isolés, coupés souvent de tout contact avec le commandement. Les quelques camarades qui m’entouraient ne voulaient, pas plus que moi, céder, se livrer. Un avion était abandonné dans notre secteur, le secteur norvégien que nous avions atteint au bout d’un combat interminable tout au long de la Baltique, de l’Esthonie, au Danemark. Nous grappillâmes de l’essence, de-ci, de-là. Nous aurions deux mille trois cent kilomètres à franchir, si nous voulions atteindre un pays comme l’Espagne demeuré hors de la mêlée. Il nous restait une chance sur mille d’en sortir ? Sans doute ! Durant plus de deux mille kilomètres au-dessus de l’ennemi, de son artillerie antiaérienne, des bases de ses escadrilles de chasseurs, nous serions canardés cent fois. Mais nous préférions tout à la capitulation. Nous nous élançâmes dans les airs en pleine nuit, franchîmes l’Europe entière dans l’éblouissement des tirs alliés. Nous atteignîmes, à l’aube, le golfe de Gascogne. Nos moteurs renâclaient, suffoquaient, les réservoirs d’essence étaient épuisés. Allions-nous périr à quelques minutes de l’Espagne ? … Nous étions décidés, s’il le fallait, à atterrir n’importe comment ; si nous n’étions pas tués au sol, nous prendrions d’assaut n’importe quelle voiture. Dans la pétarade des six mitrailleuses que nous portions, nous eussions tout de même atteint probablement la frontière. Mais non, l’avion se maintenait toujours. Nous pûmes le redresser une dernière fois, faire tomber sur les deux moteurs les derniers décilitres d’essence qui restaient au bout des réservoirs. Nous nous rejetâmes dans le vide. Nous n’eûmes plus le temps de rien voir. Nous rasions des toits roses, nous piquions vers une rade claire. Puis un énorme rocher se dressa devant nos yeux. Trop tard ! Nous fîmes frein, à trois cent kilomètres à l’heure, avec la coque même de l’appareil. Un moteur explosa comme fétu. Déjà l’avion [184] avait bifurqué, pris de folie, il courait dans les flots, il s’y abîmait.
En face de
nous, au bout des eaux luisantes, San Sebastian s’éveillait. Du haut de la
digue, deux guardias civiles agitaient l’éventail noir de toile cirée de leur
képi. L’eau avait envahi l’avion brisé, jusqu’à vint centimètres du toit, juste
assez pour nous laisser encore respirer. Nous étions tous en capilotade, os
rompus, chairs déchirées. Mais nul n’était mort, ni même mourant. Des pirogues
approchaient, nous recueillaient, abordaient la plage. Une ambulance m’emmenait.
Je passerais quinze mois, grand blessé, à l’Hôpital militaire Mola. Ma vie
politique était finie. Ma vie de guerrier était finie. Celle, ingrate entre
toutes, d’exilé traqué, haï, commençait. |
Qu´importe de souffrir si on a eu dans sa vie quelques heures immortelles. Au moins, on a vécu!