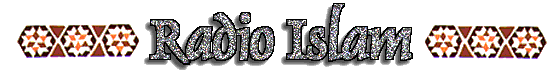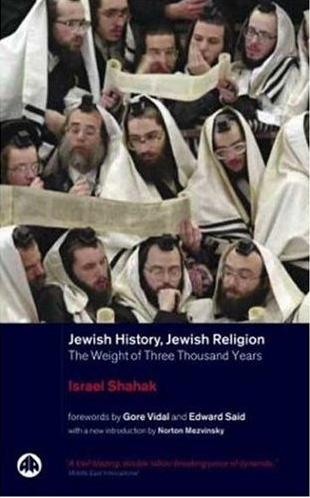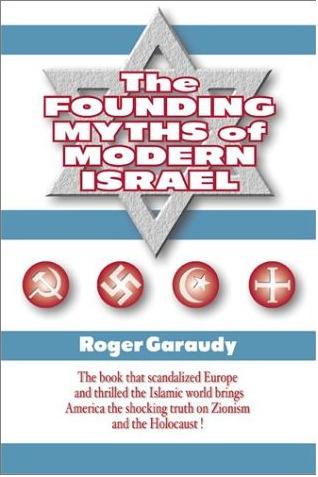Serge Thion
VÉRITÉ HISTORIQUE
OU
VÉRITÉ POLITIQUE?
[93]
CHAPITRE III
L'ÉCLATEMENT DE L'AFFAIRE
C'est l'affaire de l'interview de Darquier, ancien commissaire aux Questions
juives dans le régime de Vichy, dans I'Express, qui allait
mettre le feu aux poudres. Pour Faurisson, « le moment est venu ;
les temps sont mûrs ». Le premier novembre 1978, campé
sur ses dossiers, il envoie à différents journaux une lettre
circulaire assez provocatrice :
J'espère que certains des propos que le journaliste Philippe
Ganier-Raymond vient de prêter à Louis Darquier de Pellepoix
amèneront enfin le grand public à découvrir que les
prétendus massacres en « chambres à gaz »
et le prétendu « génocide » sont un
seul et même mensonge, malheureusement cautionné jusqu'ici
par l'histoire officielle (celle des vainqueurs) et par la force colossale
des grands moyens d'information. Comme le Français Paul Rassinier
(ancien déporté résistant), comme l'Allemand Wilhelm
Stäglich, comme l'Anglais Richard E. Harwood comme l'Américain
Arthur R. Butz (auteur de l'Imposture du XXe siècle ouvrage
si remarquable qu'on ne parvient manifestement pas à lui répliquer),
comme vingt autres auteurs, passés sous silence ou calomnie tout
à loisir, je proclame ici comme je l'avais fait au colloque national
Lyon sur « Églises et chrétiens de France dans
la Seconde Guerre mondiale » (27-30 janvier 1978) : « Les
massacres en prétendues "chambres à gaz" sont un
mensonge historique.. » Hitler n'a jamais ordonné
ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de
sa religion. Je ne cherche à outrager ni à réhabiliter
personne. Jusqu'à preuve du contraire, je pense avoir conduit mes
recherches selon les méthodes de routine de la critique historique.
Je suis prêt à tout débat sur la question « chambres
à gaz » et du « génocide »,
à toute confrontation, à toute interview dûment enregistrée :
cela, j'ai eu l'occasion de le déclarer par écrit à
maintes autorités, à maintes publications (Tribune juive-hebdo,
par exemple), à maints organes d'information depuis quatre ans,
et je le répète ici aujourd'hui. La lumière ne viendra
ni du « docu-drame » Holocaust. ni de la L.L.I.C.A.,
ni d'une nième levée de boucliers ; elle ne pourra venir
que d'un examen, à armes égales, des thèses en présence.
Pour ma part, j'aime la lumière.
[94] Au Monde personne ne cille. On connaît l'homme
et on vit dans la terreur de le voir débarquer, cherchant à
coincer un rédacteur dans un couloir pour le sermonner d'importance.
Au Matin de Paris, on ne connaît pas l'affaire et la rédaction
parisienne charge son correspondant à Lyon, Claude Régent,
de prendre contact avec Faurisson. Ils se rencontrent, armés d'enregistreurs
à cassettes, le 8 novembre au Sofitel. Selon la bande enregistrée,
l'entretien débute ainsi :
R.F. : Il est bien entendu que je vous accorde cette interview
à plusieurs conditions qui ont été précisées
au téléphone. La première c'est qu'en fin de compte,
il s'agira d'une interview écrite. Nous allons bavarder un peu aujourd'hui,
et puis vous poserez des questions. Ces questions, je les enregistrerai
par écrit. Et puis, je tâcherai de vous apporter une réponse
demain. [] Cependant, pour le Matin, je vais poser des conditions
à mon tour. Mes conditions sont les suivantes : c'est une publication
in extenso, ou ce n'est pas une publication. C'est à vous
de décider. A votre avis, je dois vous remettre une interview écrite
de quelle longueur de pages ?
C.R. : Très courte. Je n'ai pas fixé dès
aujourd'hui une longueur vraiment.
R.F. : Nous devons être bien précis sur ce point,
elle doit être complète, ou elle ne passe pas. C'est-à-dire
que, par exemple, si je vous remets soixante lignes dactylographiées,
ce sont soixante lignes dactylographiées avec titres, intertitres.
C.R. : Je ne peux pas m'engager pour cela.
R.F. : Bien. Seulement vous pouvez vous engager de la façon
suivante : je vous demande, d'ores et déjà, de passer
tout, si bref ou si long que ce soit. Ou vous ne passez rien.
C.R. : le ne peux absolument pas prendre cet engagement, car
ce n'est pas possible.
R.F. : Je ne veux pas d'une interview qui serait découpée,
je m'y refuse absolument.
C.R. : On m'a demandé de venir vous voir, puisque vous
avez écrit au Matin. Le Matin veut savoir ce que vous avez
à dire. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Moi je viens vous
voir pour vous demander ce que vous avez à nous dire.
R.F. : Je vous ai répondu dans un premier temps que
ce que j'avais à vous répondre, je le ferai par écrit.
Et vous savez pourquoi : le sujet est très délicat.
Je vous ai même dit que je voulais en la circonstance agir comme
Mitterrand qui, a-t-il dit, ne donne d'interview qu'écrite. Il est
évident que si je crains, n'est-ce pas, d'avoir à parler
du sujet librement, si je veux que ce soit par écrit, c'est parce
que je crains des déformations. La première des déformations
que je puisse craindre, c'est celle d'un découpage, d'un raccourcissement.
Eh bien, je n'en veux pas ! Je ne veux rien qui puisse déformer
si peu que ce soit ma pensée. Le sujet est trop grave. Alors je
comprends très bien, vous êtes très aimable, vous venez
[95] me trouver, vous me dites que vous ne pouvez pas prendre cette
responsabilité. Eh bien, je pense que si j'habitais Paris, j'irais
voir votre responsable de la rédaction et que peut-être nous
pourrions nous mettre d'accord. Peut-être pourriez-vous vous-même -
c'est une suggestion que je vous fais - vous mettre à nouveau
en rapport avec lui et lui dire : voilà ce qu'il en est. Le
sujet est extrêmement grave, vous comprenez, ce n'est pas une affaire
de chien écrasé.
C.R. : Je ne peux pas dire : « voilà,
c'est en place », avant de savoir ce que vous allez dire.
R.F. : Ce n'est pas cela. Si vous m'avez bien suivi, ce n'est
pas cela que je dis. Je dis que vous n'avez pas à décider
par avance.
C.R. : Je peux vous dire par exemple, vous allez écrire
sur deux questions précises, ce que l'on appelle en termes journalistiques
un feuillet, disons une page dactylographiée, soit 25 lignes dactylographiées.
Je ne peux absolument pas vous dire si ça se passera intégralement.
R.F. : Écoutez, ce que je peux faire, n'est-ce pas,
c'est fournir de toute façon le texte. Vous avez bien compris. Ce
que je demande, c'est de fournir de toute façon le texte. Et je
dis : « Mais ce texte n'est publié que s'il est
publié intégralement. » C'est à ce moment-là
que vous décidez. Vous décidez sous bénéfice
d'inventaire, vous ne décidez pas à priori. Quand vous aurez
entre les mains ces trois pages dactylographiées, eh bien, à
ce moment-là, vous prendrez votre décision, et ce sera tout
ou rien !
C.R. : C'est-à-dire que vous fournirez d'abord le texte,
et après on décidera si oui ou non on passe.
R.F. : Exactement, ce texte, étant bien entendu que
ce texte sont vos questions et mes réponses. Et le titre est extrêmement
important, n'est-ce pas. Vous allez voir pourquoi, je vous l'expliquerai
tout à l'heure. Le titre, je veux en être responsable.
C.R. : Alors là, vous bousculez les usages.
R.F. : Eh bien, tant pis pour moi, je le regrette pour vous.
Je bouscule souvent beaucoup d'usages comme cela. Le titre est une chose
capitale, et le titre par exemple pourrait être insultant. Dans l'atmosphère
de polémique qui se développe autour de cette interview du
dénommé Darquier, tout est possible. Toute calomnie, toute
médisance, toute déformation sont possibles, à commencer
par le titre. Je pourrais vous donner des exemples de titres qui seraient
purement scandaleux.
C.R. : Le titre, ce n'est pas la personne qui est interviewée
qui décide du titre.
Pensant qu'une sorte d'accord est établi, Faurisson éprouve
le besoin de se présenter :
[...] Je m'appelle Robert Faurisson, je suis à demi-britannique.
Pendant la guerre, étant enfant, j'étais surnommé
l'Angliche et sur mon pupitre, je n'ai pas gravé le mot « liberté »
comme Éluard, n'est-ce pas, nous invite à le faire. J'ai
gravé « Mort à Laval », et j'écrivais
comme cela, dès que je le pouvais, car j'étais courageux,
« Hitler Dreck ». Je faisais un peu d'allemand, avec
beaucoup de « résistance » à mes profs
d'allemand, mais j'écrivais « Hitler Dreck ».
Ça veut dire « merde ». Et puis, j'avais parmi
mes camarades un dénommé Barbot ou Barberot que j'aimerais
bien retrouver aujourd'hui, qui était pro-allemand, et qui s'était
tout à fait réjoui le jour où j'ai dû dévisser
mon pupitre, et aller faire racler ce pupitre où il y avait marqué
« Mort à Laval ». Il s'était tout à
fait réjoui, car ce jour-là, devant tous les petits camarades,
on m'a fait honte de « vos Anglais qui courent dans le désert
comme des lapins ». Vous savez, la phrase, je l'ai encore. Et
ce Barbot ou Barberot peu de jours après le débarquement
des Anglo-Américains en Afrique du Nord, quand les gens commençaient
à sentir que ca tournait, est venu vers moi, m'a tendu la main,
et m'a dit (excusez-moi, c'était le mot ; je crois me rappeler
que c'était le mot) : « Cette fois-ci, ils l'ont
dans le cul. » Je lui dis (mais d'abord j'ai refusé la
main de Barberot, je suis raide hein !): « Mais de qui veux-tu
parler ? » « Eh bien, des Boches. »
« Comment ? Toi, Barberot, des Boches ? »
Et le petit bonhomme m'a répondu, car nous faisions du latin, et
je pense qu'il avait entendu cela la veille au soir de son père :
« Errare humanum est; perseverare diabolicum. »
Vous savez ce que cela veut dire : « l'erreur est humaine,
la persistance dans l'erreur est diabolique ». Je suis persuadé
que M. Barberot père est, par la suite, devenu grand résistant,
grand faux ou vrai résistant, n'est-ce pas. Et jusqu'au bout j'ai
été, je dois dire, pétri de cette haine qu'on m'infusait
dans ma famille, qu'on m'infusait à la radio. Je ne pouvais non
seulement pas voir Laval, mais Darlan, je ne sais pas pourquoi, bête
noire, et puis ça a été comme cela jusqu'au bout,
et je peux vous rapporter une autre réflexion qui n'est pas du tout
à mon honneur, et que je vous donne. Je me trouvais en congé
en août 1944 dans un petit village de Charente et qui s'appelle Lapéruse.
J'étais accoudé à la fenêtre, et j'avais à
côté de moi mon frère qui est un peu plus jeune ;
et mon frère et moi, nous regardions passer dans la rue du village
un type torse nu, et derrière un F.F.I. avec la baïonnette.
Je me tourne vers mon frère, et je dis : « Mais
qu'est-ce qu'on attend pour le buter ce salaud-là ? »
Car il n'y avait pas besoin de me faire un discours, un signe. Puisqu'il
était au bout de la baïonnette d'un F.F.I., c'était
forcément un collabo. Un collabo était un salaud ; un
collabo ça se descend. Voilà comment j'étais. Et je
trouve qu'il faut être très dur dans la vie, au moment de
la lutte, mais quand c'est fini (et le nazisme est mort, et puis, il est
bien mort le 30 avril 1945 ; il ne faut pas me raconter d'histoire,
et bien fini) l'hallali, l'hallali n'est pas mon fort. Moi je prendrais
presque le parti du cerf. Voilà comment j'agis. Ça, c'est
pour les choses sentimentales et politiques. Et pendant la guerre d'Algérie,
je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est une chose qui peut se vérifier.
J'ai apporté ma cotisation au Comité Maurice Audin, oui,
mais ensuite, j'ai défendu un camarade qui était soupçonné
d'être O.A.S. C'est comme ça que chez les vrais Britanniques
on réagit. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre
quelquefois. Et j'ai horreur que l'on crache sur un cadavre, et je m'interroge
toujours sur les raisons pour lesquelles on crache sur un cadavre. Je trouve
troublante cette unanimité à propos de l'affaire Darquier
de Pellepoix. Darquier de Pellepoix, c'est le type même d'homme que
ca m'aurait réjoui qu'on abatte pendant la guerre. Moi, je me suis
réjoui quand j'ai appris que Philippe Henriot avait été
abattu. Quand j'entendais dire à la radio anglaise, dont je buvais
toutes les paroles : « 4000 tonnes de bombes sur Hambourg »,
je disais : « C'est formidable, mais pourquoi n'y en a-t-il
pas eu 8000 ? » Quand les femmes, les vieillards, les enfants
grillaient au phosphore, moi je trouvais ca très bien. Oradour (625
morts) m'indignait ; Dresde où il y [97] a eu probablement
135 000 morts, ville-hôpital, ville-musée, la Florence
de l'Elbe, je trouvais cela normal, je trouvais cela très bien.
On ne retrouvera évidemment pas un mot de cet autoportrait dans
l'article du journaliste. Faurisson entreprend alors d'expliquer la raison
de ses recherches ainsi que ses conclusions. Le journaliste est choqué
(on le comprend) et il commence à persifler (on le comprend moins) :
C.R. : Alors les gens qui étaient au Vel-d-Hiv, ils
sont partis se promener, et ils sont tous revenus.
R.F. : Il faut que vous me posiez la question sur un autre
ton.
C.R. : Vous voulez persuader qui, là ? Vous voulez
prouver quoi ? Qu'il n'y a pas de juifs qui ont été
déportés, qui sont
R.F. : Alors, je suis obligé de reprendre. Mais il faut
d'abord que vous me parliez gentiment, sinon, je ne peux pas vous répondre.
Que soit clair ! Sinon, nous nous arrêtons tout de suite. Alors,
je dis ceci : je pense à propos des déportés,
ce qu'en pensaient par exemple je ne voudrais pas citer de noms parce que
ça va tout de suite aiguiller dans un mauvais sens. Voici ce que
j'en pense. Regardez tout ce qui est vrai parmi les souffrances. Il y a
le fait que des gens ont été persécutés à
cause de leur origine, soit raciale, soit religieuse. Pour les uns ça
a pu être cette chose, qui est un drame affreux : perdre son
métier. Pour d'autres. internés. Pour d'autres, séparés
de leur famille. Pour d'autres, déportés. Pour d'autres,
déportés puis internés et, très loin de leur
pays. travailler dans des conditions souvent très dures, souvent
mal nourris. en proie à toutes sortes d'épidémies.
Il y a eu des ravages formidables et dus au typhus à Bergen-Belsen,
ces fameux monceaux de cadavres que l'on nous montre. Il y a eu toutes
ces choses-là. Il faudrait d'ailleurs ne pas oublier aussi tous
les faits de guerre, qui peuvent être que, un homme. par son action
prend des risques, fait de la résistance. Il devient un combattant.
Moi vous savez, j'aurais eu deux ans de plus. vous en faites pas, j'en
étais.
C.R. : Vous aviez quel âge à moment-là ?
R.F. : J'avais 15 ans en 1944. Toutes ces choses-là
sont vraies, sont suffisamment affreuses. Alors moi. qu'est-ce que je vais
dire pour répondre à votre question (que j'aurais souhaité
d'une façon moins agressive) ? Ce que je veux, c'est cette
chose bien humble qui s'appelle la recherche de la vérité,
et qui s'appelle l'exactitude, parce que je trouve que n'est pas beau,
n'est pas beau de mentir, ça n'est pas beau. de fabriquer cette
espèce de nazisme de sex-shop que vous voyez en moment, et depuis
longtemps. La curiosité qu'on porte à Adolphe est une curiosité
absolument malsaine. Pour moi. il ne m'intéresse pas plus. Adolphe
que Napoléon Bonaparte, ni ses idées, ni sa personne. Staline
n'était pas un dieu. Hitler n'était pas le diable, comme
ça, tout d'un coup surgi. n'est-ce pas. Non ! Alors, qui m'intéresse,
c'est ça, et je crois que je fais uvre saine.
C.R. : Alors est-ce que oui ou non, Hitler a-t-il tué
des juifs ?
[98]
R.F. : Jamais Hitler n'a donné l'ordre de tuer. Et écoutez-moi
bien, c'est important les mots que je vais dire ici, jamais Hitler n'a
donné d'ordre de tuer des gens en raison de leur race, ou de leur
religion. Qu'il ait dit, dix fois : « Les Juifs veulent
notre mort, c'est nous qui aurons la leur »
C.R. : C'est déjà pas mal.
R.F. : Mais enfin, enfin
C.R. : Mais la « solution finale » ?
R.F. : La « solution finale », puisque
vous me posez la question
C.R. : Si ça n'existe pas !
R.F. : La « solution finale » existe
absolument.
C.R. : C'est quoi la « solution finale » ?
R.F. : La « solution finale » (Endlösung,
Gesamtlösung) la solution d'ensemble, c'est faire que les Juifs
soient déportés. D'abord à Madagascar. Vous savez
que c'est ce qu'on a appelé le Madagascar Projekt. Et j'en ai le
texte. Ensuite quand la guerre a été européenne, qu'il
n'en a plus été question, à ce moment-là, ça
a été : mettre les Juifs le plus loin possible de l'Europe,
dans un coin là-bas ; en attendant, les faire travailler pour
ceux d'entre eux qui peuvent travailler. Mais vous avez le propos, il est
d'Hitler, si on fait cas du propos d'Hitler n'est-ce pas, (vous pouvez
toujours me dire, Hitler raconte des histoires, mais enfin, s'il raconte
des histoires dans un sens, en raconte-t-il dans l'autre ?). Hitler
disant, n'est-ce pas : « Je les forcerai à fonder
un État national » et cela, ça date si je ne m'abuse
de septembre 1942.
C.R. : Alors qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces camps, où
ils mouraient, où ?
R.F. : Alors, dans ces camps, ils ne mouraient pas tous, puisque,
n'est-ce pas, les associations quand même d'anciens déportés
sont nombreuses. Alors, à ce propos-là, je voudrais vous
dire une chose que j'ai perdue de vue en cours de route, et qui est très
importante, c'est à propos du chiffre. Eh bien, voilà !
Vous connaissez donc le Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Vous savez que c'est un service qui est rattaché directement au
Premier ministre. Il est dirigé, si vous voulez, et les deux principaux
responsables en sont M. Henri Michel et M. Claude Lévy. Or, une
enquête a été entreprise sur la déportation,
il y a très longtemps, plus de vingt ans je crois, pour, vous savez,
ce que vous disiez tout à l'heure en ricanant : « Vous
voulez les noms, etc. », eh bien, c'est un travail scientifique
qu'ils ont entrepris département par département. Cette enquête,
Monsieur, a été terminée en fin 1973. Vous n'en avez
jamais vu paraître les résultats, et maintenant je vais vous
dire pourquoi. Ce Comité publie en pages ronéotypées,
et c'est de diffusion on peut dire confidentiel, un bulletin qui n'est
pas à confondre avec la revue, la Revue de la Seconde Guerre
mondiale, un bulletin, et dans ce bulletin voici ce que dit M. Henri
Michel (alors, ce sont les numéros, je crois, 209 et 212, datés
de janvier et d'avril 1974). Eh bien le « résultat d'ensemble
de l'enquête » (qui a duré tant d'années,
qui a fait travailler tant de gens) « ne sera pas publié »,
et la raison en est donnée, n'est-ce pas, « par crainte
d'incidents avec certaines associations de déportés ».
Autre formule : « Pour éviter les réflexions
désobligeantes pour les déportés. »
[99]C.R. : Alors, il y a eu combien de disparus ?
R.F. : Vous revenez à cette question, à laquelle
je vous dis que personnellement, je ne suis pas en mesure de répondre,
mais je dis qu'il y a des gens à qui il faut poser la question,
en leur demandant, n'est-ce pas, de publier les résultats de leurs
enquêtes sur la France
Dans le courant de la conversation, le journaliste lance l'hameçon
Darquier (c'est utile, il doit se demander si l'on pourra titrer « un
émule de Darquier », c'est bon pour les ventes). Réponse
de R.F. :
« Monsieur Darquier de Pellepoix est un monsieur qui ne m'intéresse
pas, c'est le type même de l'homme que toute ma vie je combattrai. »
Ça ne mord pas. Faudra trouver un autre titre. L'entrevue se termine
assez mal :
[...] Mes étudiants vont lire le Matin. Malheureusement
ils ne le liront pas, puisque moi je ne veux que de l'interview (n'est-ce
pas, je l'ai bien précisé), l'interview écrite. Vous
êtes bien d'accord ?
C.R. : Pas du tout !
R.F. : Comment ?
C.R. : Pas du tout, vous m'avez parlé, je ne vous ai
rien dit au départ. J'utilise, c'est vous qui me l'avez dit.
R.F. : Non, non, vous m'avez dit, excusez-moi, vous m'avez
bien dit que vous étiez d'accord sur le point suivant - ou
alors ce serait extrêmement grave, Monsieur - que vous m'accordiez
une interview écrite, je n'accepte pas oui, ça a été
une conversation entre nous.
C.R. : Je ne l'ai pas dit, vous pouvez vérifier.
R.F. : Bon, écoutez Monsieur, vous êtes en train
de me tromper et c'est très mal ce que vous faites, c'est très
grave, vous n'avez pas le droit de faire ça.
C.R. : Je ne parlerai pas pour moi.
R.F. : Je vous en ai parlé en confiance, comme ça,
entre nous ; ce que vous faites
C.R. : Vous croyez que je vais perdre moi, une heure à
discuter avec vous, et ne pas faire d'article, non, c'est pas possible
L'article du Matin allait justifier toutes les craintes de Faurisson #Le
chapeau commence ainsi : « Darquier n'est pas seul. Certains
qualifient de "déments" ses propos sur les camps
d'extermination nazis. A Lyon, un enseignant, Robert Faurisson, le soutient. »
Le même chapeau se termine par une allusion à la fin de l'entrevue
avec Claude Régent qui a « enregistré [100]
au magnétophone deux heures d'interview. Peu après, Faurisson
exigeait qu'elle ne soit pas publiée. Sans doute fut-il effrayé
par l'énormité de ses propos ». Le
journaliste, lui, n'est pas effrayé par l'inanité de son
propos. Non content de ces déformations, on ajoute le mensonge pur
et simple : il est dit que Faurisson « exerce les fonctions
de conseiller historique des éditions du Baucens, à Bruxelles.
Les titres de quelques-uns des ouvrages publiés sont
explicites : le Mensonge d'Auschwitz, le Protocole des Sages de
Sion, la Vérité sur l'affaire Joachim Peiper ».
Claude Régent s'était bien gardé de demander à
Faurisson ce qu'il en était. On verra d'ailleurs d'autres journaux
reprendre cette calomnie à l'état pur, et même faire
de Faurisson l'auteur des ouvrages mentionnés, comme Bernard Schalscha,
dans Libération, qui recopie un peu hâtivement l'article
paru la veille dans le Matin #. Pour couronner le tout, le
Matin affirme qu'avant 1969, alors qu'il enseignait à Clermont-Ferrand,
« Robert Faurisson avait reçu un blâme à
la suite de propos antisémites ».
Pour raccrocher le lecteur, la phrase « le Journal d'Anne
Frank est-il authentique ? » (qui n'a pas grand'chose
à voir avec l'objet de la discussion) est utilisée quatre
fois (chapeau, titre de l'article, deux fois dans le corps de l'article)
et reprise une cinquième fois, dans une autre formulation,
sous une photo d'Anne Frank, sans un seul mot de commentaire pour éclairer
le sens de cette question. A quoi sert la malheureuse Anne
Frank dans le Matin de Paris ? A faire pleurer Margot,
à détourner l'attention de ce qui est dit. On m'avait
dit que ce journal était socialiste ; ça doit être
une erreur.
Le reste de l'article consiste en considérations de M. Maurice
Bernadet, président de Lyon 2, en extraits - partiellement
falsifiés # - du programme des cours de Faurisson, et
en extraits hachés menu du texte de Faurisson intitulé « le
problème des chambres à gaz ». Dans tout cela,
pas un mot de ce que Faurisson a dit au cours de l'entrevue.
[101] Cet article et ses petites fantaisies allaient être
repris tels quels dans le reste de la grande presse. Faurisson catapulta
aussitôt une réponse. Mais dans un journal socialiste comme
le Matin de Paris, on ne s'embarrasse pas du droit de réponse.
Faurisson a donc eu recours à la justice de son pays. Dans ses considérants,
le tribunal reprend en partie le texte de cette réponse # :
Je ne donne d'interview qu'écrite. Votre journaliste en a été
dûment prévenu, il s'est permis de tronquer et de lier bout
à bout des fragments de mes écrits présentés
au surplus comme ceux d'un antisémite.
Je ne m'intéresse ni au national-socialisme qui est mort et bien
mort le 30 avril 1945, ni au néo-nazisme de nostalgiques, ni, surtout
à l'envahissant nazisme de sex-shop colporté par les médias
et même par les historiens officiels.
Quatre ans de réflexion sur la thèse de Paul Rassinier (authentique
et courageux déporté résistant) et quatre ans de recherches
personnelles y compris au Struthof, à Auschwitz, à Birkenau
et à Majdanek m'ont convaincu que les « chambres à
gaz » hitlériennes ne sont qu'une imposture ; [...]
A supposer que les « chambres à gaz » n'aient
pas existé faut-il continuer de le taire ou bien faut-il l'annoncer
enfin, cette bonne nouvelle ?
Et le tribunal conclut sur ce sujet de la façon suivante :
Attendu que le directeur du Matin était en droit de refuser
la publication d'une réponse dans laquelle l'auteur de l'article,
accusé d'avoir tronqué et lié bout à bout des
fragments des écrits de Faurisson, était ainsi mis en cause
en termes insultants ; que par ailleurs, ce dernier abusait de ce
droit en cherchant à imposer au journal la publication d'un écrit
dans lequel il mettait l'accent sur l'« envahissant nazisme
de sex-shop colporté par les médias et même par des
"historiens officiels" », toutes considérations
n'ayant aucun lien direct avec sa mise en cause par le journaliste.
Ainsi, on insulte un journaliste en décrivant très exactement
ce qu'il a fait : tronquer et lier des textes. C'est une bonne chose
à savoir. Il n'empêche que le Matin a été
condamné pour diffamation, l'histoire du blâme pour propos
antisémites n'étant pour eux que « très
vraisemblable », à ce qu'ils prétendent, « sans
justification ». Mais, et c'est là l'extraordinaire,
à la demande, routinière, de publication du jugement, le
tribunal oppose un refus « en raison des circonstances particulières
de la cause ». On a donc un journal qui diffame un particulier
le fait est reconnu par un tribunal, mais ce particulier se voit dénier
le droit de voir réparer publiquement ce que le jugement qualifie
d'atteinte « à l'honneur et à la considération ».
Que [102] sont donc ces « circonstances particulières »,
sinon le désir commun du journal et du tribunal que l'image de Faurisson
dans le public demeure entachée de cette accusation ?
Dans un effort d'humour involontaire, le Matin publie en bas de
la même page un article intitulé : « Comment
avoue un innocent ». Pour qui se plonge dans cette affaire cauchemardesque,
la question des aveux passés par un certain nombre de responsables
nazis est évidemment d'une importance cruciale. Toute réflexion,
à cet égard, sur la valeur que l'on peut attribuer à
des aveux passés dans des conditions de contrainte extrême,
doit être prise en considération. On apprend donc, dans cet
article, que le groupe d'étude des problèmes posés
par la peine de mort, animé par le député R.P.R. Pierre
Bas, a décidé d'entendre un certain nombre de « grands
témoins », dont Gilles Perrault, Mgr Fauchet, évêque
de Troyes, et l'abbé P. Toulat. Gilles Perrault fit son exposé
sur la fragilité du témoignage et « comment peut-on
avouer lorsqu'on est innocent ? », avec référence
à Artur London. Je cite la fin du texte : « Le témoignage
ne vaut pas mieux que l'aveu. Les conclusions dûment étayées
par des expériences précises d'un groupe de chercheurs à
l'université de Columbia sont à ce sujet atterrantes. On
croyait jusqu'alors que l'il humain fonctionnait comme une caméra,
la mémoire restituant le film plus ou moins complètement,
mais fidèlement. En fait, non seulement la mémoire mais le
regard seraient sélectifs. L'il verrait ce qu'il s'attend à
voir, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il est logique qu'il voie. »
Point n'est besoin de chercheurs universitaires pour savoir tout cela.
Mais allez donc transposer ces considérations du plan pénal
à celui des événements historiques Qu'en penserait
Me Badinter ?
Il serait fastidieux de rechercher dans l'ensemble de la presse les réactions
à cette affaire. On y verrait seulement qu'au-delà des condamnations
et des indignations, il n'y a pas d'information, pas de discussion spontanée #.
Ce sont les lettres de Faurisson au Monde qui relancent à
chaque fois la balle.
Première lettre, le 16 décembre 1978 :
Ne niez jamais ! Pour avoir nié, comme Paul Rassinier et
vingt autres auteurs révisionnistes, I'existence des « chambres
à gaz » hitlériennes, je me vois traiter depuis
quatre ans par les plus hautes instances universi[103]taires, de « nazi »,
de « fou », de « Savonarole »,
de « jésuite », de personnage « nocif ».
Or, avant 1974, j'étais non moins officiellement tenu pour un « très
brillant professeur », un « chercheur très
original », un homme doté d'une « personnalité
exceptionnelle », un enseignant aux « remarquables
qualités intellectuelles et pédagogiques » ;
mes publications avaient « fait grand bruit » et
ma soutenance de thèse en Sorbonne avait été jugée
« étincelante ».
Le 16 novembre 1978, un journal qui avait obtenu un entretien de M.
Bernadet (président de mon université) publiait sur mon compte
d'abominables calomnies en préface à un montage de « déclarations »
que j'avais faites sur le mensonge des « chambres à gaz ».
M. Bernadet faisait immédiatement placarder l'article et l'accompagnait
d'une affiche invitant les chers collègues à venir signer
à la présidence un registre de protestations contre mes « déclarations ».
Pour sa part, il déclarait à un autre journal que mon « équilibre
intellectuel » était peut-être « atteint »
et qu'il ne pourrait plus assurer ma sécurité. Dans un communiqué,
puis dans une conférence de presse, il dénonçait le
« caractère scandaleux » de mes « affirmations »,
qui, par ailleurs, « ne reposaient sur aucun fondement sérieux
et ne méritaient que le mépris ».
En accord avec le recteur, M. Bernadet prend ensuite un arrêté
de suspension de mes enseignements. Ni l'un, ni l'autre ne
m'en préviennent à temps et je tombe dans un véritable
guet-apens. Des éléments étrangers à notre
université pénètrent jusqu'à mon bureau. M.
Bernadet, qui est tout près de là et qui sait ma présence
sur les lieux ainsi que ces allées et venues de gens excités,
ne fait rien. Un petit groupe d'entre eux m'insulte et me prend en chasse
dans les couloirs de l'université. Ce groupe me rattrape à
la sortie. Il me rosse sur le trottoir. Puis il me reprend en chasse et
m'agresse à nouveau, ainsi qu'un de mes étudiants. Depuis
trois ans, grâce à M. Bernadet, je suis un maître de
conférences dont on bloque toute possibilité d'avancement
parce que - motif officiel - outre que je réside à
deux heures de Lyon, je n'ai, paraît-il jamais rien publié
de ma vie, et cela « de (m)on propre aveu » !
Pour fonder son accusation, M. Bernadet a sorti de son contexte une phrase
d'une lettre où je lui disais mon étonnement de m'entendre
traiter de « nazi » alors que je n'avais jamais rien
publié qui pût le laisser croire (lettre, dont il ose donner
lui-même la référence, du 12 décembre 1975).
Cette stupéfiante accusation allait ensuite être confirmée
par mon ministre, puis tout récemment, par le Conseil d'État,
aux yeux de qui les motifs invoqués contre moi ne sont pas « matériellement
inexacts » (la liste de mes publications figurait pourtant dans
mon dossier) ! Je n'engagerai pas ici de discussion avec M. Bernadet
et je ne relèverai pas dans sa lettre d'autres graves inexactitudes,
habiletés et omissions. J'attends un débat public sur
un sujet que manifestement on esquive : celui des « chambres
à gaz ». Au Monde que, depuis quatre ans, je sollicite
en ce sens-là, je demande de publier enfin mes deux
pages sur « La rumeur d'Auschwitz ». Le moment en
est venu. Les temps sont mûrs.
Finalement, avec toutes les restrictions mentales des uns et des autres,
les temps sont peut-être en train de mûrir, la discussion,
ou ce qui en tient lieu, s'ouvre # :
[104]
« Le problème des chambres à
gaz #a »
ou « la rumeur d'Auschwitz »
Nul ne conteste l'utilisation de fours crématoires dans certains
camps allemands. La fréquence même des épidémies,
dans toute l'Europe en guerre, exigeait la crémation, par exemple
des cadavres de typhiques (voy. les photos).
C'est l'existence des « chambres à gaz »,
véritables abattoirs humains, qui est contestée. Depuis 1945,
cette contestation va croissant. Les grands moyens d'information ne l'ignorent
plus.
En 1945, la science historique officielle affirmait que des « chambres
à gaz » avaient fonctionné, aussi bien dans l'ancien
Reich qu'en Autriche, aussi bien en Alsace qu'en Pologne. Quinze ans plus
tard, en 1960, elle révisait son jugement : il n'avait, « avant
tout » (?), fonctionné de « chambres à
gaz » qu'en Pologne #b. Cette révision déchirante
de 1960 réduisait à néant mille « témoignages »,
mille « preuves » de prétendus gazages à
Oranienbourg, à Buchenwald, à Bergen-Belsen, à Dachau,
à Ravensbrück, à Mauthausen. Devant les appareils judiciaires
anglais ou français, les responsables de Ravensbrück (Suhren,
Schwanhuber, Dr Treite) avaient avoué l'existence d'une « chambre
à gaz » dont ils avaient même décrit, de
façon vague, le fonctionnement. Scénario comparable pour
Ziereis, à Mauthausen, ou pour Kramer au Struthof. Après
la mort des coupables, on découvrait que ces gazages n'avaient jamais
existé. Fragilité des témoignages et des aveux !
Les « chambres à gaz » de Pologne - on
finira bien par l'admettre - n'ont pas eu plus de réalité.
C'est aux appareils judiciaires polonais et soviétique que nous
devons l'essentiel de notre information sur elles (voy., par exemple, l'ébouriffante
confession de R. Höss : Commandant à Auschwitz).
Le visiteur actuel d'Auschwitz ou de Majdanek découvre, en fait
de « chambres à gaz », des locaux où
tout gazage aurait abouti à une catastrophe pour les gazeurs et
leur entourage. Une exécution collective par le gaz, à supposer
qu'elle soit praticable, ne pourrait s'identifier à un gazage suicidaire
ou accidentel. Pour gazer un seul prisonnier à la fois, pieds et
poings liés, les Américains emploient un gaz sophistiqué,
et cela dans un espace réduit, d'où le gaz, après
usage, est aspiré pour être ensuite neutralisé. Aussi,
comment pouvait-on, par exemple à Auschwitz, faire tenir deux mille
(et même trois mille) hommes dans un espace de 210 mètres
carrés (!), puis déverser (!) sur eux des granulés
du banal et violent insecticide appelé Zyklon B ; enfin, tout
de suite après la mort des victimes, envoyer sans masque à
gaz, dans ce local saturé d'acide cyanhydrique, une équipe
chargée d'en extraire les cadavres pénétrés
de cyanure ? Des documents trop peu connus #c montrent d'ailleurs :
1- Que ce local, que les Allemands auraient fait sauter avant leur départ,
[105] n'était qu'une morgue typique (Leichenkeller), enterrée
(pour la protéger de la chaleur) et pourvue d'une seule petite porte
d'entrée et de sortie ; 2- Que le Zyklon B ne pouvait pas s'évacuer
par une ventilation accélérée et que son évaporation
exigeait au moins vingt et une heures. Tandis que sur les crématoires
d'Auschwitz on possède des milliers de documents, y compris les
factures, au pfennig près, on ne possède sur les « chambres
à gaz », qui, paraît-il flanquaient ces crématoires,
ni un ordre de construction, ni une étude, ni une commande, ni un
plan, ni une facture, ni une photo. Lors de cent procès (Jérusalem,
Francfort, etc.), rien n'a pu être produit.
« J'étais à Auschwitz. Il ne s'y trouvait pas
de "chambre à gaz". » A peine écoute-t-on
les témoins à décharge qui osent prononcer cette phrase.
On les poursuit en justice. Encore en 1978, quiconque en Allemagne porte
témoignage en faveur de T. Christophersen, auteur du Mensonge
d'Auschwitz, risque une condamnation pour « outrage à
la mémoire des morts ».
Après la guerre, la Croix-Rouge internationale (qui avait fait son
enquête sur « la rumeur d'Auschwitz » #d
, le Vatican (qui était si bien renseigné sur la Pologne),
les nazis, les collabos, tous déclaraient avec bien d'autres :
« Les "chambres à gaz" ? nous ne savions
pas. » Mais comment peut-on savoir les choses quand elles n'ont
pas existé ?
Le nazisme est mort, et bien mort, avec son Führer. Reste aujourd'hui
la vérité. Osons la proclamer. L'inexistence des « chambres
à gaz » est une bonne nouvelle pour la pauvre humanité.
Une bonne nouvelle qu'on aurait tort de tenir plus longtemps cachée #e
.
La même page comporte une réfutation par un spécialiste,
M. Georges Wellers :
Abondance de preuves
M. Faurisson lance un défi : « Je défie quiconque
de m'apporter le moindre commencement de preuve de l'existence d'une chambre
à gaz » dans les camps de concentration nazis.
[106]
Il faut savoir que les chambres à gaz dans les camps où étaient
exterminés les Juifs et les Tziganes (Auschwitz, Belzec, Maidanek,
Sobibor, Treblinka) ont été détruites par les Allemands
avant la fin de la guerre, à la seule exception de Maidanek.
Cela dit, il ne s'agit pas du tout du « moindre commencement
de preuve », mais d'une abondance de preuves qui sont de trois
sortes : a) archives allemandes ; b) témoignages des anciens
S.S. ; c) témoignages des anciens détenus.
Par exemple, dans le cas d'Auschwitz, dans la correspondance entre les
industriels constructeurs de quatre chambres à gaz perfectionnées
à Auschwitz II (Birkenau) destinées à remplacer celles,
« artisanales » aménagées au printemps
de 1942 (« bunkers », dans le jargon du camp), il est
question de « l'installation d'une chambre à gaz »
(« Bestellung einer Begasungskammern »), etc. Ainsi, il
est grotesque de prétendre qu'il n'y avait pas de chambres à
gaz à Auschwitz, comme le fait le « témoin »
Christophersen cité, bien entendu, par M. Faurisson et qui est allé
les chercher, en 1944, à Auschwitz 1, à Raïsko, à
Bielitz, où elles ne se trouvaient pas. Quant à Birkenau
(Auschwitz II), où elles se trouvaient derrière des clôtures
interdites à tout étranger, il y est allé une fois
pour prendre en charge cent détenues affectées à Raisko,
et il n'a rien vu. Tout cela donne la mesure de son « témoignage »
fait en 1973 !
Toute la question est de savoir si ces chambres servaient pour les « poux »,
comme le dit Darquier, et comme semble le penser M. Faurisson, qui note
que le Zyklon B est un violent insecticide (souligné par
lui), ou pour les êtres humains.
En ce qui concerne les poux, il n'existe aucune indication positive. En
revanche, en ce qui concerne les êtres humains, les preuves abondent.
Voici, par exemple, ce que l'on lit dans le journal du médecin S.S.
Le professeur Kremer, découvert le 12 août 1945 à son
domicile, et se rapportant à la période où ce dernier
s'est trouvé à Auschwitz et où il a participé
à la sélection pour les chambres à gaz (Sonderaktion) :
« 2-9-1942 : Ce matin, à 3 heures, j'ai assisté
pour la première fois à une Sonderaktion. Comparé
à cela, l'enfer de Dante paraît une comédie. Ce n'est
pas sans raison qu'Auschwitz est appelé camp d'extermination. »
« 12-10-1942 : j'ai assisté à une Sonderaktion
dans la nuit (mille six cents personnes de Hollande). Scènes terrifiantes
devant le dernier bunker. » « 18-10-1942 : J'étais
présent à la onzième Sonderaktion sur les Hollandais
par un temps froid et humide. Scènes atroces, avec trois femmes
qui suppliaient qu'on leur laisse la vie. » S'agit-il des poux
ou des êtres humains ?
Par comparaison, le même Kremer note : « 1-9-1942 :
j'ai assisté l'après-midi à la désinfection
d'un bloc avec Zyklon B, afin de détruire les poux ».
Ici il n'y a question ni de « Sonderaktion », ni
de l'enfer de Dante, ni des scènes terrifiantes ou atroces, ni d'extermination
Le 29 janvier 1943, dans la lettre envoyée par le chef des constructions
d'Auschwitz au chef de l'administration centrale de la S.S. à Berlin
sur l'état d'achèvement de construction (Bauzustand) du Krematorium
II à Birkenau, il est question d'un four crématoire, d'un
local pour les cadavres (Leichenkeller) et d'un local pour le gazage (Vergasungskeller).
Pour des poux tout cela ?
[107]
En juillet 1945 et en mars et avril 1946, deux importants S.S. d'Auschwitz
(Pery Broad, responsable de la Politische Abteilung, et Rudolf Hss, commandant
d'Auschwitz), ont donné, devant les autorités britanniques,
puis (le second) devant le Tribunal international et, bien avant, les « appareils
judiciaires polonais et soviétiques », l'un ignorant
l'autre, une description détaillée des chambres à
gaz et de leur fonctionnement à Birkenau. Par la suite, au cours
de différents procès des S.S. d'Auschwitz devant des tribunaux
allemands, huit membres de la S.S. interrogés comme témoins,
ont reconnu avoir vu de leurs yeux les chambres à gaz de Birkenau
en fonctionnement. Aucun parmi quelques dizaines d'accusés n'a nié
leur existence, mais seulement sa participation personnelle à leur
usage.
Cinq évadés d'Auschwitz en 1943 et en 1944, parmi lesquels
un officier polonais non juif, ont donné la description des chambres
à gaz de Birkenau et leurs rapports ont été publiés
par les soins de l'Executive Office of War Refugee Board du président
des États-Unis en novembre 1944, en pleine guerre, en précisant
que « l'Office a toutes les raisons de croire que ces rapports
offrent une peinture exacte des faits horribles qui se passent dans ces
camps ».
D'autre part, quatre manuscrits ont été trouvés au
cours des fouilles effectuées sur le territoire de Birkenau, où,
avant de mourir, leurs auteurs, tous membres des Sonderkommandos affectés
au nettoyage des chambres à gaz et à l'évacuation
des cadavres vers les crématoires, les ont enterrés à
différentes époques. Toutes ces missives d'outre-tombe parlent
des chambres à gaz et de leur fonctionnement. Après la fin
de la guerre, quatorze rares survivants parmi les membres des Sonderkommandos
de Birkenau ont, de leur côté, donné des descriptions
identiques de ces chambres. Il reste à ajouter que la menace de
finir ses jours dans une chambre à gaz de Birkenau appartenait à
l'arsenal disciplinaire du camp et de ses kommandos, et était inculquée
à chaque détenu.
Toutes ces descriptions sont parfaitement concordantes quant à l'emplacement
topographique de ces chambres à gaz a Birkenau, à leur nombre,
à l'époque de leur entrée « en service »,
à leur fonctionnement au gaz « Zyklon B »
et, bien entendu, à leur usage pour tuer les êtres humains.
N'empêche que sur le ton d'un spécialiste chevronné
de l'assassinat de milliers d'êtres humains dans des chambres à
gaz, M. Faurisson nous explique que leur utilisation « aurait
abouti à une catastrophe pour les gazeurs et leur entourage »
envoyés « sans masque à gaz » « tout
de suite (souligné par lui) après la mort des victimes
dans ce local saturé d'acide cyanhydrique ». Car, dit-il,
« le Zyklon B ne pouvait pas s'évacuer par une ventilation
accélérée ».
Tout cela n'est qu'un prétentieux bavardage d'un spécialiste
de la critique des textes littéraires qui se prend pour un expert
en meurtres collectifs. D'autres spécialistes, infiniment mieux
placés, étaient d'une tout autre opinion. Par exemple, la
lettre du 29 janvier 1943 citée plus haut dit : « L'entreprise
Topf und Söhne n'a pas pu livrer à temps le dispositif d'aération
et de désaération ("die Be-und Entlüftungsanlage")
commandé par la direction centrale des constructions, en raison
de l'indisponibilité en wagons. Après l'arrivée du
dispositif d'aération et de désaération l'incorporation
de celui-ci sera aussitôt commencée, de sorte qu'on peut prévoir
que le 20 février 1943 il sera complètement en service. »
De leur [108] côté, Pery Broad, Hss et d'autres disent
tous que l'évacuation des cadavres se faisait après « le
dégazage à l'aide des ventilateurs » (Broad) ;
une demi-heure après [le gazage] (G.W.) le ventilateur électrique
était mis en marche et les corps étaient hissés jusqu'au
four par un monte-charge » (Hss, devant les Britanniques), etc.
Je ne sais pas si M. Faurisson est antisémite et partisan du nazisme.
Il affirme ne pas l'être. Mais, ce que je sais, c'est que s'il l'était,
il ne pouvait rien faire de plus, ni de mieux que ce qu'il fait pour calomnier
et injurier les Juifs en les traitant d'imposteurs et pour innocenter le
nazisme dans ce que ce dernier avait de plus abominable et de plus révoltant.
Mon propos ne s'adresse aucunement aux fanatiques, car il n'existe aucun
espoir de les persuader de quoi que ce soit. Il s'adresse aux hommes et
aux femmes de bonne foi ignorant les faits et qui risquent pour cette raison
de prêter l'oreille aux affirmations fallacieuses des apologistes
du nazisme.
Le lendemain, on trouve dans le même journal un long article d'Olga
Wormser-Migot, intitulé « La solution finale »
qui expose les grandes lignes de la thèse traditionnelle. On y trouve
aussi une réponse de M. Bernadet, le président de l'université
de Lyon 2, ainsi qu'un témoignage du Dr Chrétien sur le camp
du Struthof :
Un témoignage
Le Dr Hin, professeur d'anatomie, directeur de 1941 à 1944 de l'Institut
d'anatomie de Strasbourg, était désireux de se constituer
une collection de crânes juifs. Pour obtenir des squelettes en bon
état, ce savant s'adressa donc à Himmler pour obtenir des
Juifs vivants (on a retrouvé toute la correspondance). Les S.S.
lui livrèrent donc, au camp de concentration de Natzweiler, cinquante-sept
hommes et trente femmes, qui furent parqués au block 13, isolé
par des barbelés du reste du camp. Les déportés français
de juillet 1943 (numéros entre 4300 et 4500) les ont vus (tous
ces déportés français, dont je suis, ne sont pas encore
morts). Une nuit d'août 1943, le block 13 se vida - les déportés
français y furent ensuite transférés. Et les infirmiers
du camp nous confièrent, en secret, que ses occupants et occupantes
étaient passés à la chambre à gaz du Struthof.
De fait, M. Henry Pierre, un Alsacien employé à l'Institut
d'anatomie de Strasbourg, réceptionna quatre-vingt-sept cadavres
(et releva les numéros d'Auschwitz tatoués sur les avant-bras)
en août 1943. Le savant professeur Hin lui recommanda le silence :
« Pierre si tu ne tiens pas ta langue, tu y passeras aussi. »
Les temps étaient durs, et le précieux travail de dépouillement
de la chair pour dégager les squelettes ne put être fait à
temps, et aux approches des Alliés, les criminels s'affolèrent.
Des documents écrits montrent leur souci de faire disparaître
les traces de crime monstrueux.
Les troupes françaises arrivèrent. On trouva une partie des
cadavres, qui n'avaient pas encore été dépecés.
Ils furent examinés et photographiés par le professeur Simonin.
[109]
Arrêté à Bergen-Belsen, Joseph Kramer, commandant du
camp de Natzweiler en 1943, a décrit longuement, devant le commandant
Jadin, du tribunal militaire de la 10e région, comment, en août
1943, il avait, lui-même, selon les instructions de l'éminent
professeur Hin, assassiné par les gaz ces quatre-vingt-sept malheureux,
dans la chambre aménagée a la ferme du Struthof
D'autres victimes ont péri dans cette chambre à gaz :
des preuves existent (écrits, témoins) de son utilisation,
entre autres, pour des expériences sur l'ypérite
Mais aux menteurs et aux faussaires (au lieu du « droit de réponse »
discutable, qu'ils m'attaquent devant les tribunaux pour injure et diffamation :
je les attends), il faut rappeler que que les nazis se permettaient à
l'échelle artisanale sur le territoire français (Natzweiler-Struthof
est en Alsace) ils l'ont fait à l'échelle industrielle à
Auschwitz-Birkenau et Majdanek, etc.
Les survivants des camps de concentration, les parents des millions de
victimes qui ont râlé dans les chambres à gaz, disparaissent
peu à peu. Ils voudraient bien que les disciples de professeurs
Hin ne se parent pas de titres universitaires français.
Dr H. Chrétien,
détenu no 4468 de Natzweiler. Veuf de Rachel Zacharewicz, gazée
à Auschwitz-Birkenau avec le convoi du 2 septembre 1943.
Le 16 janvier, réponse de R. Faurisson dont j'ai déjà
cité plus haut, p. 61, les premières lignes :
Les répliques que vient de susciter mon bref article sur « La
rumeur d'Auschwitz », je les ai lues plus d'une fois en dix-huit
ans de recherches. Je ne mets pas en cause la sincérité de
leurs auteurs, mais je dis que ces répliques fourmillent d'erreurs,
depuis longtemps signalées par les Rassinier, les Scheidl et les
Butz.
Par exemple dans la lettre, qu'on me cite, du 29 janvier 1943 (lettre qui
ne porte même pas l'habituelle mention de « Secret »),
Vergasung ne signifie pas « gazage », mais
« carburation ». Vergasungslkeller désigne
la pièce, en sous-sol, où se fait le mélange « gazeux »
qui alimente le four crématoire. Ces fours, avec leur dispositif
d'aération et de ventilation, venaient de la maison Topf & Fils
d'Erfurt (N°4473).
Begasung désignait le gazage de vêtements en autoclaves.
Si le gaz employé était le Zyklon B - préparation
de « B [lausäure] », c'est-à-dire d'acide
prussique ou cyanhydrique - on parlait de « chambres à
gaz bleues ». Rien à voir avec les prétendues
« chambres à gaz-abattoirs » !
Il faut citer correctement le Journal du médecin Johann Paul
Kremer. On verra ainsi que, s'il parle des horreurs d'Auschwitz, c'est
par allusion aux horreurs de l'épidémie de typhus de septembre-octobre
1942. Le 3 octobre, il écrira : « A Auschwitz, des
rues entières sont anéanties par le typhus. »
Lui-même, il contractera ce qu'il appelle « la maladie
d'Auschwitz ». Des Allemands en mourront. Le tri des malades
et des bien-portants, c'était la « sélection »
ou l'une des formes dc l'« action [110] spéciale »
du médecin. Ce tri se faisait soit à l'intérieur des
bâtiments, soit à l'extérieur. Jamais Kremer n'a écrit
qu'Auschwitz était un Vernichtungslager, c'est-à-dire,
selon une terminologie inventée par les Alliés après
la guerre, un « camp d'extermination » (entendez
par là : un camp doté d'une « chambre à
gaz »). En réalité, il a écrit : « Ce
n'est pas pour rien qu'Auschwitz est appelé le camp de l'anéantissement
(das Lager der Vernichtung). » Au sens étymologique du
mot, le typhus anéantit ceux qu'il frappe. Autre grave erreur de
citation : à la date du 2 septembre 1942, le manuscrit de Kremer
porte : « Ce matin, à 3 h, j'ai assisté dehors,
pour la première fois, à une action spéciale. »
Historiens et magistrats suppriment traditionnellement le mot « dehors »
(draussen) pour faire dire à Kremer que cette action se déroulait
dans une « chambre à gaz ». Enfin, les scènes
atroces devant le « dernier bunker » (il s'agit de
la cour du bunker n° 11) sont des exécutions de condamnés
à mort, exécutions auxquelles le médecin était
obligé d'assister. Parmi les condamnés se trouvent trois
femmes arrivées dans un convoi de Hollande : elles sont fusillées #a
.
Les bâtiments des « Kremas » de Birkenau étaient
parfaitement visibles #b de tous. Bien des plans et des photos le
prouvent, qui prouvent également l'impossibilité matérielle
radicale pour ces « Kremas » d'avoir eu des « chambres
à gaz ».
Si, à propos d'Auschwitz, l'on me cite, une fois de plus des aveux,
des mémoires ou des manuscrits - miraculeusement - retrouvés
(tous documents que je connais déjà), je veux qu'on me montre
en quoi leurs précisions imprécises diffèrent des
précisions imprécises de tous les documents qui ont fait
dire aux tribunaux militaires des Alliés qu'il y avait des « chambres
à gaz » là où, en fin de compte, on a fini
par reconnaître qu'il n'y en avait pas eu : par exemple, dans
tout l'Ancien Reich !
J'avais cité les documents industriels NI'9098 et 9912. Il faut
les lire avant de m'opposer les « témoignages »
de Pery Broad et de R. Höss ou, pourquoi pas, les « aveux »,
après la guerre, de J.P. Kremer. Ces documents établissent
que le Zyklon B ne faisait pas partie des gaz qualifiés de ventilables,
ses fabricants sont obligés de convenir qu'il est « difficile
à ventiler, vu qu'il adhère aux surfaces ». Dans
un local cyanuré par le Z. B, on ne peut pénétrer,
avec un masque au filtre « J » - le plus sévère
des filtres - qu'au bout d'une vingtaine d'heures pour procéder
à un test chimique de disparition du gaz #c . Matelas et couvertures
doivent être battus à l'air libre pendant une à deux
heures. Or, Höss écrit #d : « Une demi-heure
après avoir lancé le gaz, on ouvrait la porte et on mettait
en marche l'appareil de ventilation. On commençait immédiatement
à extraire les cadavres. » Immédiatement (sofort) !
Et d'ajouter que l'équipe chargée de manipuler deux mille
cadavres cyanurés entrait dans ce local (encore plein de gaz, n'est-ce
pas ?) et en tirait les corps « en mangeant et en fumant »,
c'est-à-dire, si je comprends bien, sans même un masque à
gaz. C'est impossible. Tous les témoignages, si vagues ou [111]
discordants qu'ils soient sur le reste #e, s'accordent au moins sur
ce point : L'équipe ouvrait le local, soit immédiatement,
soit « peu après » la mort des victimes. Je
dis que ce point, à lui seul, constitue la pierre de touche du faux
témoignage.
En Alsace la « chambre à gaz » du Struthof
est intéressante à visiter. On y lit sur place la confession
de Josef Kramer. C'est par un « trou » (sic) que
Kramer versait « une certaine quantité de sels cyanhydriques »,
puis « une certaine quantité d'eau » :
le tout dégageait un gaz qui tuait à peu près en une
minute. Le « trou » qu'on voit aujourd'hui a été
si grossièrement fait par un coup de burin que quatre carreaux de
faïence en ont été brisés. Kramer se servait
d'un « entonnoir à robinet ». Je ne vois ni
comment il pouvait empêcher ce gaz de refluer par ce trou grossier,
ni comment il pouvait admettre que le gaz, s'évacuant par la cheminée,
aille se répandre sous les fenêtres de sa villa. Qu'on passe
dans une pièce voisine et, là, qu'on m'explique cette affaire
de cadavres conservés pour le professeur Hirt dans des « cuves
à formol », qui ne sont, en fait, que des cuves à
choucroute et à pommes de terre, munies de simples abattants de
bois sans étanchéité.
L'arme la plus banale, si elle est soupçonnée d'avoir tué
ou blessé, fait l'objet d'une expertise judiciaire. On constate
avec surprise que ces prodigieuses armes du crime que sont les « chambres
à gaz » n'ont, elles, jamais fait l'objet d'une expertise
officielle (judiciaire, scientifique ou archéologique) dont on puisse
examiner le rapport #f .
Si par malheur les Allemands avaient gagné la guerre, je suppose
que leurs camps de concentration nous auraient été présentés
comme des camps de rééducation. Contestant cette présentation
des faits, j'aurais été sans doute accusé de faire
objectivement le jeu du « judéomarxisme ».
Ni objectivement, ni subjectivement je ne suis judéomarxiste ou
néo-nazi. J'éprouve de l'admiration pour les Français
qui ont courageusement lutté contre le nazisme. Ils défendaient
la bonne cause. Aujourd'hui, si j'affirme que les « chambres
à gaz » n'ont pas existé, c'est que le difficile
devoir d'être vrai m'oblige à le dire.
[Conformément à la loi du 29 juillet 1881, nous publions
le texte de M. Faurisson. Toute réplique le mettant en cause ouvrirait
à son profit un nouveau droit de réponse.
Nous n'en considérons pas pour autant comme clos le dossier ouvert
par les déclarations de Darquier de Pellepoix.]
G. Wellers répond sans citer Faurisson (voir p. 331).
Enfin, en réponse à un placard publicitaire du Droit de
vivre, « le professeur Faurisson est assigné par
la L.I.C.A. devant les tribunaux # », il envoie le texte
suivant, dont seuls des extraits sont publiés, peut-être pour
ne pas lui accorder plus de place que le placard incriminé (23 mars
1979) :
[112]
Pour un vrai débat sur les « chambres à gaz»
M. Wellers, qui me traite de « romancier », a éludé
mes arguments et, en particulier. ceux qui touchent aux impossibilités
matérielles du gazage. Employé dans cette prétendue
« chambre à gaz » de 210 mètres carrés
(en réalité : une simple morgue), le Zyklon B aurait
adhéré au plafond, au plancher et aux quatre murs. Il aurait
pénétré les corps des victimes et leurs muqueuses
(comme, dans la réalité, il pénétrait les matelas
et les couvertures à désinfecter, qu'il fallait battre pendant
une heure à l'air libre pour en chasser le gaz). L'équipe
chargée de vider la « chambre à gaz »
de ses 2000 cadavres aurait été asphyxiée à
son tour. Il lui aurait fallu, sans même un masque à gaz,
s'engouffrer dans un bain de vapeurs d'acide cyanhydrique et y manipuler
des corps encore tout imprégnés des restes d'un gaz mortel.
On me dit bien que Höss ne se souciait pas de la santé des
membres de cette équipe. Soit ! Mais comme ces hommes n'auraient
pu faire leur travail, je ne vois pas qui aurait évacué la
« chambre à gaz » pour laisser la place à
de nouvelles fournées. Quant au « dispositif d'aération
et de ventilation », je répète qu'il est celui
des fours, ainsi que l'atteste le document N0-4473. D'ailleurs le Zyklon
B est « difficile à ventiler » dans un vaste
local et, de plus, il est explosible : on n'emploie pas d'acide cyanhydrique
à proximité d'un four !
Quand Kremer et ses juges parlent de trois femmes fusillées à
Auschwitz, ils ne disent rien d'invraisemblable. En revanche, quand le
même Kremer dit à ses juges qu'il a assisté à
un gazage mais de loin, assis dans sa voiture. je ne le crois plus. Il
précise en effet que la réouverture de la « chambre
à gaz » s'opérait « un moment »
après la mort des victimes #a2. Il y a la une impossibilité
matérielle flagrante sur laquelle je ne reviendrai pas. Et puis,
je constate que, pour tenter de nous expliquer une « confession »,
celle de Kremer. on s'appuie sur une autre « confession »,
celle, comme par hasard. de Höss Le point troublant est que ces deux
confessions s'infirment plus qu'elles ne se confirment. Voyez de près
la description à la fois des victimes, du cadre, des exécutants
et du mode d'exécution.
On trouve plaisant que je réclame une expertise de ces « armes
du crime » qu'auraient été les « chambres
à gaz ». On me fait remarquer qu'une chambre à
gaz pourrait s'improviser en une minute dans un simple appartement. C'est
une erreur. Une chambre à coucher ne peut devenir une chambre à
gaz. Une asphyxie suicidaire ou accidentelle ne peut avoir de rapport avec
une exécution par le gaz. Quand on veut tuer toute une foule de
victimes avec un gaz quelconque et surtout avec de l'acide cyanhydrique,
sans risquer moi-même d'être tué, de provoquer une explosion
etc., il doit falloir mettre au point une machinerie extraordinairement
compliquée. Il devient de plus en plus difficile de croire à
l'existence de ces abattoirs humains qu'auraient été les
« chambres à gaz ». Tout récemment.
les photos aériennes d'Auschwitz et de Birkenau (documents des Américains
Dino A. Brugioni et Robert G. Poirier en 19 pages et 14 photos) pourraient
bien avoir porté le coup de grâce à la légende
de l'extermination. On possédait déjà d'assez nombreuses
photos « terrestres » des « Krémas »
d'Auschwitz et de Birkenau, sans compter les plans. La nature des bâtiments
et leur emplacement semblaient exclure toute possibilité d'un usage
criminel. Les photos aériennes [113] confirment cette impression.
En 1944, même au plus fort de ce qu'ils appellent « la
période de l'extermination », les Américains confessent
leur surprise de ne pas voir ces fumées et ces flammes qui. dit-on,
« jaillissaient continuellement des cheminées des crématoires
et se voyaient à la distance de plusieurs milles ». Cette
remarque, ils la font à propos de la photo du 25 août 1944
- lendemain de l'arrivée de cinq convois « à
exterminer » #b2 -, mais il semble bien qu'elle s'applique
aussi aux autres photos : celles du 4 avril, du 26 juin, du 26 juillet
et du 13 septembre 1944. En 1976, l'historien révisionniste Arthur
R Butz avait fait une remarque prémonitoire #c2 . Il avait
écrit que, vu les recherches industrielles avancées que les
Allemands menaient dans le complexe d'Auschwitz, les Alliés possédaient
certainement dans leurs archives des photos aériennes du camp. Il
ajoutait que, si on ne s'empressait pas de nous révéler l'existence
de ces photos, c'est que probablement celles-ci ne fournissaient pas de
preuves à l'appui des accusations portées contre les Allemands.
Des historiens français viennent de condamner sorboniquement ceux
qui se permettent de mettre en doute l'existence des « chambres
à gaz » homicides. Depuis quatre mois je ne peux plus
donner de cours à mon université. La L.I.C.A. m'assigne en
justice pour « falsification de l'histoire » et demande
aux autorités de « suspendre (m)es enseignements (...) aussi
longtemps que la justice n'aura pas statué #d2 ».
Mais personne, à ce que je vois, n'ose affronter à armes
totalement égales le débat que je propose. Ma proposition
est pourtant simple à satisfaire. Toute accusation devant se prouver.
je demande qu'on soumette à l'épreuve d'une analyse historique
de routine une preuve, une seule preuve précise, de l'accusation
portée contre l'Allemagne sur le chapitre des « chambres
à gaz ». Par exemple, parmi toutes les « chambres
à gaz » qu'on fait visiter aux pèlerins et aux
touristes, que les accusateurs m'en désignent une qui, à
leurs yeux, aient vraiment servi à tuer des hommes à un moment
quelconque.
En attendant, je remercie le nombre croissant de ceux qui, surtout parmi
les jeunes, m'apportent leur soutien. Jean-Gabriel Cohn-Bendit écrit :
« Battons-nous donc pour qu'on détruise ces chambres
à gaz que l'on montre aux touristes dans les camps où l'on
sait maintenant qu'il n'y en eut point #e2 . » Il a raison.
Finissons-en avec la propagande de guerre. Les horreurs réelles
suffisent. Il est inutile d'en rajouter.
La bataille quitte l'air libre pour retrouver les souterrains, après
la clausule du Monde du 19 janvier : « Toute réplique
le mettant en cause ouvrirait à son profit un nouveau droit de réponse. »
Les attaques et les controverses viseront dès lors un [114]
ennemi anonyme, innommable, mais connu. On jugera si le procédé
est équitable. Il en va de même dans le reste de la presse #.
En témoigne le conflit qui l'oppose à un journal lyonnais.
Le principal intéressé en rend compte de la façon
suivante (juillet 1979) :
Le 17, puis, à nouveau, le 18 novembre 1978, Robert Faurisson, maître
de conférences à l'université Lyon 2 est vivement
pris à partie par le journal le Progrès de Lyon. Il envoie
une lettre au journal en « droit de réponse ».
Le journal refuse de publier sa lettre. R. Faurisson saisit la justice.
Le jugement est rendu le 27 juin 1979 par le tribunal de police de Lyon.
Le juge (unique) est Mme Baluze-Frachet. R. Faurisson est débouté.
Dans son numéro du 30 juin 1979, le journal résume ainsi
l'affaire : « Le tribunal a débouté M. Faurisson
considérant que sa lettre au Progrès "contenait
des affirmations contraires aux bonnes murs et à l'ordre moral". »
Ce résumé est exact. Le professeur est accusé de porter
atteinte aux bonnes murs, c'est-à-dire à « l'ensemble
des règles morales auxquelles la société ne permet
pas qu'il soit dérogé ». Il porte aussi atteinte
à « l'ordre moral », qui n'est pas à
confondre avec « l'ordre public ». Il faut sans doute
remonter au temps du second Empire et à la législation en
vigueur vers 1850 en France pour trouver mention de cet « ordre
moral ». Les poursuites entamées contre Baudelaire et
Flaubert ont dû l'être plus ou moins au nom de cet ordre-là.
Au début de la IIIe République, les nostalgiques de la monarchie
donnèrent le nom d'« ordre moral » à
la politique conservatrice définie par le duc de Broglie le 26 mai
1873 et qui devait préparer la restauration de la monarchie. Appuyée
sur l'Église, elle entraîna des mesures antirépublicaines
(destitution de fonctionnaires républicains, etc.). Cette politique
fut celle du maréchal de Mac Mahon. Bref, « ordre moral »
ne désigne plus, depuis longtemps, qu'une politique totalement réactionnaire
ou rétrograde. On ne se vante plus guère d'être un
défenseur de l'« ordre » et encore moins de
« l'ordre moral ». Mme Baluze-Frachet reproche au
professeur les deux phrases suivantes :
1.- « (...) quatorze ans de réflexion et quatre ans
d'une enquête minutieuse (...) m'ont conduit à déclarer
le 29 janvier 1978 aux participants d'un colloque d'historiens qui s'est
tenu à Lyon que les massacres en prétendues "chambres
à gaz" sont un mensonge historique. »
2.- « (...) La question est de savoir s'il est vrai ou s'il
est faux que les "chambres à gaz" hitlériennes
ont existé réellement. »
Mme le Juge déclare : « Ces dires sont contraires
aux bonnes murs ». Elle ajoute : « il est constant
que des millions de personnes, plus particulièrement juives, sont
mortes dans les camps concentrationnaires [115] nazis, victimes
de différentes "machines à tuer", dont les chambres
à gaz ». Mme le Juge poursuit : « Les
chambres à gaz ont existé et (...) le simple fait de vouloir
faire insérer dans un quotidien un article dont l'auteur se pose
la question de leur existence porte atteinte aux bonnes murs. »
Mme le Juge va encore beaucoup plus loin. Elle reproche au professeur d'avoir
porté atteinte à « l'honneur des membres du gouvernement,
et principalement à son chef ». Ce chef est M. Raymond
Barre, dont le fief électoral se situe à Lyon.
Qu'a fait Robert Faurisson pour porter atteinte à l'honneur d'aussi
estimables personnes ?
La réponse est donnée par Mme le Juge. R. Faurisson, à
qui ses collègues historiens se permettaient de faire la morale,
leur rappelait deux choses :
a) Ils avaient, de leur propre aveu, obtenu de la presse locale et,
en particulier, du Progrès de Lyon, qu'on fasse silence sur
les déclarations de R. Faurisson au colloque de Lyon de janvier
1978 ;
b) Ils savaient tous parfaitement que le Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale (de MM. Henri Michel et Claude Lévy),
comité directement rattaché au Premier ministre, chef du
gouvernement, cachait depuis cinq ans le nombre véritable des
véritables déportés de France.
R. Faurisson avait donc écrit à la meute de ses détracteurs
et donneurs de leçons de morale : « Je traite de
lâches ceux qui affectent d'ignorer cette pure et simple rétention
de documents. » Il avait ajouté à l'adresse du
journal qui joignait sa voix à celles des détracteurs (et
qui, depuis 35 ans, entretenait ses lecteurs d'une histoire mythique de
la dernière guerre) le reproche suivant : « Je vous
reproche un silence et une collusion avec toutes sortes de pouvoirs officiels
ou officieux depuis 35 ans. »
R Faurisson avait aussi rappelé que le comité fonctionnait
avec l'argent du contribuable et que si ce Comité cachait les résultats
de son enquête de vingt ans, c'était, du propre aveu de M.
Henri Michel, pour « éviter des heurts possibles avec
certaines associations de déportés » (Bulletin
- confidentiel - n° 209) et parce que la publication
de ces résultats « risquerait de susciter des réflexions
désobligeantes pour les déportés » (Bulletin
n° 212, avril 1974). A aucun moment, R. Faurisson ne parlait
de « membres du gouvernement » (au pluriel). Il écrivait
seulement : « Ce comité officiel est directement
rattaché au Premier ministre. » Cette précision
figure constamment et en gros caractères sur les publications du
comité en question.
Mme le Juge, pour terminer, stigmatise, d'une façon générale,
dans la lettre du professeur, ce qu'elle appelle « les passages
contraires à l'ordre moral » : ces passages qu'elle
a cités et commentés.
Voir suite
TABLE DES MATIÈRES
Première partie : Le comment du pourquoi
I. - L'aspect historique
II. - L'air du temps, le temps se couvre
Deuxième partie : Le dossier de l'affaire Faurisson
Chapitre premier : A-t-on lu Faurisson ?
Chapitre II : Ce qu'est l'affaire Faurisson
Chapitre III : L'éclatement de l'affaire
Chapitre IV : De la misère en milieu enseignant
I. - La droite, la gauche
II. - Plus loin, à gauche
III. - La L. I. C. A., c'est quoi ?
Chapitre V Le révisionnisme à l'étranger
Chapitre VI : De la nécessité de l'affaire Faurisson
Documents
Document I : Interview de Robert Faurisson parue dans la revue Storia
illustrata
Document II : Le Journal d'Anne Frank est-il authentique ?
par Robert Faurisson
Annexes
Document III : Chambre à gaz du pénitencier de Baltimore
Document IV : Iconographie
Document V : Vérité historique, vérité
humaine
Un texte capital
Conclusion provisoire des éditeurs
Orientation bibliographique
Index (des noms)
Elie Wiesel: Un grand faux témoin
Par Robert Faurisson
Ils sont partout ! -
Liste des Juifs qui dominent la France
The Jewish hand behind Internet
The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia,
Yahoo!, MySpace, eBay...
Le Holo-CULOT juif veut s'imposer en "religion" mondiale !
Protocoles des Sages de Sion
La tyrannie du "Nouvel ordre mondial" sioniste
Entretien du général REMER
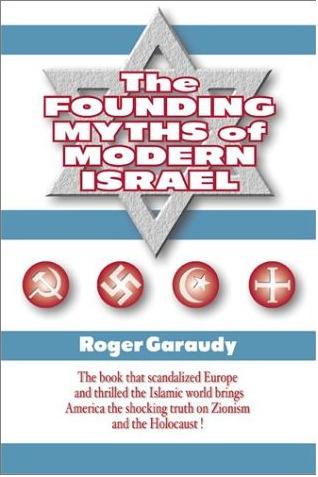
Garaudy:
"Les mythes fondateurs de la politique israélienne"
The Jews behind Islamophobia
Lobby israélo-sioniste en France
Par Roger Garaudy
Le Judaïsme est nu !
Notes sur l'ouvrage d'Israël Shahak
Talmudophobe 
Clip officiel, Rude-Goy Recordz
Israel controls U.S.
Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...
Les victoires du révisionnisme
Discours du professeur Robert Faurisson à la conférence de Tehran
Les relations secrètes entre les Noirs et les juifs
Nation of Islam
Liste des agressions de la Ligue de Défense Juive (LDJ)
Vidéos


Le Talmud démasqué
Le Gouvernement juif-sioniste de François Hollande
Bernard-Henri Lévy - Agent
d´Israël
Le dossier photo
Qui se cache derrière les
caricatures «danoises» ?
Par Ahmed Rami
La France juive
Par Édouard Drumont, 1886
Le CRIF un lobby au coeur de la république

Caricatures

Activisme !